« Le vrai pouvoir est celui qu’on ne montre pas ». Cette maxime, que l’on pourrait croire écrite pour les coulisses du Cameroun, semble taillée sur mesure pour Jean Nkuete. Derrière les mégas meetings qui embrasent Yaoundé, Bafoussam, Maroua et ailleurs, derrière les bus de militants, les gradins enfiévrés, les camions de sonorisation et les banderoles à l’effigie du président-candidat, se dresse une silhouette discrète et essentielle.
Secrétaire général du Comité central du RDPC, Jean Nkuete, méthodique et imperturbable, orchestre la campagne de Paul Biya comme un vieux maître dirigeant sa partition. Dans l’ombre du pouvoir, il veille à la discipline, à la cohérence et au rythme d’un parti qu’il connaît mieux que quiconque. Voici dix choses à savoir sur celui qui, sans jamais élever la voix, fait battre le cœur du système Biya.
1. L’ombre qui dirige la lumière
À Yaoundé, lors du lancement officiel de la campagne, les caméras fixaient Paul Biya ( son affiche sur le grand mur de l’hôtel de ville) . Mais dans les coulisses, un autre regard scrutait la foule, les mouvements, les timings, les visages des différents membres du gouvernement.
Jean Nkuete, costume sobre, allure contenue, carnet à la main. Il ne prononce pas de slogans ; il vérifie, ajuste, veille. Quelques semaines plus tard, à Bafoussam, il est encore là, coordonnant les derniers détails de campagne de l’élection présidentielle. Demain, sauf surprise, il sera à Maroua, avec le chef de l’État pour s’assurer que le Nord résonne à l’unisson du Sud et de l’Ouest.
2. L’homme de Balessing
Né en 1944 à Balessing, dans la Menoua, Jean Nkuete appartient à cette génération d’élites bamilékés formées dans la rigueur et le catholicisme. Ses années au Lycée du Manengouba à Nkongsamba, puis à l’Université catholique de Milan et à l’École de développement économique de Rome, ont façonné un économiste plus cartésien que charismatique. Docteur en sciences économiques, il rentre au Cameroun en 1969, entre au ministère du Plan et devient rapidement chef du département de la planification générale.
3. Le disciple des pionniers
À la fin des années 1960, un nom revient souvent dans les cercles intellectuels bamilékés : Samuel Kamé. C’est lui, idéologue de l’Union nationale camerounaise (UNC), qui repère le jeune technocrate et le place dans les circuits du pouvoir. Grâce à Jean Keutcha, ministre et autre figure tutélaire, Nkuete gravit les échelons. De la planification générale, il passe à la direction des affaires économiques et techniques de la primature en 1975, alors que Paul Biya en est le chef. C’est le début d’une fidélité qui ne se démentira jamais.
4. L’allié du Sphinx
Quand Paul Biya accède à la présidence en 1982, Jean Nkuete fait partie du premier cercle. En 1983, il devient vice-secrétaire général de la présidence, avec rang de ministre. Trois ans plus tard, Biya le promeut secrétaire général du gouvernement. Dans ce rôle, il apprend à manœuvrer entre les ministères, à coordonner sans heurter, à imposer sans paraître. Déjà, il incarne ce profil rare : celui de l’homme indispensable qui n’a jamais besoin de s’imposer.
5. L’économiste des institutions
À Bangui, Jean Nkuete s’impose comme un homme de méthode, un technocrate pur jus formé à la discipline du chiffre. Sous sa houlette, la CEMAC tente de se doter d’une véritable ossature économique sous-régionale. Il plaide pour une union monétaire plus cohérente, un contrôle budgétaire plus strict des États membres et un retour à la discipline macroéconomique.
Ses collègues le décrivent comme « un homme de compromis mais pas de compromission ». Dans la capitale centrafricaine, il se lie d’amitié avec Martin Ziguélé, alors ministre des Finances puis futur Premier ministre. Entre les deux hommes, la complicité dépasse les dossiers communautaires : ils partagent la même rigueur et une certaine conception de l’État comme moteur de développement. Ziguélé, plus politique, admire la froideur méthodique du Camerounais ; Nkuete, lui, voit en Ziguélé un partenaire loyal dans un environnement souvent traversé par les calculs.
Son passage à la BEAC puis à la CEMAC forge une réputation qui dépasse les frontières du Cameroun. À Bangui, il devient une figure respectée de l’intégration africaine, celle d’un homme capable de naviguer entre les susceptibilités régionales sans jamais perdre son cap. Mais surtout, il consolide un lien déjà ancien : celui de la confiance avec Paul Biya.
Lorsqu’il quitte Bangui en 2006, c’est encore à l’appel d’Etoudi qu’il rentre à Yaoundé. L’économie et la politique, chez Nkuete, ne sont jamais dissociées : il les conçoit comme deux leviers d’un même pouvoir, celui de la stabilité. Et c’est précisément cette stabilité — cette capacité à maintenir les structures debout malgré les secousses — qui fera de lui, quelques années plus tard, le maître d’œuvre silencieux du parti présidentiel.
6. Le retour au bercail
En 2006, Paul Biya le rappelle au pays. Après des années passées dans les couloirs feutrés de la CEMAC, Jean Nkuete rentre à Yaoundé avec la même sobriété que lorsqu’il en était parti. Nommé ministre de l’Agriculture et du Développement rural, il hérite d’un portefeuille sensible, celui des campagnes et des semences, des engrais et des subventions, bref, de la survie silencieuse du monde rural. Peu médiatique, il n’en demeure pas moins actif : dans les provinces, les coopératives agricoles saluent un ministre qui écoute, qui calcule avant d’agir, et qui préfère les résultats aux caméras.
Un an plus tard, il gravit un nouvel échelon : vice-premier ministre chargé de l’Agriculture. Là encore, Nkuete reste égal à lui-même — sobre, appliqué, effacé. Dans un environnement où l’exposition médiatique est souvent synonyme d’ambition, il choisit la retenue. Les observateurs notent sa capacité à durer. « Il a compris le rythme du système », glisse un ancien collègue du gouvernement. Les remaniements passent, les têtes tombent, mais lui demeure, imperturbable, comme une pièce vissée à l’architecture du régime.
C’est que Biya n’a pas oublié son fidèle technocrate. En décembre 2011, un nouveau chapitre s’ouvre : Jean Nkuete est nommé secrétaire général du Comité central du RDPC. Derrière cette fonction, en apparence administrative, se cache en réalité le cœur battant du parti au pouvoir. Et Biya, qui ne délègue jamais par hasard, choisit là encore la prudence incarnée. Nkuete quitte le gouvernement sans bruit, mais accède à un poste autrement plus stratégique : celui de gardien du temple, du lien organique entre le président-candidat et la base militante.
7. Le gardien de la maison
Sa nomination à la tête du parti, en décembre 2011, survient dans un climat de crispations internes. Paul Biya cherche à calmer les remous provoqués par les rivalités entre figures du sérail. Marafa Hamidou Yaya vient d’être écarté du gouvernement pour avoir trop ouvertement affiché ses ambitions. René Emmanuel Sadi, alors secrétaire général du RDPC, traverse une zone de turbulences : il est en conflit avec Martin Belinga Eboutou, directeur du cabinet civil du président, et ses relations sont tendues avec Grégoire Owona, son adjoint au parti, qui le rend responsable des ratés du congrès de 2010.
Plus grave encore, Sadi ne s’entend plus avec Laurent Esso, son ancien allié, désormais tout-puissant ministre et proche du chef de l’État. Ce dernier ne manque pas une occasion de souligner les supposées ambitions de Sadi, allant jusqu’à l’appeler ironiquement « Monsieur le Président ».
Dans ce contexte de rivalités larvées, Biya choisit la tempérance. Il appelle Jean Nkuete, discret économiste et fidèle compagnon de route, à la tête du Comité central du RDPC. L’homme n’a jamais suscité la crainte, encore moins la controverse. Il est respecté pour sa rigueur et son silence. L’économiste devient alors le gardien de la maison, celui qui rassure tout le monde sans menacer personne.
Mais derrière cette façade paisible, Nkuete verrouille les circuits du pouvoir partisan. Il rétablit les équilibres internes, consolide les réseaux et renforce la main du chef. À ses côtés, son fidèle conseiller Jean Fabien Monkam Nitcheu, président du conseil d’administration de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, orchestre l’ombre du dispositif.
Son épouse Honorine, effacée mais influente, veille sur les communications : elle filtre les appels, prend les messages et tient la porte du temple. Ensemble, ils incarnent un binôme redoutablement efficace, symbole d’un RDPC recentré, verrouillé, discipliné.
8. Le stratège des réseaux
Sous son règne, les milieux d’affaires bamilékés s’ancrent solidement dans le RDPC. Les grands patrons – Sylvestre Ngouchinghe, Albert Kouinche, Paul Éric Djomgoue – trouvent en lui un interlocuteur fiable. En échange de leur loyauté, certains obtiennent sièges et visibilité. La discipline du parti se nourrit de cet entrelacement entre économie et politique. Nkuete, docteur en équations, a trouvé la sienne : stabilité = fidélité + silence.
9. Jean Nkuete sous la casquette d’auteur prolifique
Avant d’être l’un des plus puissants secrétaires généraux que le RDPC ait connus, Jean Nkuete est d’abord un penseur et un économiste à la plume rigoureuse. Dans les années 1980, il publie plusieurs ouvrages de référence sur la monnaie, les finances et le développement en Afrique centrale. Des titres comme « Monnaie et finances comme moteur de développement » (1980) ou « Le Franc CFA face aux mutations des grandes unités de compte : Dollar-DTS-ECU » (1981) témoignent d’une maîtrise rare des mécanismes macroéconomiques.
Dans « Mécanisme de compensation en Afrique centrale : portée, limites et perspectives » (1994), il explore déjà les défis d’une intégration monétaire plus juste au sein de la sous-région, anticipant les débats contemporains sur la souveraineté financière africaine.
Érudit, Nkuete a toujours préféré l’efficacité à la lumière. Ses écrits, publiés par plusieurs maisons d’éditions, reflètent une vision : celle d’une Afrique capable de penser par elle-même sa monnaie, sa croissance et ses institutions. Loin des tribunes politiques et des slogans partisans, le docteur en économies quantitatives formé à Milan et à Rome s’impose alors comme l’un des architectes intellectuels du Cameroun post indépendance.
Les chiffres, les équilibres, les rapports de force : Nkuete les traite comme des équations. Ce n’est pas un hasard si, dans la machine du RDPC, il préfère la planification à l’improvisation, la méthode à l’émotion. Derrière le militant, il y a un auteur ; derrière le stratège, un théoricien de la stabilité.
10 . Le vitiligo
Sur son visage, le temps a laissé des traces de lumière. Jean Nkuete souffre de vitiligo, cette maladie de la peau qui efface lentement les couleurs sans jamais altérer la présence. Chez lui, la dépigmentation semble presque une métaphore : celle d’un homme dont la constance a traversé les saisons politiques, sans bruit mais sans rupture.
Dans les couloirs du pouvoir, il avance comme un survivant des cycles et des hommes, transformant ses taches en symbole d’endurance. Le vitiligo ne l’a pas affaibli. Il l’a rendu plus humain, presque mystique, comme si chaque tache claire rappelait une leçon apprise dans le silence des couloirs du pouvoir : rien ne dure, sauf la discipline et la foi dans le devoir.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







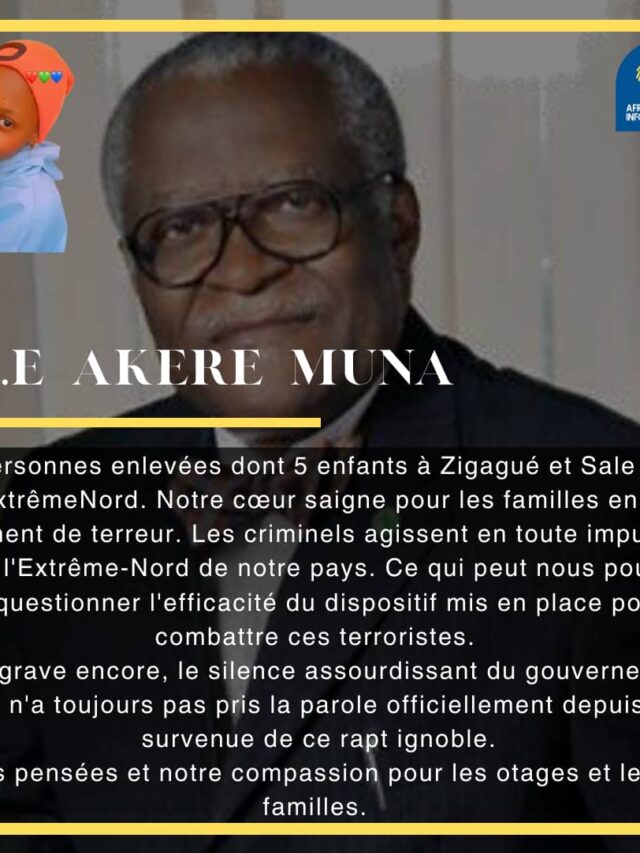
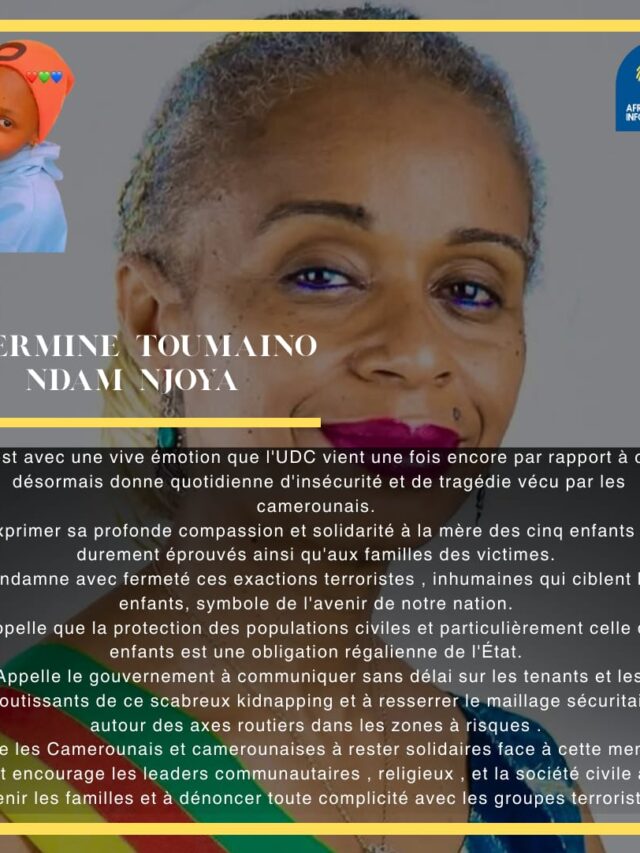
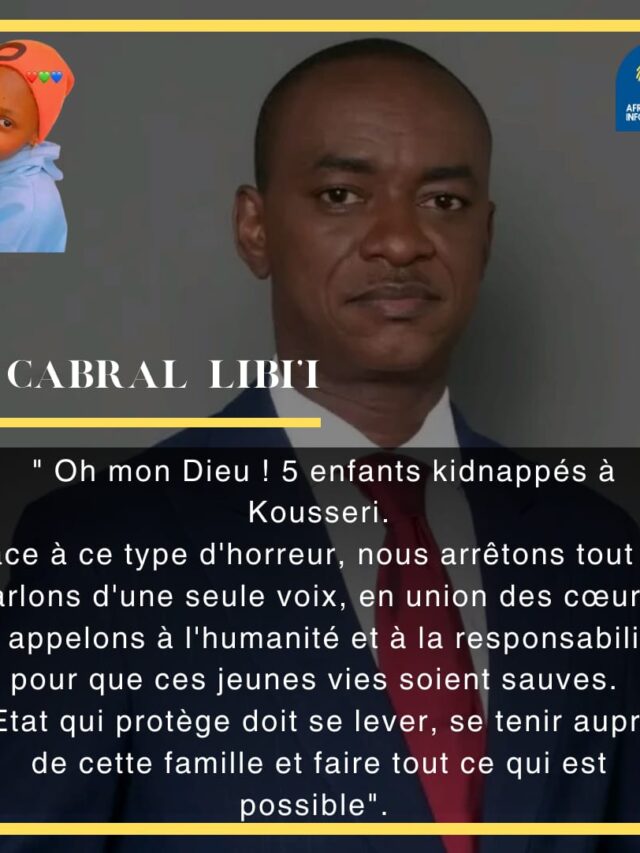
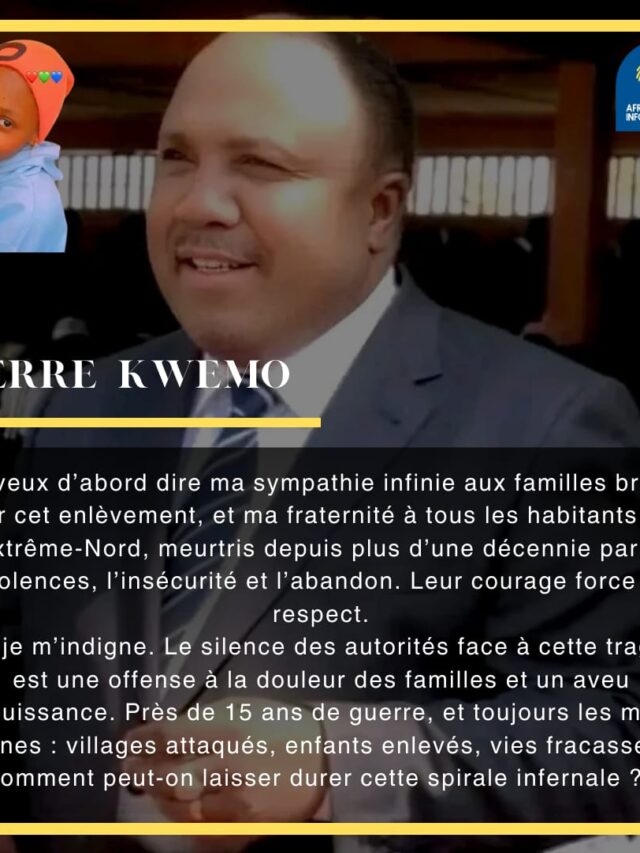
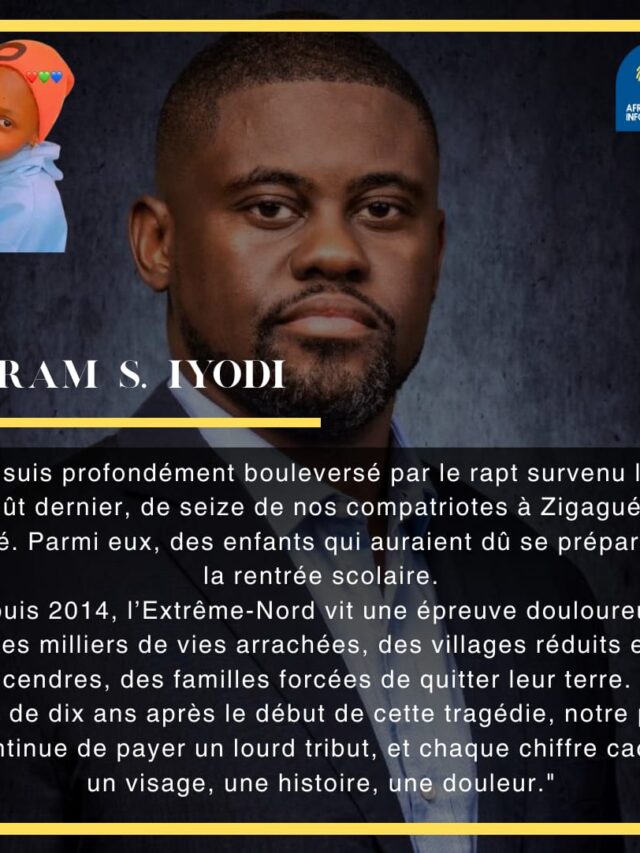
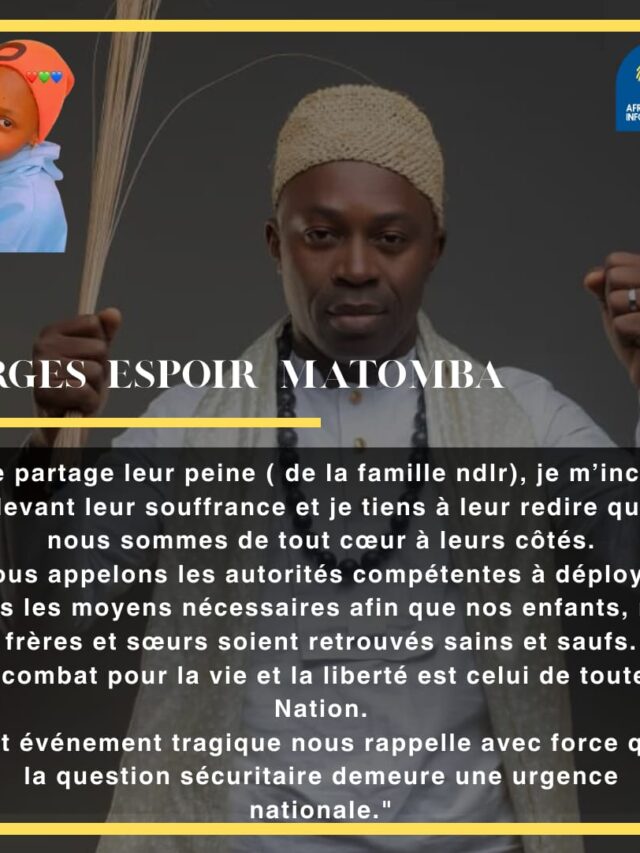
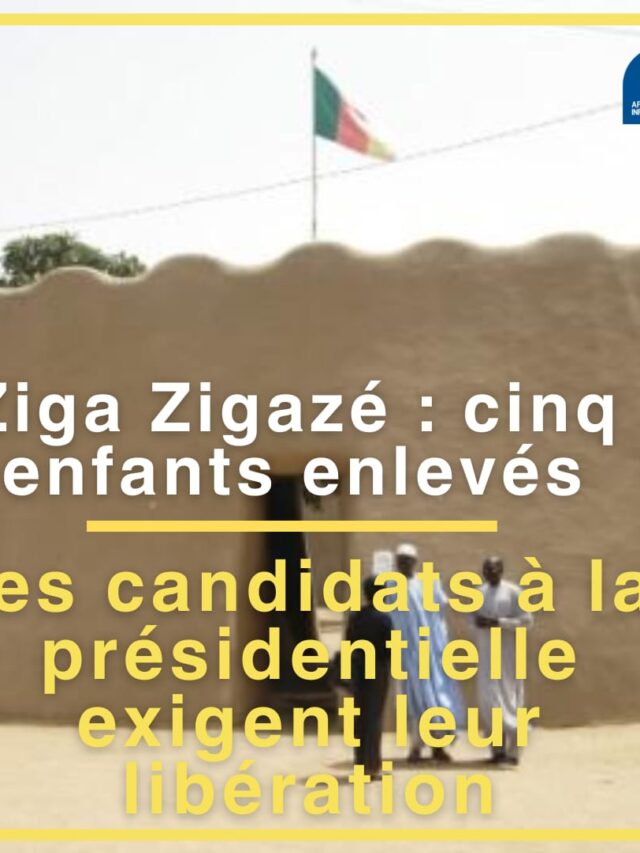
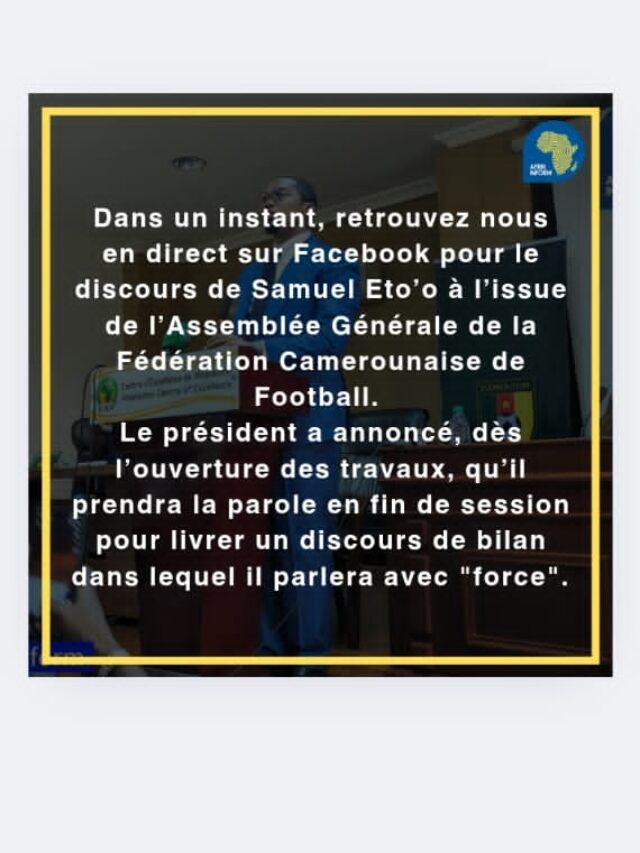
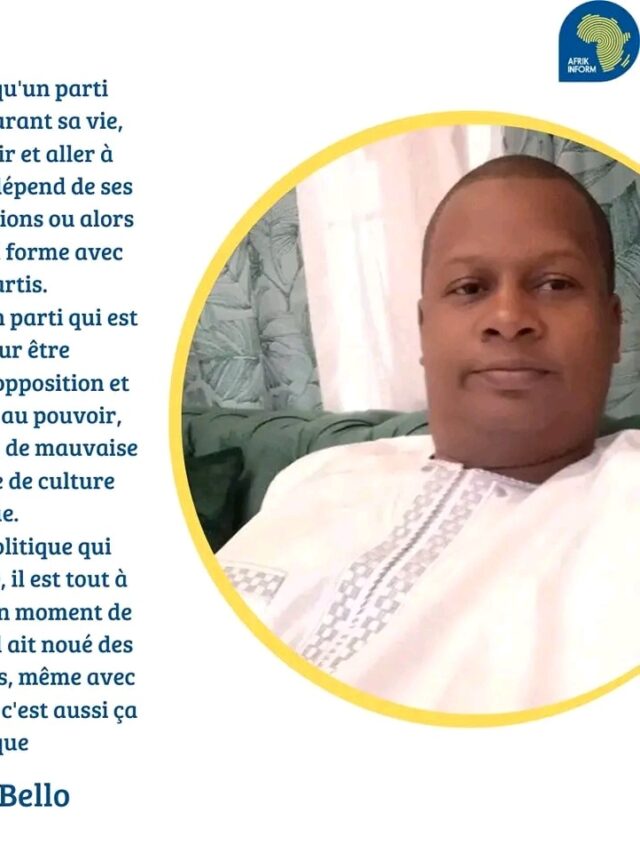



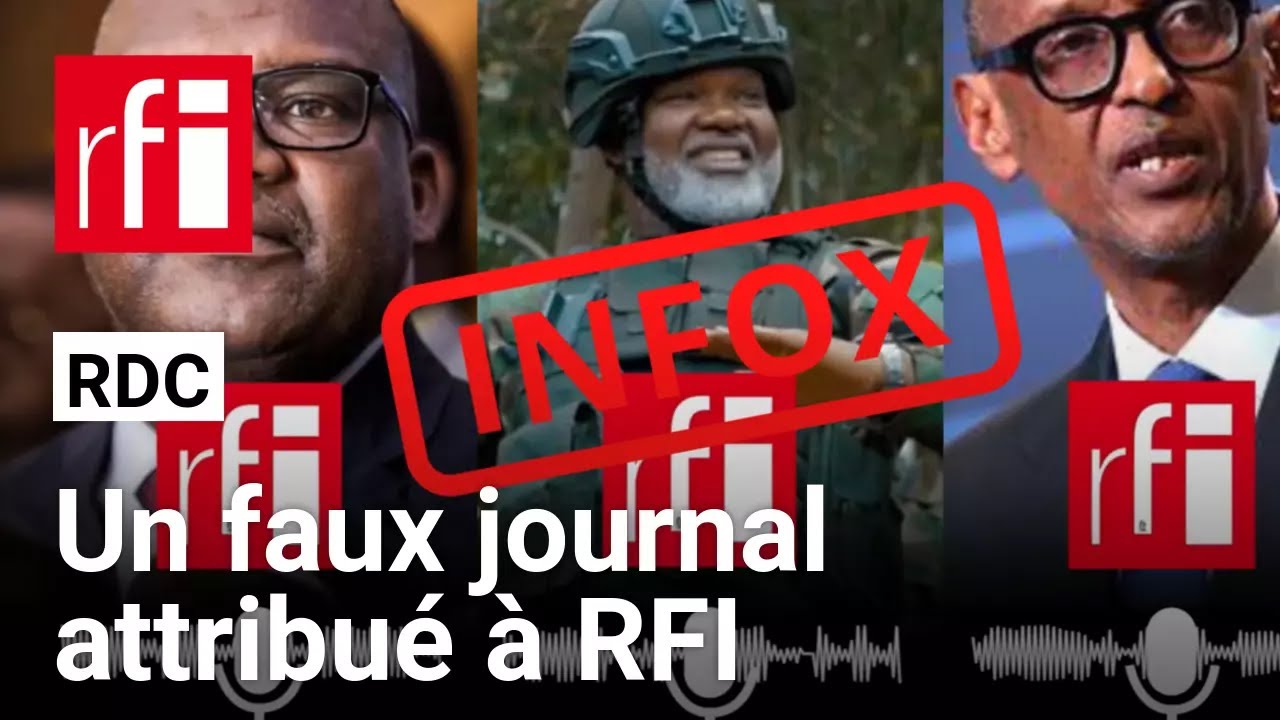

Laisser un avis