Sous les lustres du Cercle municipal de Yaoundé, la démocratie camerounaise s’est donnée rendez-vous avec ses témoins les plus discrets : les observateurs électoraux. Venus d’horizons divers, ces hommes et femmes formeront, le 12 octobre prochain, les yeux du monde sur le processus électoral. Leur rôle ? Observer, noter, rapporter — sans jamais intervenir.
Il est un peu plus de midi, le 8 octobre 2025. Dans la vaste salle du Cercle municipal de Yaoundé, baignée par la lumière qui filtre à travers les hautes baies vitrées, des chaises crème impeccablement alignées accueillent une foule attentive. Dans la salle , les gilets beiges des observateurs de l’Union africaine se mêlent aux vestes sombres d’autres délégations internationales.
À la tribune, drapée aux couleurs bleu turquoise d’ELECAM, prennent place des représentants du MINAT, du MINDEF, du MINREX et du MINCOM. À la tête de la concertation, le Directeur général des élections, le Dr Erik Essousse, s’avance, micro en main. Sa voix posée rompt le silence dans un discours message à la foule.
Des témoins, pas des acteurs
Le rôle de l’observateur électoral est d’une rigueur presque sacerdotale. Avant toute chose, il doit être dûment accrédité par le ministère de l’Administration territoriale. Son nom, sa zone d’observation — région, département, voire arrondissement — doivent être précisés noir sur blanc. Pas de déplacement libre, pas d’improvisation : la carte d’accréditation définit son territoire, et il ne doit jamais en franchir les limites.
Ce badge, qu’il portera tout au long du scrutin, devient son sésame et sa responsabilité. Sans lui, aucun accès aux bureaux de vote, aucune observation possible. Avec lui, la liberté de circuler le jour du vote, de poser des questions au président de la commission locale, ou de solliciter la protection des forces de l’ordre en cas de tension.
Mais cette liberté n’est pas sans contrepartie : elle s’accompagne de la plus stricte neutralité. L’observateur n’est ni partisan ni arbitre. Il ne parle pas aux foules, ne commente pas la campagne, n’émet pas d’opinion. Il observe sans juger, note sans influencer. Sa seule parole publique viendra plus tard, dans un rapport adressé au MINAT dans les trois mois suivant le scrutin — un document que le gouvernement lira avec attention pour en tirer des leçons sur les scrutins futurs.
Être observateur, c’est accepter de se taire là où tout le monde parle. Aucune déclaration à la presse, aucun commentaire sur les candidats ou leurs partisans. Il ne peut ni toucher au matériel électoral, ni donner d’instructions aux membres des commissions. Même un simple geste — aider à replacer une urne, orienter un électeur, donner une consigne — serait une faute.
La règle est claire : observer, et rien d’autre. L’observateur ne doit ni arborer de couleurs partisanes, ni accepter de dons, ni se prêter à quelque forme de favoritisme. Toute allégeance, même symbolique, est proscrite.
Car au Cameroun, la souveraineté de l’État prime. Les observateurs sont invités à la reconnaître et à s’y conformer. Leur mission, bien qu’internationale pour certains, se déroule sur un sol dont ils doivent respecter les lois, les coutumes et la hiérarchie administrative.
Des droits pour mieux servir la démocratie
Mais au-delà des devoirs, les observateurs disposent aussi de droits essentiels. Ils ont accès à tous les documents électoraux pertinents et peuvent assister à chaque étape du processus : la campagne, le vote, le dépouillement, la rédaction des procès-verbaux, jusqu’à la proclamation des résultats.
Ils peuvent poser des questions — avec courtoisie — au président de la commission locale. Ils peuvent circuler librement dans leur zone, accéder aux bureaux de vote, recueillir des informations officielles et bénéficier de la coopération des autorités administratives. Ces prérogatives leur permettent d’accomplir une mission indépendante et complète, sans entrave ni intimidation.
Là réside toute la force du dispositif : garantir que personne, ni électeur ni acteur politique, ne puisse prétendre que le scrutin s’est déroulé dans l’ombre.
Un équilibre fragile entre confiance et vigilance
Dans la salle, les observateurs prennent des notes avec gravité. Certains viennent du continent africain, d’autres d’Europe, d’Amérique ou d’Asie. Chacun représente une institution, une organisation, un engagement personnel envers la démocratie.
Un membre d’une mission européenne confie à voix basse : « Notre devoir, c’est d’être présents sans être visibles, de témoigner sans influencer ». Une phrase simple, mais qui résume toute la complexité de ce métier d’ombre.
Car leur mission ne s’arrête pas aux portes des bureaux de vote. Elle commence bien avant — dans la manière dont la campagne s’est déroulée, dans le ton des médias, dans la liberté laissée aux électeurs — et se prolonge bien après, dans le rapport qu’ils rédigeront, sobre, méthodique, parfois critique, mais toujours constructif.
Le dernier rempart de la confiance électorale
Alors que le scrutin du 12 octobre approche, ces observateurs deviennent les sentinelles silencieuses de la démocratie camerounaise. Leur présence rassure, même sans parole. Leurs carnets, discrets mais précis, formeront bientôt la mémoire écrite d’une journée où chaque vote comptera.
Sous la lumière dorée du Cercle municipal, ELECAM a voulu leur rappeler une vérité simple mais essentielle : la crédibilité d’une élection ne dépend pas seulement du nombre d’urnes, mais du regard honnête de ceux qui en témoignent.
Et dans ce regard, le Cameroun espère trouver, le moment venu, le reflet fidèle de sa maturité démocratique.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







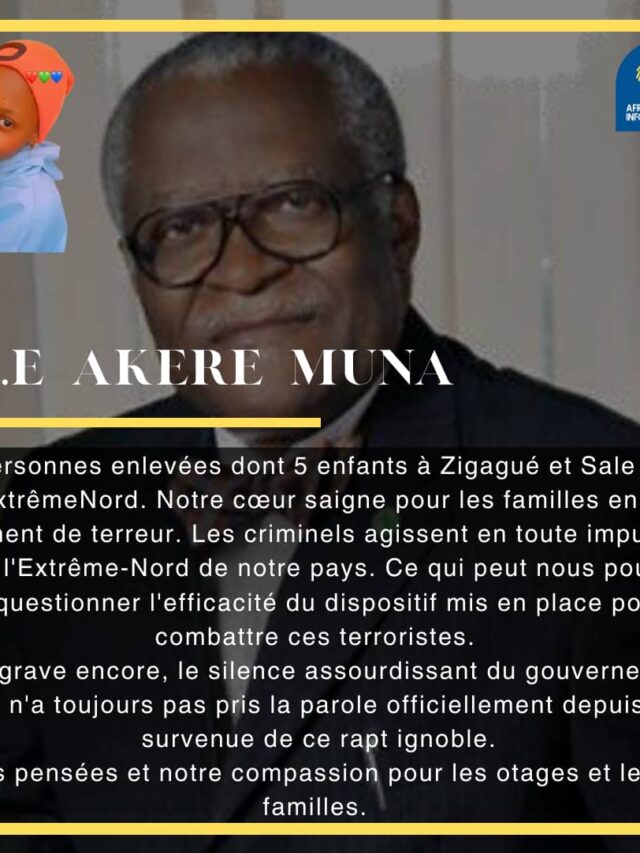
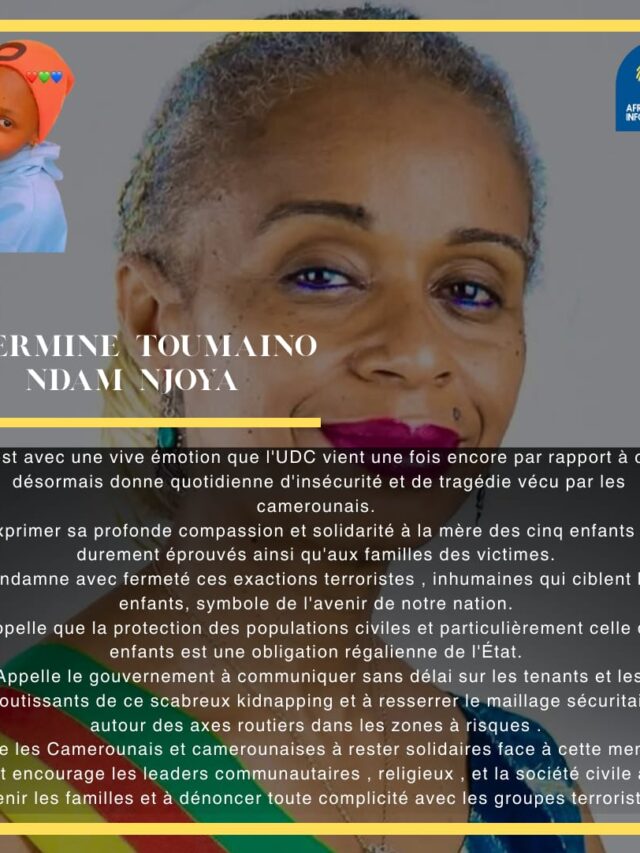
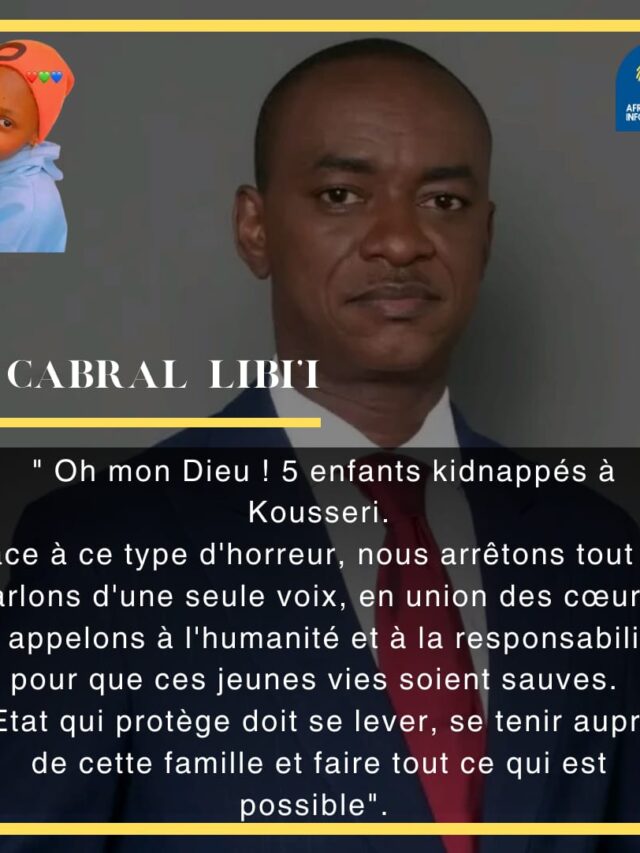
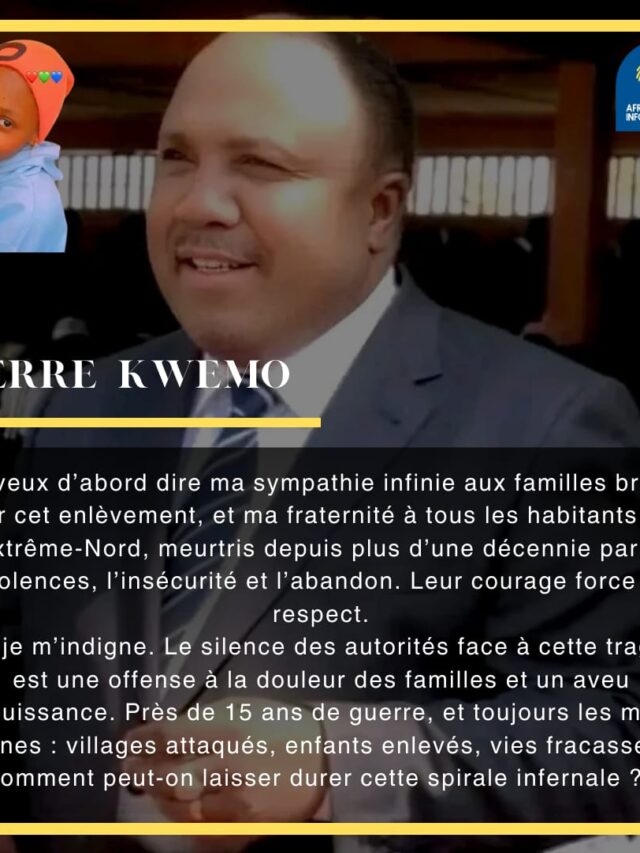
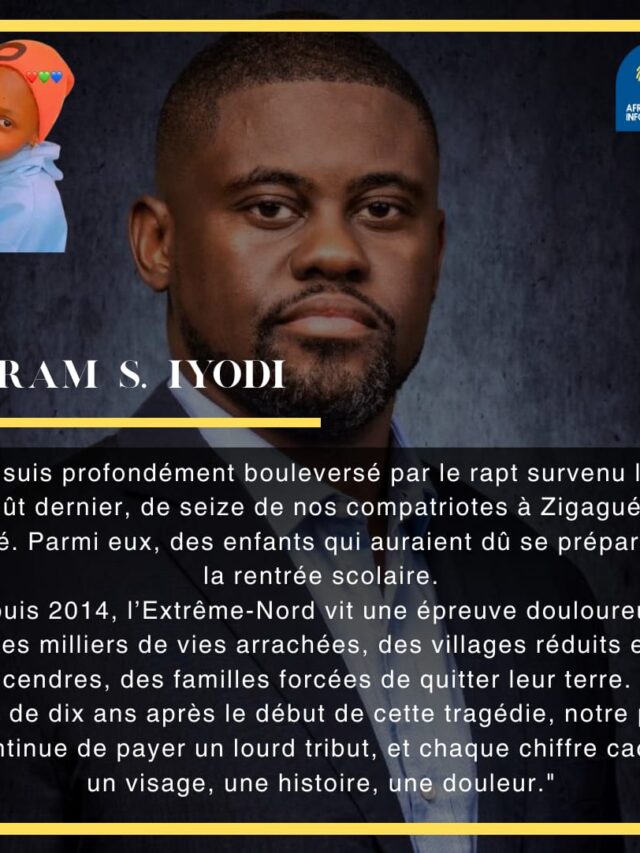
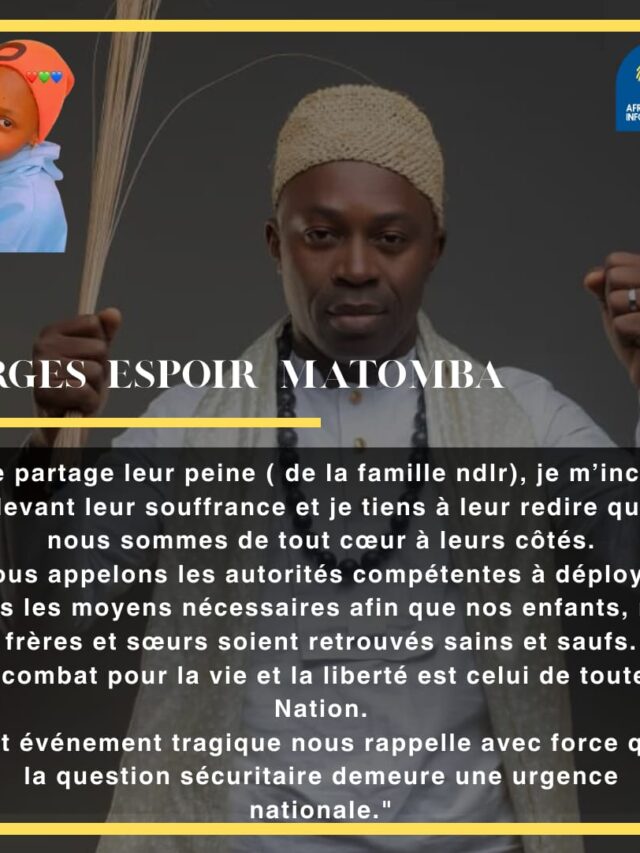
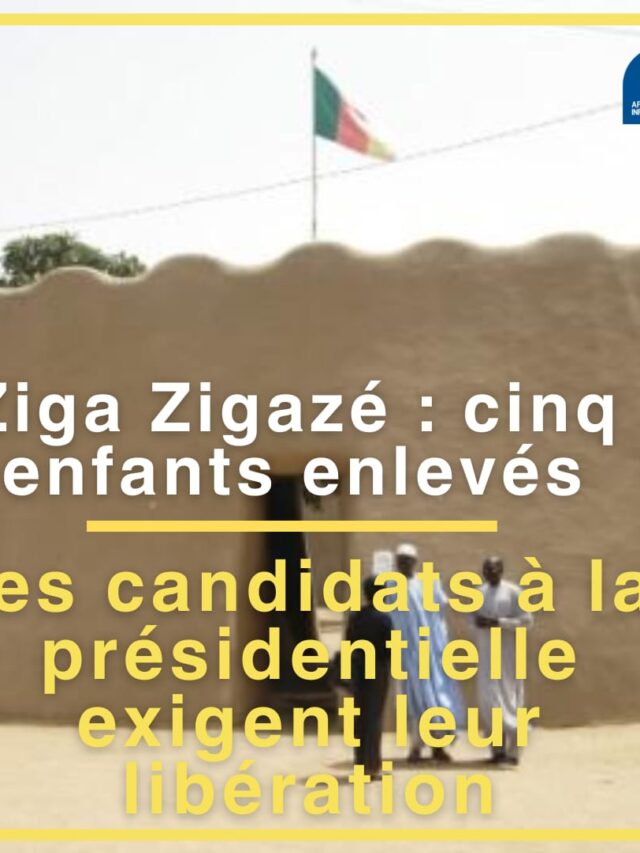
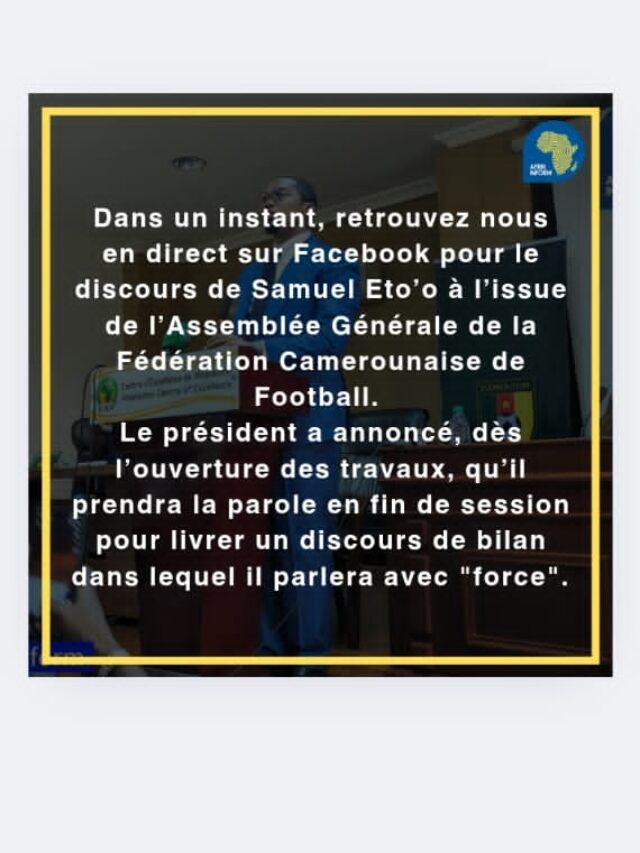
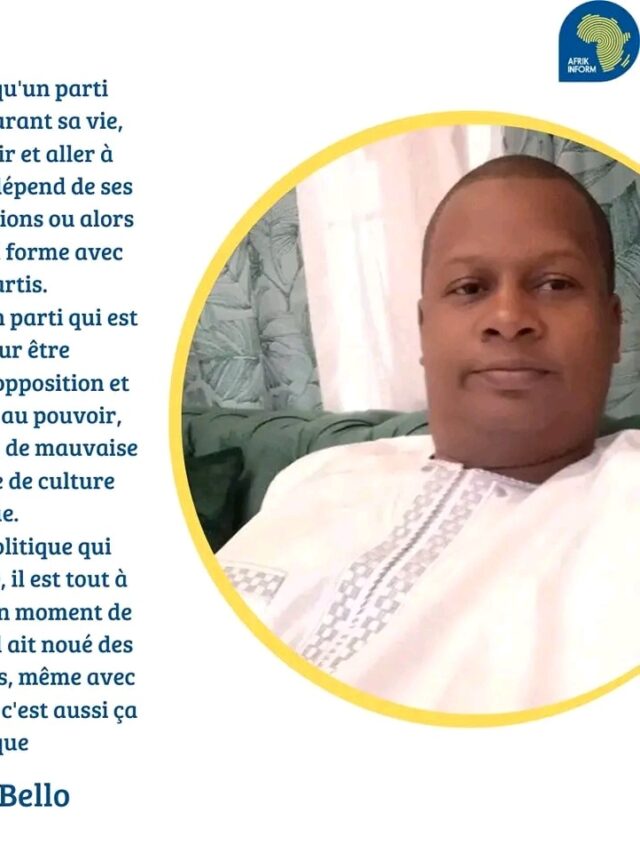





Laisser un avis