On dit parfois que certains mariages durent tant qu’on finit par confondre les époux. Il en fut ainsi pour Luc Ayang ( décédé hier ) et le Conseil économique et social (CES) : quarante-et-une années de cohabitation silencieuse, au point que l’institution et son président semblaient n’en former qu’un. Dans ce couple discret mais durable, l’un ne pouvait exister sans l’autre. Et si, derrière cette fidélité exceptionnelle, se cachait moins une histoire de pouvoir que celle d’une institution presque invisible, dont on ignore le poids réel, les décisions et l’influence ?
Une institution créée pour “conseiller”, pas pour décider
Officiellement, le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis au gouvernement sur les projets de loi et les questions d’intérêt économique ou social. Créé par la Constitution de 1972, il devait représenter la société civile organisée — agriculteurs, syndicats, artisans, industriels, intellectuels — et servir de pont entre l’État et la population active.
Sur le papier, l’idée est noble : créer un espace de réflexion pour accompagner les politiques publiques. Dans la pratique, le CES est vite devenu un organe discret, peu sollicité et rarement cité. Ses sessions se tiennent loin des caméras, ses rapports ne sont pas rendus publics, et ses recommandations, quand elles existent, restent dans les tiroirs.
Sous Luc Ayang, l’institution n’a jamais vraiment cherché la lumière. Et peut-être est-ce précisément ce silence qui lui a permis de durer.
Luc Ayang, l’homme d’un seul siège
Nommé président du CES en février 1984, Luc Ayang y est resté pendant quarante-un an, un record absolu dans l’administration camerounaise. Premier ministre sous Ahmadou Ahidjo, il avait survécu au passage de témoin vers Paul Biya et s’était imposé comme une figure de continuité. Il était le visage d’un certain style de pouvoir : fidèle, réservé, inamovible.
Au fil des années, le CES s’est confondu avec son président. L’institution a vécu à son rythme, dans une lenteur assumée, à mille lieues du tumulte politique. Dans les cérémonies officielles, Ayang représentait souvent le chef de l’État. Dans les faits, peu de Camerounais savaient ce qu’il faisait vraiment à son bureau.
« Le Conseil économique et social, c’est un peu comme un monastère administratif », ironise Jean Bewang, citoyen. « On sait qu’il existe, on sait qu’il consomme un budget, mais personne ne sait ce qu’il produit », Conclut-il.
Un budget conséquent, des réalisations discutables
L’année 2023 avait ravivé les débats autour de l’utilité du CES, après la publication d’un décret autorisant la construction d’une résidence officielle du président du Conseil pour un montant de plus de deux milliards de FCFA. Une polémique qui s’ajoutait au coût de son nouveau siège à Yaoundé — 44 milliards de FCFA, financés sur le budget public, inauguré en mars 2025.
Dans un pays comme le Cameroun ou certaines populations manquent d’eau ou de lumière , ces chiffres ont heurté l’opinion. « Le CES est un organisme fantôme qui mange des milliards chaque année », écrivait alors un média local.
Pourtant, dans les documents officiels, l’institution justifie ses dépenses par la nécessité de disposer d’un cadre de travail “à la hauteur de sa mission”. Une mission qu’aucune publication récente ne permet d’évaluer.
Un pouvoir protocolaire plus qu’influent
Quatrième personnalité dans l’ordre protocolaire de la République, le président du CES jouissait d’une position symbolique privilégiée. Il participait aux grands événements d’État, représentait le chef de l’État à l’étranger, et siégeait aux côtés du Premier ministre lors de certaines cérémonies.
Mais ce prestige restait essentiellement protocolaire. Les textes le précisent d’ailleurs : le CES n’a pas de pouvoir de contrainte. Il donne des avis, le gouvernement choisit de les suivre ou non. Et rien n’oblige ce dernier à rendre publiques les contributions reçues.
Ce constat alimente un débat plus large sur la valeur ajoutée réelle des institutions consultatives au Cameroun, souvent perçues comme des vitrines de stabilité plutôt que des acteurs de changement.
Le paradoxe d’une institution stable mais immobile
Le CES représente la stabilité de l’État camerounais, son goût pour la continuité. Mais cette stabilité a un revers : l’immobilisme.
Quarante-un an sans renouvellement de leadership, des membres rarement changés, des rapports non publiés, des budgets constants… Tout cela interroge la pertinence d’un organe qui n’a jamais été au cœur des grandes orientations nationales.
Sous d’autres cieux, les conseils économiques et sociaux participent à la définition des politiques publiques, organisent des consultations, influencent les lois du travail ou de la consommation. Au Cameroun, le CES a surtout maintenu une présence silencieuse — un symbole plus qu’un moteur.
Et maintenant ?
La disparition de Luc Ayang pose une question que le pouvoir devra tôt ou tard affronter : faut-il repenser le CES ou le laisser survivre à son créateur ?
Le moment est propice à une refondation. Donner plus de visibilité à ses travaux, rendre publics ses rapports, ouvrir ses sessions au dialogue social réel, réduire les dépenses somptuaires, et surtout, faire du Conseil un espace vivant, pas seulement honorifique.
Car à force de fonctionner dans l’ombre, le CES a fini par ressembler à son président : discret, loyal, presque effacé. Et c’est peut-être ce silence, aussi solide qu’une muraille, qui aura été sa plus grande force — et sa plus grande faiblesse.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







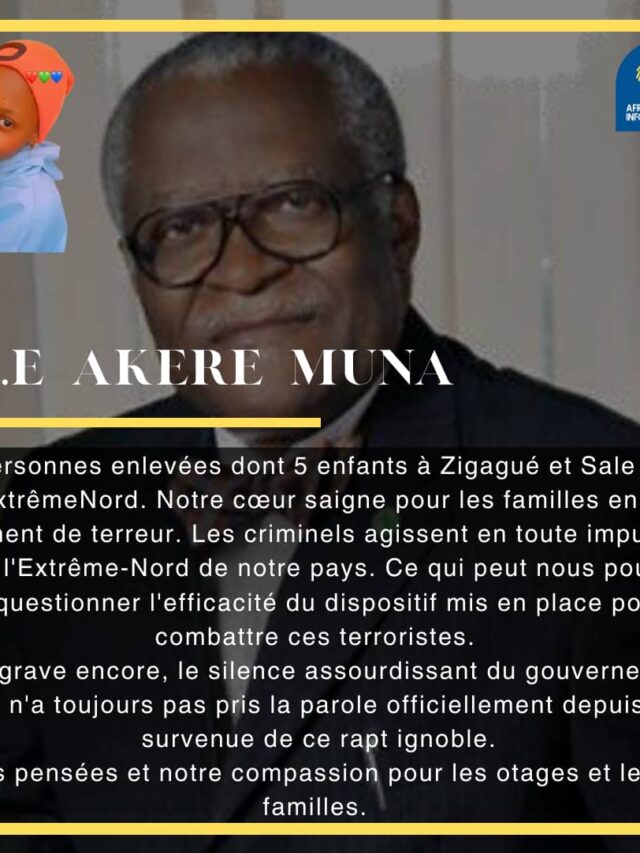
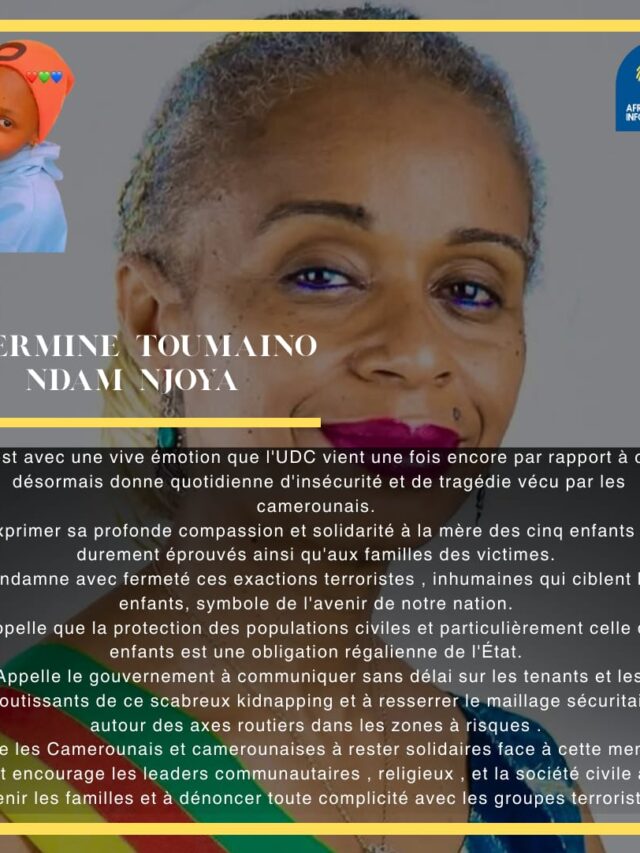
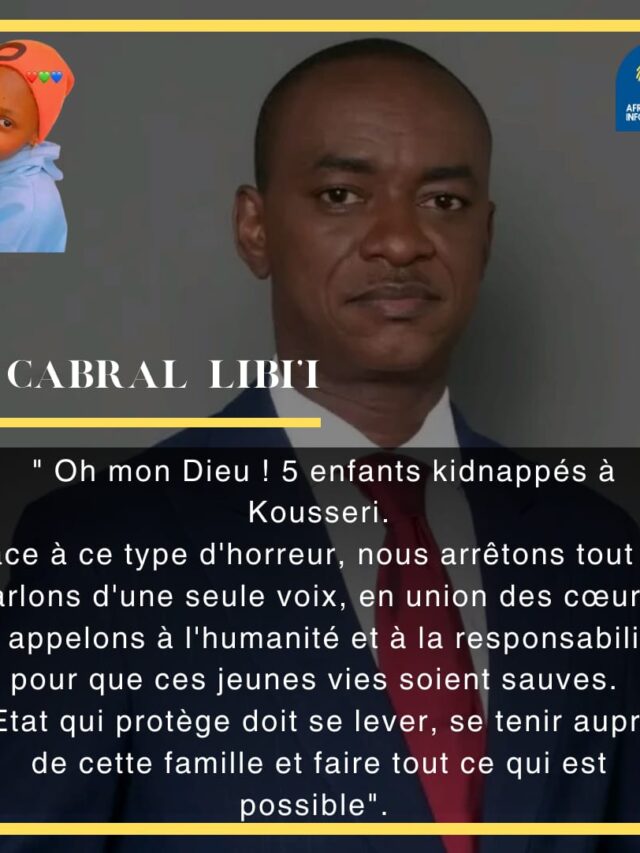
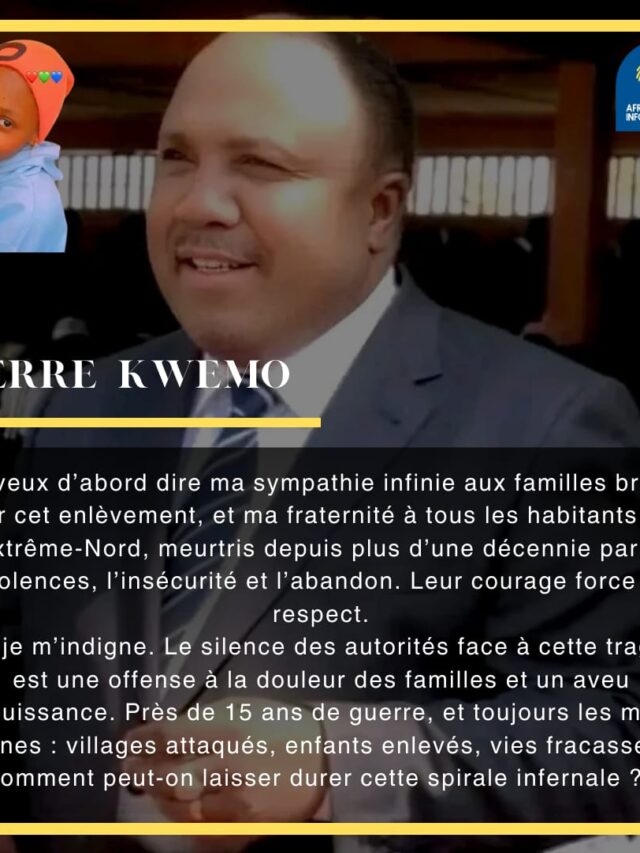
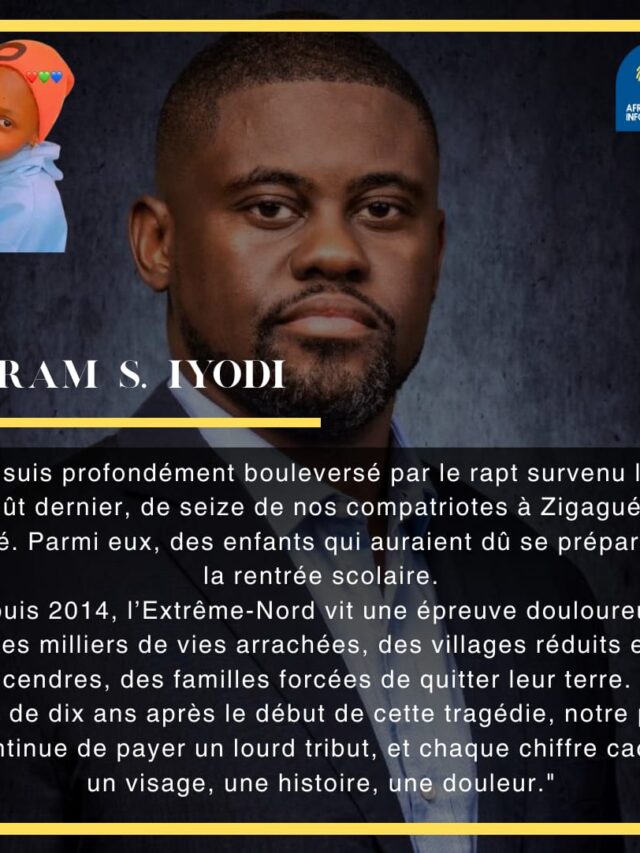
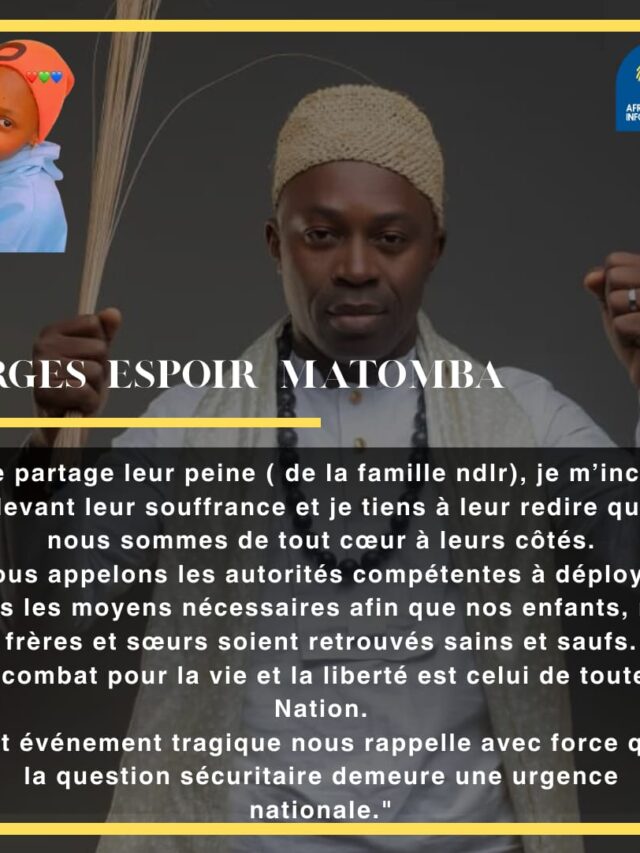
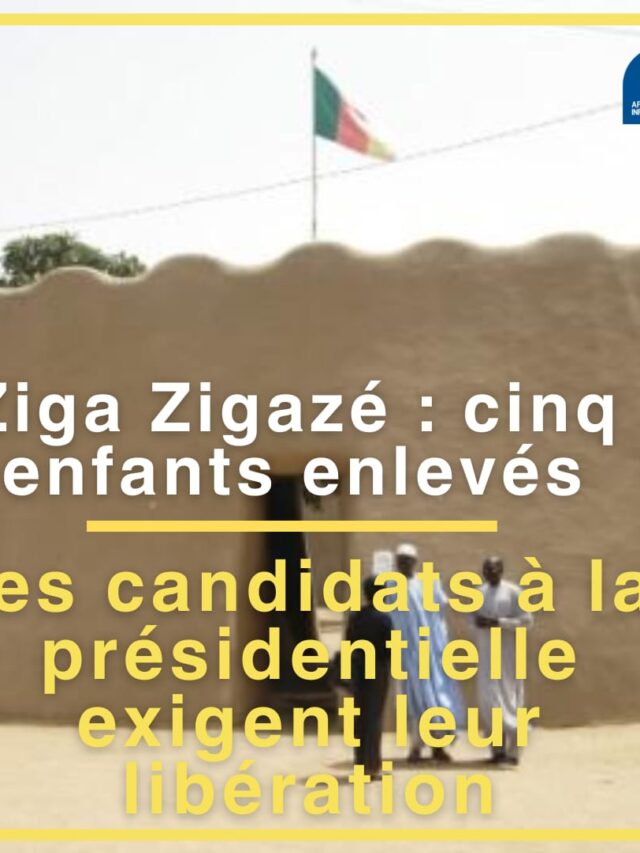
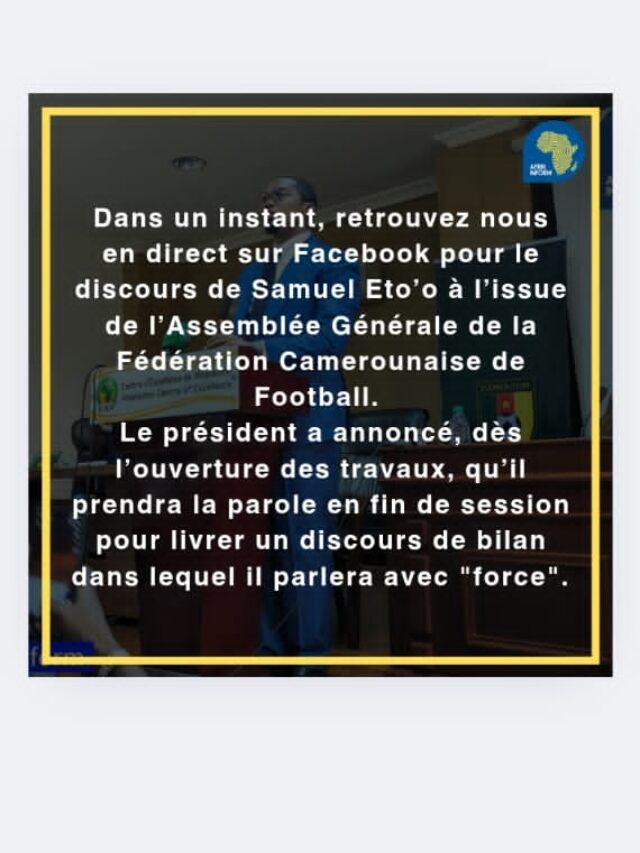
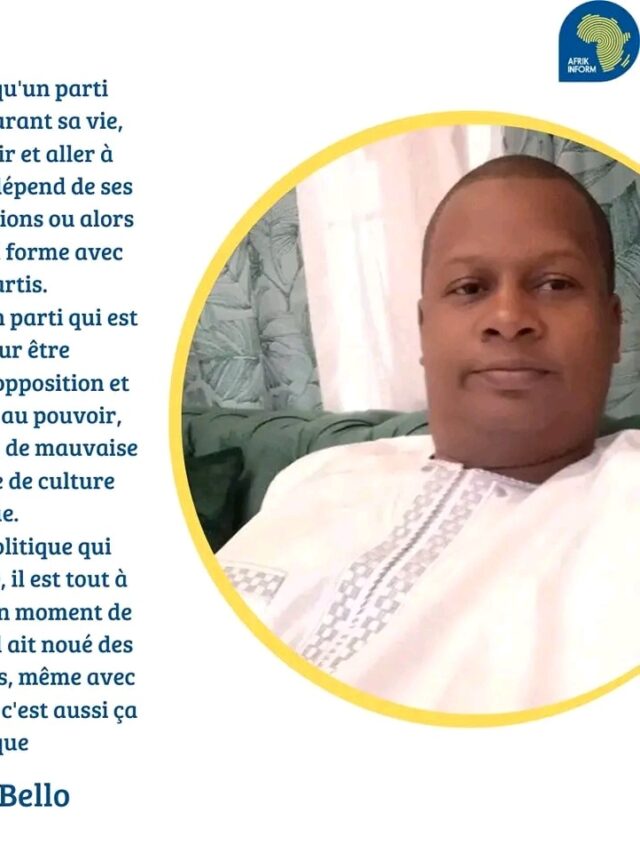




Laisser un avis