Depuis le début des échéances, Facebook n’est plus seulement une place publique : c’est l’arène, la chambre d’échos, la forge où se fabriquent soutiens, haines, rumeurs et preuves. Depuis des mois — avant même que les urnes ne parlent — un match effréné se déroule à coups de publications, vidéos et threads : cinq voix dominent la mêlée, chacune marteau-pilon d’une vérité voulue, partagée, amplifiée. Trois d’entre elles gravitent autour du pouvoir, deux incarnent la rupture depuis l’exil ou la dissidence. Ensemble, elles composent le « Game of Phones » camerounais ( nous reprenons ici l’expression de l’artiste Koppo) : un tournoi de narratives qui se joue seconde après seconde, like après like, partage après partage.
Raoul Christophe Bià : le maestro de la satire et de l’émotion
Le spectacle commence au petit matin, quand les fils d’actualité s’allument. C’est d’abord Raoul Christophe Bià : le « grand reporter » à la plume-rafale, rendu célèbre par ses chroniques satiriques, celui qui, depuis Vision 4 et ses reportages incisifs, a appris à retourner l’audience en sa faveur. Dans son espace, la stabilité et la continuité se mesurent en battements de cœur : « Paul BIYA Ayop Ayop », clame-t‑il, et le ton est donné. Ses posts enchaînent accusations, moqueries et attaques ciblées.
Il raille les « faux PV », dénonce des « laboratoires » de manipulation et taille des petites vannes qui frappent plus fort qu’elles ne semblent le vouloir : « Ceux qui n’ont pas de PV parlent alors beaucoup ein », écrit‑il, et la cour de ses partisans répond en chœur.
Raoul est l’homme des images et des effets : photos du matériel saisi chez des opposants, narrations théâtrales de perquisitions, allusions à des complots étrangers, traits d’humour acerbe sur les pourcentages électoraux — tout contribue à faire de son fil une pièce dramatique.
Il ne dort presque pas, publie « minutes après minutes », transforme chaque arrestation présumée en scène de polar et chaque preuve en preuve‑spectacle. Son ton oscille entre la confidence intime et le sermon solennel. Il décrit, raille, avertit — et fait vibrer ses suiveurs.
Bruno Bidjang : la voix de l’autorité et de la légalité
À ses côtés sur cette ligne pro‑pouvoir, Bruno Bidjang occupe le devant de la scène avec l’autorité d’un animateur‑patron de chaîne. Homme de télévision, directeur, chroniqueur : il a connu l’incarcération, la mise en accusation, puis la libération — autant d’épisodes qui nourrissent aujourd’hui son verbe dur et sa rhétorique de la fermeté. Ses publications mêlent rapports de terrain (tracts avortés, arrestations) et plaidoyers pour la paix et la légalité. Il reprend la partition de l’État : « La République ne vous laissera pas détruire le pays », assène‑t‑il, et derrière cette phrase résonne l’appel à la normalité, au refus des manipulations.
Bruno se veut le garant d’une ligne « responsable » — même si ses détracteurs lui reprochent souvent de franchir la ligne éthique. Il célèbre l’armée, félicite les forces de l’ordre pour leur « professionnalisme » face à la « provocation », et n’hésite pas à rendre hommage au chef de l’État dans des textes cérémoniels où la continuité du pouvoir est rompue à toute contestation : « Que cet hommage traduise notre profonde reconnaissance pour la continuité de votre exaltant Magistère », écrit‑il, avec la solennité d’un communiqué d’État.
Ernest Obama : le journalisme rationnel et chiffré
Ernest Obama, autre figure de Vision‑4 ( C’est d’ailleurs ça qu’il a en commun avec les deux premiers ), apporte quant à lui un style plus policé — mais tout aussi déterminé. Ancien rédacteur en chef, animateur, directeur : sa voix est celle du journalisme professionnel converti à la défense des institutions.
Il publie des bilans, des chiffres — « La vérité de la commission nationale de recensement des votes. Paul Biya : 53,66 % » — et joue la carte de la légitimité technique. Moins spectaculaire que Raoul, moins martial que Bruno, Ernest incarne la rationalité apparente d’un camp qui cherche la respectabilité par les chiffres et l’ordre.
Nzui Manto et Paul Chouta : les lanceurs d’alerte et la dissidence
Face à ce trio se dressent deux autres joueurs, tout aussi mobiles mais d’une autre trempe : Nzui Manto et Paul Chouta. Exilés, lanceurs d’alerte, opposants tenaces, ils animent l’autre versant du Game of Phones — celui de la dénonciation, de la mobilisation et, parfois, de la provocation.
D’après ses fans, Nzui Manto est profondément ancré dans le réseau de l’information camerounaise. Il est donc considéré comme l’archétype du lanceur d’alerte moderne. Défenseur des causes qu’il estime nobles, il parvient à relier anonymat et influence directe : des contacts dans l’armée, des sources fiables, des témoignages exclusifs lui donnent souvent la primeur des informations. Les révélations sur l’affaire Martinez Zogo ou celle de Bobda sont autant de preuves de son rôle central dans la circulation de l’information et de sa capacité à mettre en lumière ce que beaucoup « voudraient maintenir dans l’ombre » , d’après lui.
Très souvent accusé de diffamation, chaque publication est une démonstration de sa méthode : informer, décortiquer, recouper, exposer, attiser, provoquer, manipuler. Dans son fil, le régime camerounais apparaît toujours sous un visage noir, surtout en cette période ( de la présidentielle) : « Mes contacts au sein de l’armée camerounaise qui m’informent régulièrement de la situation au sein des forces de défense et de sécurité, des pertes en zone de conflit (Sud-Ouest, Nord-Ouest, Extrême-Nord) sont formels : les armes prétendument retrouvées hier soir chez Djeukam Kameni et Anicet Ekane appartiennent à la DGRE ! », assène t’il ce matin. Vrai ou faux ? Lui seul en est la garant.
Chaque phrase est calibrée pour révéler une stratégie, une manipulation, un mensonge orchestré : la chasse aux nordistes, la machine de propagande qui vise à diaboliser certaines communautés, ou encore l’exposition d’un profil Facebook porteur de haine et de tribalisme, lié à Ursule Medouane épouse Etoga, femme de Galax Etoga, secrétaire d’État à la Défense chargé de la gendarmerie.
Cette posture de lanceur d’alerte se traduit aussi par des confrontations directes avec d’autres figures du « Game of Phones », deja cité dans cet article par ailleurs. Ce n’est ni plus ni moins que Bruno Bidjang, défenseur déclaré des institutions, se retrouve souvent au cœur des critiques de Nzui : « Brunus ( Bruno Ndlr) Bidjang a publié une fausse information… l’image qu’il utilise date de l’année dernière », écrit Nzui, et le fil s’enflamme immédiatement. Chaque correction, chaque démenti devient un spectacle médiatique, un théâtre de la vérification instantanée où l’information se mesure à la rapidité, à l’émotion et à la force des preuves.
Bruno, de son côté, répond en plaidant pour la loyauté et la défense des institutions : « Si Madame Galax Etoga décidait de défendre le Président Paul Biya, ce serait une attitude noble, digne et exemplaire. Trop souvent, ceux qui attaquent l’État le font cachés derrière des faux profils. Alors pourquoi ceux qui aiment leur pays ne feraient-ils pas la même chose pour protéger la vérité et défendre leurs idéaux ? »
Entre dénonciation et défense institutionnelle, Nzui Manto et Bruno Bidjang incarnent la fracture d’un paysage médiatique où l’instantanéité des publications façonne l’opinion publique. L’un polarise, révèle et expose ; l’autre encadre, justifie et protège.
Paul Chouta, quant à lui, porte l’histoire d’un web‑journaliste devenu symbole : 23 mois d’incarcération pour diffamation, des interventions internationales en sa faveur, une libération qui a fait scandale — autant de cicatrices qui nourrissent aujourd’hui ses messages. Ses posts n’y vont pas avec le dos de la cuillère : « Si après 43 ans de règne tu trouves ce régime performant, RESTE CHEZ TOI », assène‑t‑il, appelant à la rue, appelant à l’action. Il met en scène la fracture, proclame la trahison, explique que l’arrestation d’un opposant n’est que la preuve d’un régime aux abois.
Interactions et confrontations dans l’arène numérique
Ces cinq voix ne s’ignorent pas : elles se répondent, se provoquent, se traduisent. Quand Bruno publie une image d’arrestation, Nzui riposte en démontrant qu’elle a été publiée « il y a 7 mois », Raoul la tourne en dérision en y voyant la main d’un laboratoire, Chouta l’utilise comme appel à la mobilisation. Koppo — l’artiste intervenant dans le débat — regarde tout cela avec mélancolie et pointe le coeur du problème : autrefois, la parole publique était portée par des figures traçables, formées, connues ; aujourd’hui un téléphone et une connexion peuvent propulser quelqu’un « Grand Reporter » et modifier instantanément la mémoire collective.
« chacun se forge sa vérité en fonction de ce qui lui apparaît le plus crédible »
Le « Game of Phones » a ses règles — et ses excès. Les armes sont la vitesse, l’émotion, l’image. Les bénéfices sont l’engagement et le contrôle des récits ; les coûts sont la polarisation, la désinformation et l’érosion des critères déontologiques. Chaque « like » devient un renfort ; chaque partage, une multiplication des troupes.
Les récits se construisent à flux tendu : plaintes d’arrestations, preuves matérielles (armes, chasubles, documents), dénonciations de comptes « trolls » ou d’épouses de hauts responsables usant de faux profils. L’accusation est outil ; la preuve, parfois, est une image recyclée. Les lignes de front bougent au gré d’une story Instagram, d’un post Facebook, d’une vidéo virale.
Pour comprendre l’impact de cette frénésie numérique sur l’opinion publique, nous avons interrogé Marie-Claire Essome, experte en communication politique : « Le problème n’est plus seulement de convaincre, explique-t-elle, mais d’imposer un rythme. Quand chaque utilisateur voit se succéder des posts chargés d’émotion et de visuels spectaculaires, l’opinion se forme à la vitesse de la notification, pas de l’analyse. La viralité prime sur la véracité, et c’est là que réside le danger : la perception des faits devient tributaire de l’effet immédiat plutôt que de la réflexion ».
À ses côtés, un journaliste d’investigation et ancien rédacteur en chef, souligne : « tout ça transforme la manière dont le public reçoit l’information. Avant, le journal imprimé ou le journal télévisé imposait une temporalité et un filtre éditorial. Aujourd’hui, l’opinion se façonne au fil des posts, des threads et des stories, souvent sans recul. On assiste à une fragmentation des faits et à une polarisation des perceptions : chacun se forge sa vérité en fonction de ce qui lui apparaît le plus crédible ou le plus engageant ».
En gros l’impact est double : le public est mobilisé et informé en continu, mais il devient aussi plus vulnérable aux manipulations et aux récits tronqués, comme si chaque like ou partage pesait plus lourd qu’un éditorial ou qu’un reportage complet.
Mais le jeu n’est pas seulement binaire. Il y a des zones grises : des partisans sincères, des professionnels qui tentent de rester alignés sur des normes, des jeunes qui se laissent instrumentaliser et d’autres qui appellent au calme. Des événements apolitiques — rassemblements de jeunesse, marches pour la paix, symposiums civiques — surgissent aussi, tantôt pour contrer l’incendie, tantôt pour apaiser. Bruno publie des comptes rendus d’initiatives citoyennes à Buea ; Koppo implore la responsabilité des « Jeunes Talents ». L’équilibre est précaire.
Redéfinir la démocratie à l’ère numérique
L’essentiel, pourtant, est ailleurs : le Game of Phones redessine la démocratie. Il transforme la manière dont la vérité se forme et circule, il accélère la mise en récit d’événements, il fait basculer la frontière entre information et théâtre. Il fabrique des héros et des boucs émissaires en trente secondes. Il mobilise, désempare, radicalise. Il donne à des figures contestées une influence décuplée, et aux institutions le défi de rester lisibles.
On peut tenter d’écrire les règles : vérifier avant de partager, rechercher la traçabilité, privilégier les sources établies. On peut aussi constater que, pour beaucoup, la traçabilité n’est plus prioritaire face à l’urgence émotionnelle du moment : un tableau dans un téléphone vaut souvent mieux qu’un reportage diffusé à 20h. Raoul le dit sans détour — « Pour être l’homme de son temps, il faut savoir vivre avec les réalités de son époque » — et c’est bien là la fracture générationnelle et médiatique qui sous‑tend tout.
L’arène numérique persiste
Le Game of Phones est une arène noire et brillante, peuplée d’anges et de démons numériques. Il ne tombera pas avec un édit de caractère. Il ne s’éteindra pas avec une seule arrestation. Il persistera, tant que l’État, les médias, les lanceurs d’alerte et les citoyens accepteront que la première vérité visible soit celle qui s’imprime la plus fort dans l’écran.
Ce soir, comme tous les autres soirs, les téléphones vibrent. Les timelines s’embrasent. Les joueurs publient, réagissent, se défendent. Les rumeurs prennent la forme de preuves ; les preuves parfois se démantelent sous le regard des mêmes foules qui les avaient acclamées. Et dans ce vacarme, la réalité, têtue, continue de se déplacer : entre la rue et l’écran, entre la mémoire et l’instantané, le Cameroun apprend, à chaque post, le prix de l’information instantanée.
Abimté pour le moment.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





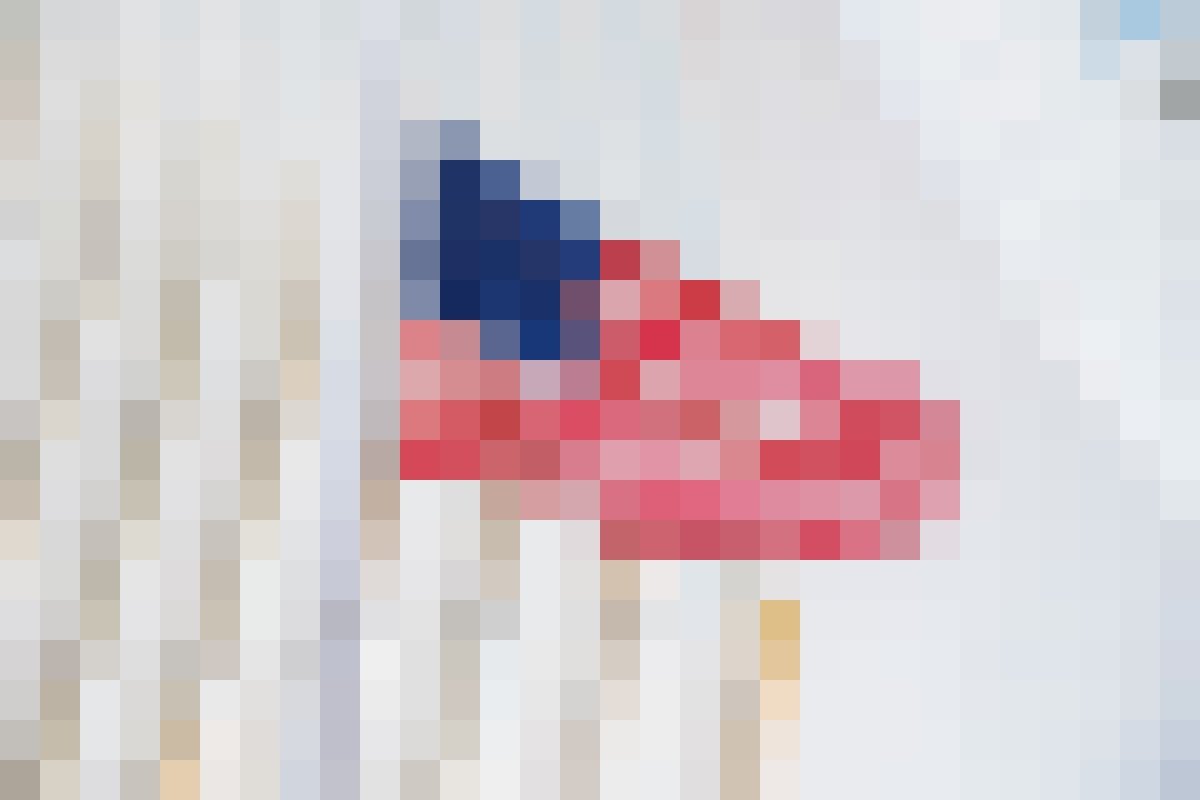



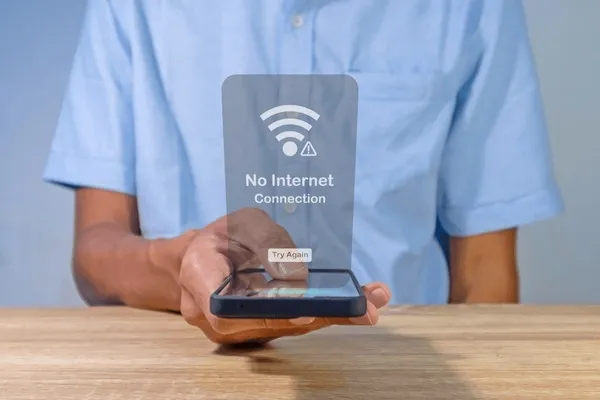

Laisser un avis