À l’École supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (Esstic), un échange d’une rare intensité oppose depuis le 25 octobre le directeur de l’institution, Pr François Marc Modzom, à l’un de ses enseignants les plus connus, Pr Baba Wamé. En toile de fond, un désaccord sur la posture de l’intellectuel face à la situation politique actuelle du pays.
Tout est parti d’un communiqué signé du Pr François Marc Modzom. Dans le document, le directeur de l’Esstic affirme que « des sources estudiantines convergentes font état de ce qu’un enseignant de l’institution, se prévalant de ses origines nordistes, distille, via les réseaux sociaux, menaces et informations mensongères sur une prétendue insécurité au sein et autour du campus ».
Le texte accuse cet enseignant — sans le nommer — de chercher à exécuter « un plan machiavélique conçu par un camp politique évoluant, depuis l’élection présidentielle du 12 octobre, en marge de la légalité républicaine ».
Le communiqué se veut ferme : « Le lundi 27 octobre sera donc une journée comme les autres », conclut le Pr Modzom, rappelant le caractère apolitique de l’école et menaçant l’auteur présumé de sanctions disciplinaires.
Cette sortie publique, inhabituelle pour une institution purement académique, a aussitôt déclenché la riposte de celui qui se reconnaît entre les lignes : le journaliste et enseignant Baba Wamé, connu pour ses prises de position franches sur les libertés publiques et la déontologie médiatique.
« Du berger à la bergère »
La réplique cinglante de Baba Wamé ne s’est pas faite attendre. Dans une lettre ouverte adressée au directeur, l’enseignant dénonce « une stigmatisation identitaire dont nous devrions tous, en ces temps troublés, nous abstenir ». Il rappelle au patron de l’Esstic le « réflexe élémentaire de recouper l’information à sa source », insinuant que le communiqué repose sur des rumeurs plutôt que sur des faits.
Plus encore, il accuse le directeur d’avoir franchi la ligne rouge de l’éthique universitaire : « Il n’appartient pas à une institution telle que celle que vous dirigez d’attiser des divisions communautaires par des prises de position précipitées ».
Et la réplique prend une dimension juridique . « Je me réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires pour ce que la loi qualifie de désinformation», écrit t’il. Ayant pris attache avec lui, Baba Wamé a transmis à la rédaction d’Afrik Inform une analyse détaillée des vulnérabilités juridiques du communiqué du directeur. Selon lui, ce dernier présente plusieurs failles au regard du droit camerounais, allant bien au-delà d’une simple querelle de campus.
L’enseignant pointe d’abord la stigmatisation identitaire, dénonçant la mention explicite de ses « origines nordistes » comme un acte susceptible de constituer un outrage à tribu au sens de l’article 241-1 du Code pénal camerounais, ainsi qu’une infraction à la loi sur la cybercriminalité (article 164). Il relève également une dénonciation calomnieuse et une diffusion de fausses nouvelles, le directeur accusant l’enseignant de participer à un « plan machiavélique » politique sans preuve tangible, ce qui pourrait tomber sous le coup des articles 154 du Code pénal et 3 de la loi sur la cybercriminalité.
Baba Wamé évoque ensuite une atteinte à l’honneur et à la réputation via des termes tels que « indiscipline » et « manœuvres indignes », ainsi qu’un manquement à l’éthique et à la déontologie journalistique, le directeur ayant rendu l’affaire publique sur la base de simples « sources estudiantines » sans vérification rigoureuse.
Pour l’enseignant, ces éléments ouvrent la voie à des poursuites judiciaires, avec une feuille de route incluant la consolidation des preuves, la mise en demeure, et l’exploitation de témoignages attestant de l’impact du communiqué sur sa réputation.
L’escalade verbale
Loin d’apaiser les tensions, cette réponse semble avoir ravivé la colère du directeur. Dans un nouveau mot, François Marc Modzom s’adresse directement à son collègue, cette fois en le citant : « Je ne tomberai évidemment pas dans le piège grossier et pitoyable d’un affrontement personnel. Vous parlez de stigmatisation identitaire, soit. Mais vous ne faites point mystère de vos prises de position et de votre alignement politique et identitaire ».
Le ton se durcit : le directeur accuse Baba Wamé d’« usurper sa posture d’enseignant des TIC pour infiltrer les forums d’étudiants et y glisser des alertes visqueuses et malhonnêtes », évoquant une « attitude empreinte de ruse et de malhonnêteté ».
Dans une phrase lourde de sous-entendus, il conclut : « Sachez simplement que vous êtes désormais mis à nu, et, pour l’honneur, à défaut de respecter la légalité républicaine, laissez nos enfants faire l’école ».
Baba Wamé, l’apaisement par le mot
Face à cette charge, Baba Wamé choisit de ne pas envenimer davantage le duel. Sa seconde lettre, plus courte, sonne comme une mise au point : « Vous sembliez si désireux d’exprimer ce qui l’a finalement été, que j’imagine le soulagement qui doit aujourd’hui être vôtre ».
Il insiste à nouveau sur le caractère stigmatisant des propos de son supérieur et revendique une intention morale : « J’ai simplement souhaité en appeler à votre conscience pour qu’elle juge de la maladresse commise. L’essentiel est désormais acquis : mon message a rempli son office », affirme t’il .
Une façon élégante de refermer la polémique, tout en laissant à l’opinion universitaire le soin d’en tirer les leçons.
Quand l’éthique universitaire se heurte au contexte politique
L’échange Modzom–Wamé ne se résume pas à une querelle d’ego. Il illustre une fracture entre deux conceptions de la parole publique. D’un côté, une autorité administrative soucieuse de préserver l’image et la neutralité d’une institution purement académique. De l’autre, un enseignant qui revendique le droit de questionner, même au prix de la controverse.
Comme le soulignait le théoricien canadien de la communication Marshall McLuhan : « La communication est la peinture de la société ». Cette observation prend tout son sens lorsque l’on considère le duel épistolaire opposant deux figures majeures de l’école journalistique, qui illustre avec acuité les contradictions profondes du Cameroun contemporain : un silence institutionnel imposé qui se heurte aux élans de parole cherchant à se libérer et une paix affichée mise à l’épreuve par les frustrations qui bouillonnent sous la surface.





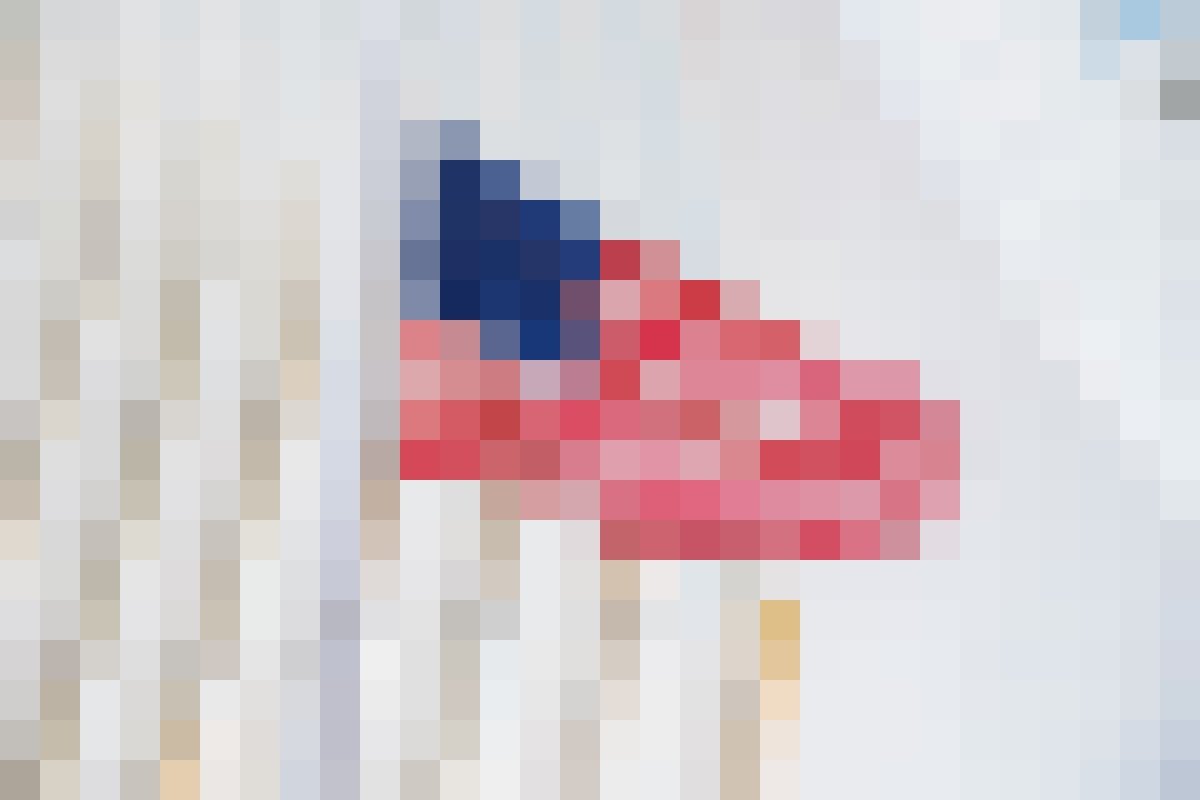



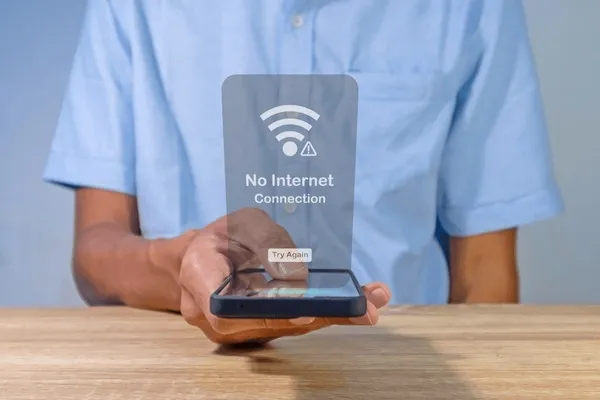


Laisser un avis