L’annonce de la candidature de Paul Biya à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, officialisée dimanche 13 juillet sur son compte X, marque le début d’une nouvelle séquence politique pour le Cameroun. À 92 ans, le chef de l’État sortant brigue un huitième mandat.
Mais plus que sa longévité, c’est désormais la cohésion du parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), qui attire l’attention. Car pour la première fois depuis des décennies, le parti présidentiel fait face à des tensions internes visibles, à des départs significatifs, et à des interrogations sur sa capacité à mobiliser comme par le passé.
Ruptures dans les rangs : simples diversions ou signaux faibles ?
Dans les semaines ayant précédé l’annonce du président Biya, deux figures politiques issues de la majorité ont officialisé leur propre candidature à la présidentielle : Issa Tchiroma Bakary, ministre de l’Emploi et leader du FSNC, et Bello Bouba Maïgari, président de l’UNDP et ancien allié de longue date du régime.
Longtemps présentés comme des soutiens inconditionnels du chef de l’État, leur entrée en lice a été perçue par certains observateurs comme une forme de désolidarisation partielle du socle présidentiel. Si leurs partis ont toujours conservé une existence propre, leur proximité historique avec le RDPC – traduite par des alliances gouvernementales successives – a longtemps entretenu une apparence d’unité.
S’agit-il pour autant de ruptures stratégiques profondes ou de repositionnements tactiques à l’intérieur d’un champ politique balisé ? La réponse reste nuancée. Ni l’UNDP ni le FSNC ne se sont désolidarisés formellement du cadre républicain fixé par le pouvoir. Et aucune attaque directe n’a été formulée à l’endroit du président sortant.
Ce qui laisse penser à des candidatures autonomes mais non hostiles, dans un esprit de diversification du jeu sans confrontation frontale.
Le rôle des barons : stabilité ou rivalités internes ?
Dans les coulisses du pouvoir, plusieurs figures emblématiques du système Biya continuent d’exercer une influence déterminante. Parmi elles, Ferdinand Ngoh Ngoh, ministre d’État, secrétaire général à la présidence, souvent décrit comme l’un des hommes les plus puissants du régime actuel.
Son rôle, à la fois administratif et politique, en fait un point d’équilibre délicat entre fidélité au président et gestion pragmatique des équilibres internes. D’autres personnalités – à l’instar de Cavaye Yéguié Djibril, Marcel Niat Njifenji ou encore Laurent Esso – incarnent la continuité du vieux système, même si leur poids électoral réel varie selon les régions.
Ces figures centrales assurent une certaine stabilité institutionnelle, mais leur position pourrait également freiner le renouvellement attendu par une partie des militants à la base, notamment chez les jeunes cadres du parti. Certains évoquent en interne une forme de “fatigue stratégique”, liée au fait que le RDPC repose encore largement sur les mêmes visages depuis plusieurs décennies.
Le test des régions : le RDPC peut-il toujours mobiliser ?
C’est sur le terrain que se jouera l’essentiel. En 2018, le RDPC avait démontré sa capacité à mobiliser ses militants dans la quasi-totalité des régions du pays, à l’exception de certaines zones affectées par la crise anglophone. Mais sept ans plus tard, le paysage a changé.
Dans plusieurs circonscriptions, des mouvements internes se sont fait jour, traduisant une volonté d’émancipation locale face aux appareils centralisés. Dans certaines communes, des militants contestent les investitures imposées “par le haut”. Dans d’autres, la dynamique de campagne dépendra fortement de la situation sécuritaire, notamment dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.
Mais malgré ces défis, le RDPC conserve un maillage territorial dense, une base militante fidèle, et une capacité logistique éprouvée. Malgré la non tenue régulière de ses congrès, la structuration de ses sections dans chaque arrondissement, et la mise en place de relais de proximité aident à lui conférer un avantage stratégique dans un pays où les campagnes se font autant sur le terrain que sur les réseaux sociaux.
Un parti face à son avenir
À travers cette nouvelle candidature de Paul Biya, le RDPC engage aussi un pari sur lui-même. Un pari de cohésion, d’endurance et de mobilisation. Mais aussi un pari sur la capacité à maintenir une unité de façade dans un contexte où les signaux de fragmentation commencent à apparaître.
L’histoire du parti présidentiel s’est construite sur un équilibre entre centralisme, loyauté au chef, et ancrage local. Ce modèle a permis de gagner toutes les présidentielles depuis 1992. Mais face aux mutations sociales, aux aspirations de la jeunesse, à la montée des discours alternatifs, ce modèle est désormais mis à l’épreuve.
À l’aube du scrutin d’octobre, la question n’est plus seulement de savoir si Paul Biya peut être réélu. Elle est de savoir si le RDPC peut encore, comme autrefois, encadrer, canaliser et contrôler l’ensemble du jeu politique sans se fissurer. Et si, derrière la force d’un homme, le parti est prêt à affronter l’usure du temps.
Afrik inform ☑️
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







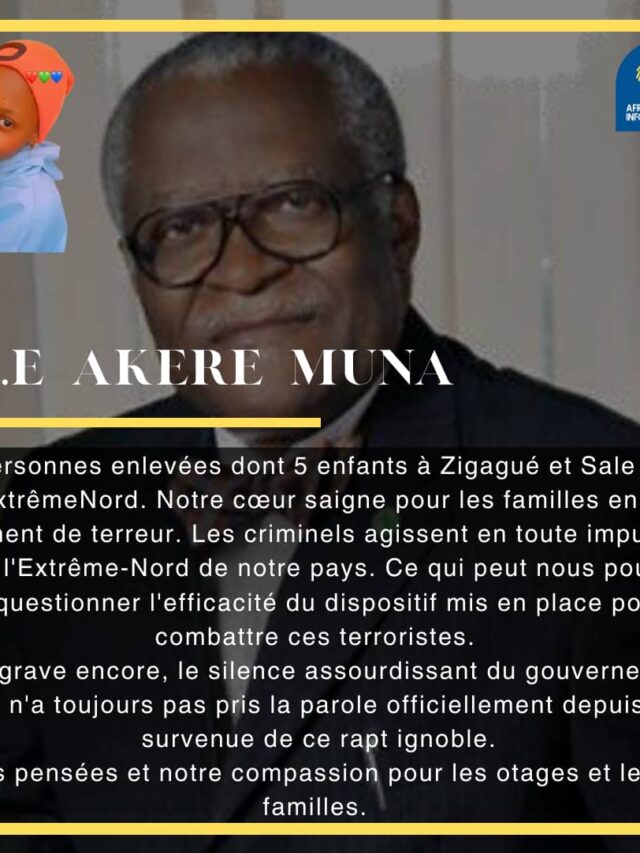
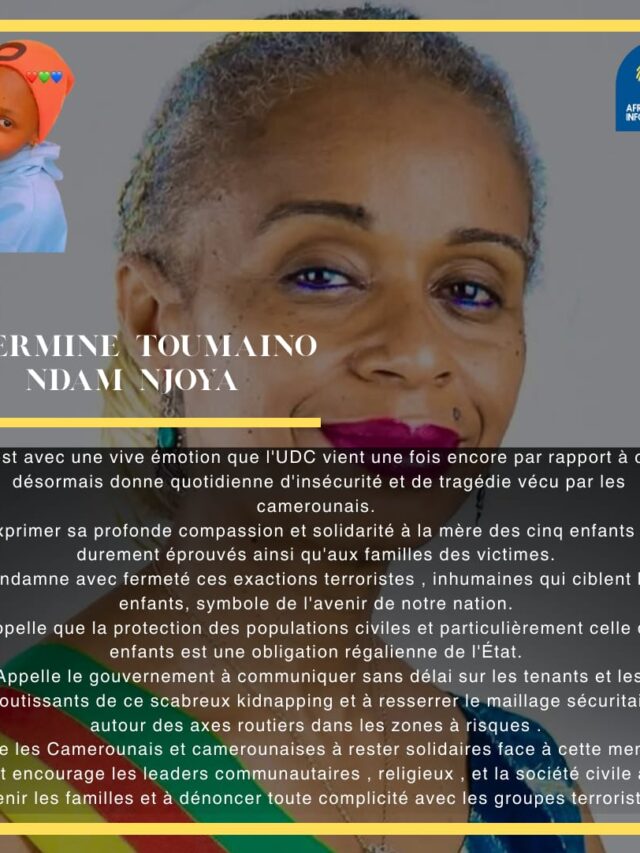
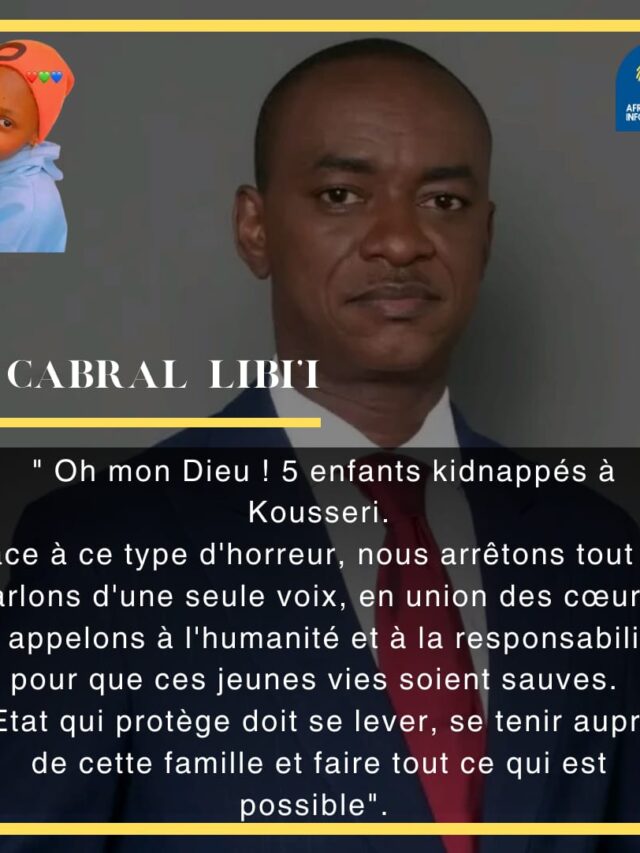
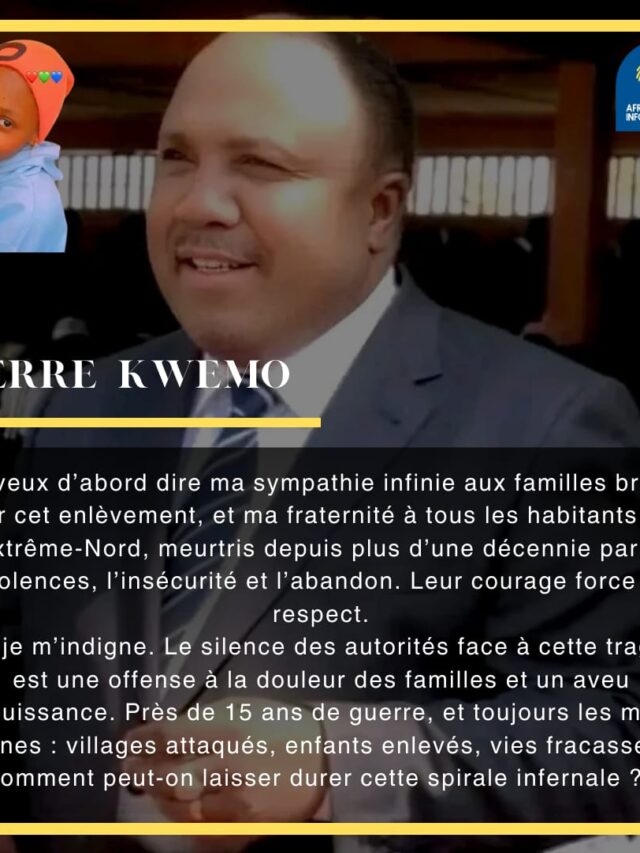
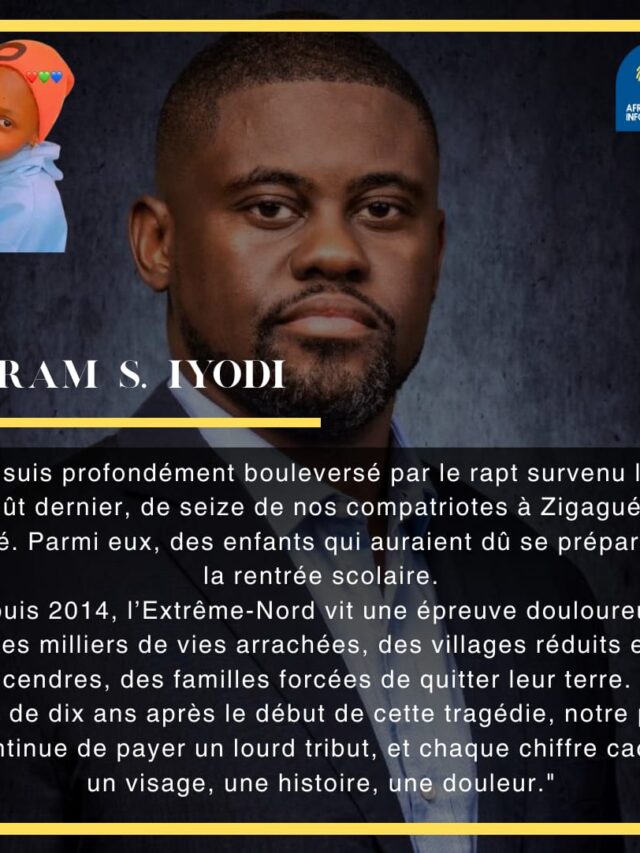
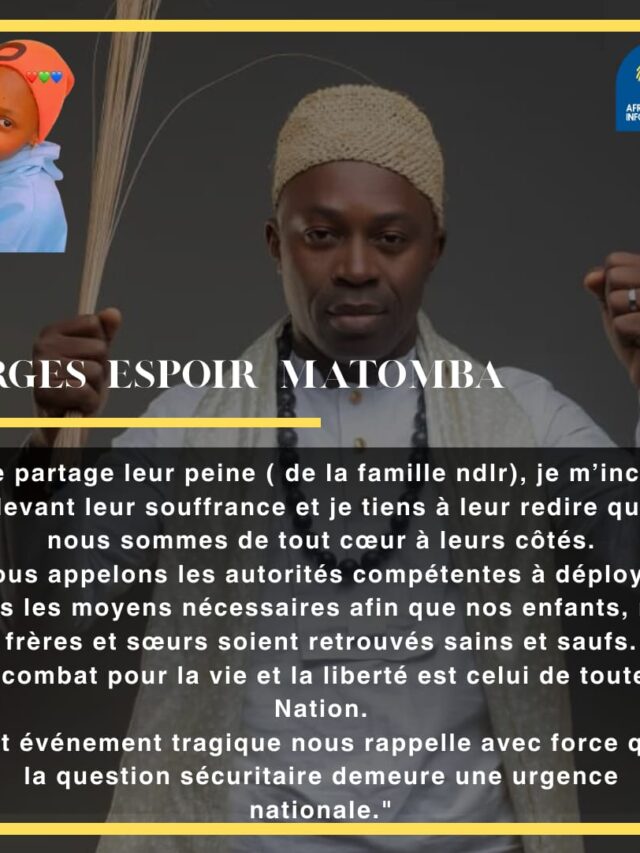
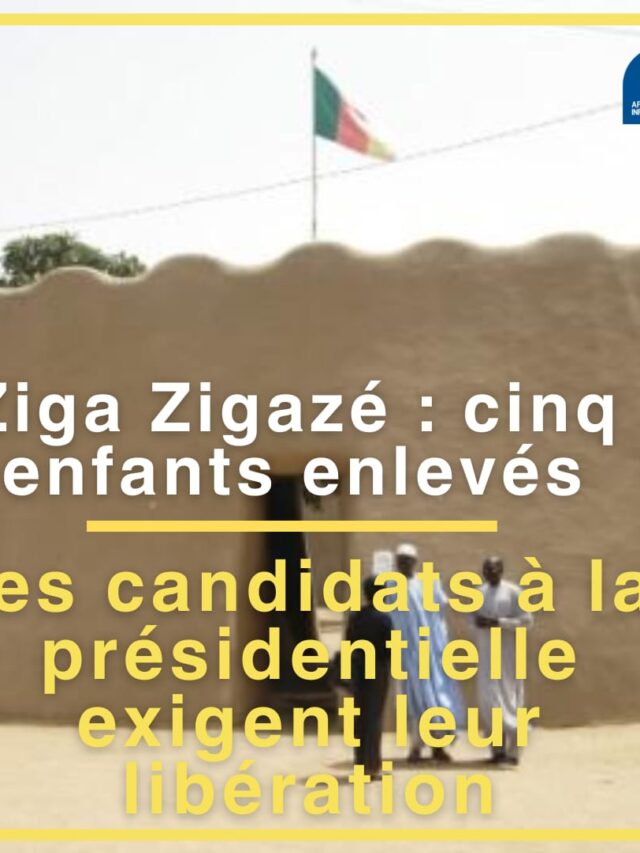
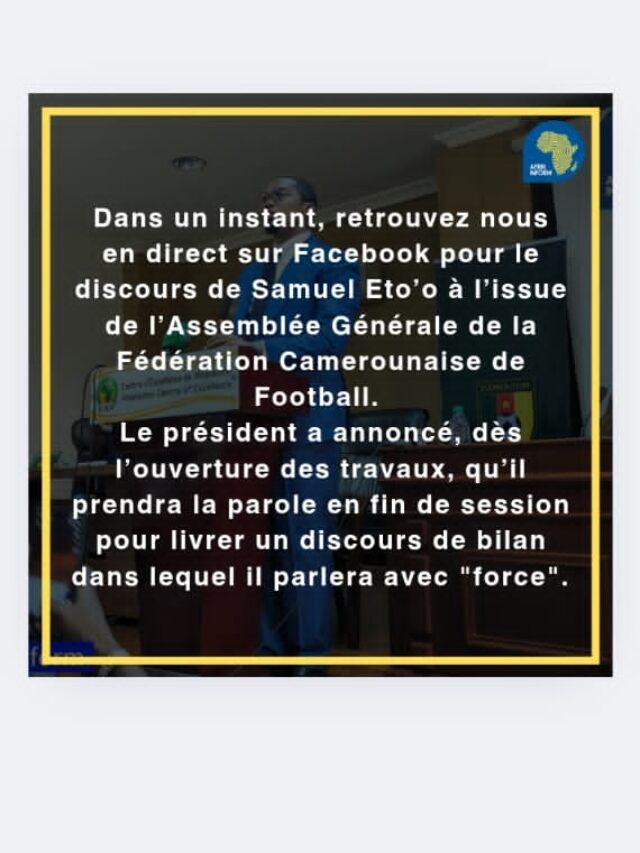
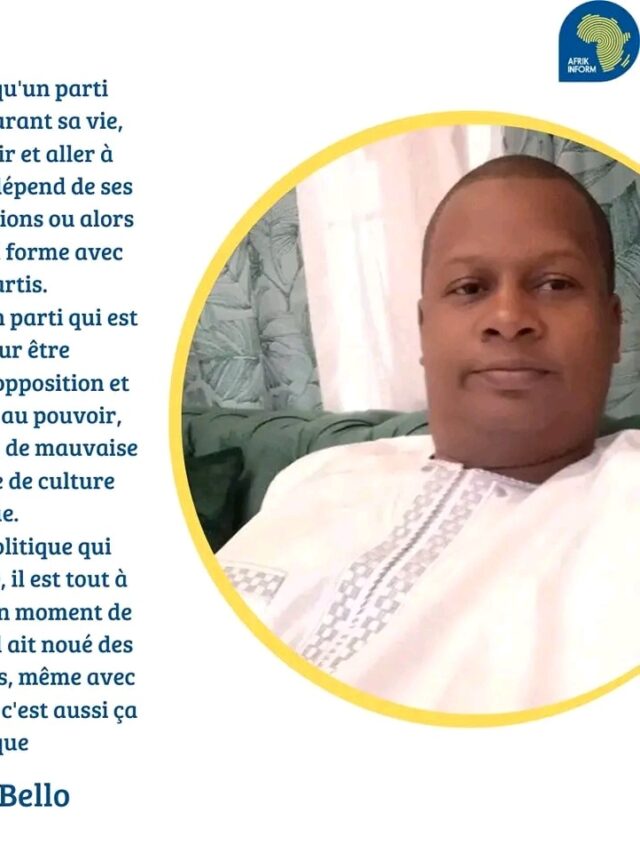

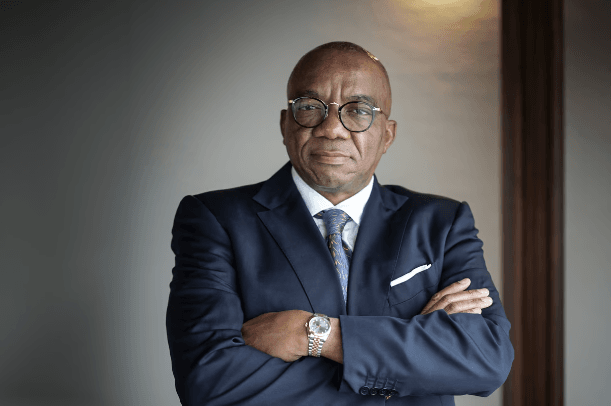







Laisser un avis