Dans une lettre dâune rare intensité, le journaliste camerounais Ãric Chinje livre une analyse au vitriol de la décomposition du paysage médiatique national. Au cÅur de sa charge : la montée en puissance des influenceurs et « faiseurs dâopinion », ces figures hybrides qui parlent fort, frappent vite, mais rarement juste.
Dans un pays où la vérité se négocie, le spectacle a remplacé le souci du factuel, et lâinfluence a supplanté lâinformation. En creux, Chinje appelle à une reprise en main du récit collectif par ceux qui savent encore ce que veut dire « chercher la vérité ».
La parole journalistique prise en otage
« Nous avons abdiqué. Nous avons laissé lâespace public à des individus sans formation, sans repères, mais pleins dâambition et de décibels ». Cette phrase dâÃric Chinje résonne comme un acte dâaccusation. Depuis quelques années, le terrain du journalisme camerounais est devenu un champ de bataille où les journalistes formés croisent le fer â ou plutôt le micro â avec une nouvelle génération de âfaiseurs de vacarmeâ.
Ces influenceurs, chroniqueurs autoproclamés, Youtubeurs ou encore animateurs de Facebook Live, occupent désormais le haut de lâaffiche. Leurs vidéos sâéchangent à la vitesse de la lumière, leurs propos deviennent viraux, et leurs surnoms sâimpriment dans lâimaginaire populaire. Mais derrière cette présence numérique massive, quelle part de vérité, quelle rigueur, quelle responsabilité ?
Lâérosion de la crédibilité
Chinje dénonce une mutation pernicieuse : « Les journalistes sont désormais identifiés à ces individus qui sâexpriment sans filtre, sans éthique, souvent sans preuve, et qui prétendent parler pour le peuple».
Un amalgame qui fragilise la crédibilité même de la profession. La confusion est telle que le public, en quête de repères, finit par mettre sur le même plan un rédacteur dâenquête chevronné et un influenceur qui accumule les directs rageurs depuis son salon. Or, comme le souligne Chinje, le journalisme nâest pas une succession de coups de gueule : câest une méthode, un code, un devoir de vérité.
Entre applaudissements et allégeances
Mais pourquoi ces voix si bruyantes trouvent-elles autant dâécho ? La réponse tient en partie à lâéconomie de la visibilité. Sur les réseaux sociaux, plus un propos est clivant, plus il circule.
La nuance, elle, fait rarement le buzz. Ajoutez à cela une variable politique et vous obtenez une équation explosive : certains influenceurs deviennent des armes de propagande, des mercenaires numériques, grassement rémunérés pour défendre un agenda. « Il est aujourdâhui possible dâacheter une opinion, de louer une indignation, ou de faire taire une critique », avertit Chinje.
La parole publique est donc monétisée, biaisée, pervertie. Elle ne répond plus à lâintérêt général, mais à des intérêts privés. Le citoyen, lui, navigue à vue dans ce flot ininterrompu de désinformation, de règlements de comptes et de manipulations.
Une génération sans mémoire ?
Eric Chinje semble porter un regard inquiet â mais pas désespéré â sur la jeunesse médiatique actuelle. Il ne la condamne pas en bloc, mais lui tend un miroir déformant, comme pour lâamener à réfléchir. « Cette génération croit que faire du bruit, câest faire de lâimpact. Elle oublie que le silence dâun bon reportage vaut parfois plus que cent diatribes».
Il évoque ces jeunes qui se sont jetés dans le journalisme sans boussole, parce que câétait tendance, parce que ça offrait des likes, pas parce que ça servait la vérité.
Reconquérir le récit national
Face à cette situation, Chinje nâappelle pas à lâexclusion des influenceurs, ni même à la censure. Il lance plutôt un défi aux journalistes : reprendre lâinitiative, regagner le terrain perdu, réinvestir lâespace public avec rigueur et courage.
Cela suppose un renouveau éthique, une exigence de formation, un refus clair de toute compromission. Cela suppose aussi de reconstruire un lien de confiance avec les citoyens, non pas en hurlant plus fort que les autres, mais en disant plus vrai.
Dans cette lettre, plus manifeste que complainte, le journaliste chevronné trace une ligne de feu. Dâun côté, ceux qui servent la vérité, quitte à être oubliés ; de lâautre, ceux qui servent le spectacle, quitte à trahir lâessentiel.Il conclut sans appel : « Nous devons cesser dâêtre les amuseurs publics de la politique camerounaise. Le journalisme nâest pas une scène. Câest un socle ».
Un socle fissuré, mais quâil nâest pas trop tard de restaurer à condition de retrouver le courage de dire « non », quand tout le monde applaudit.
Constantin GONNANG, Afrik inform âï¸
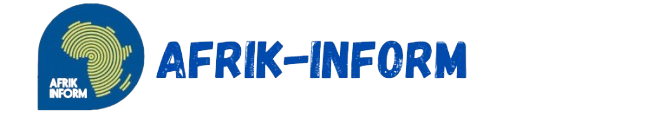

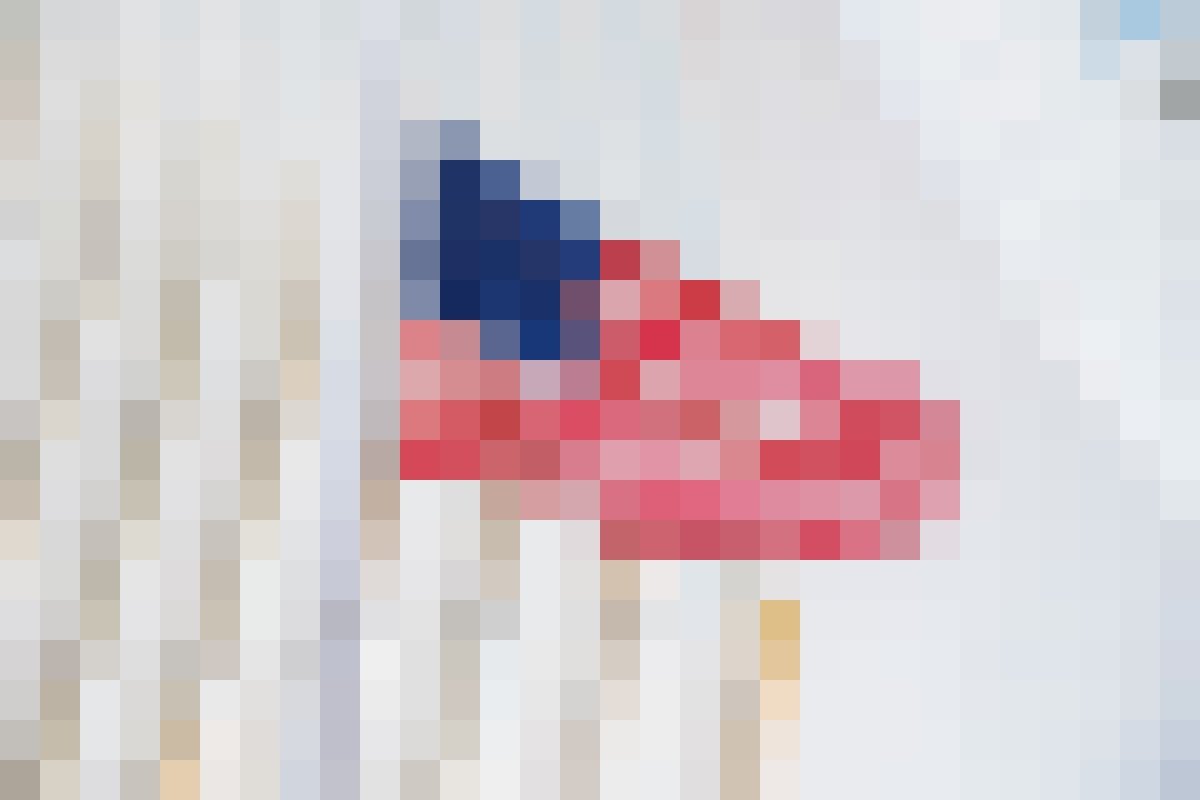















Laisser une réponse