Le Silence de Yoko : avril 1984, quand le Cameroun vacillait
Dans la nuit du 5 au 6 avril 1984, le Cameroun bascule. À Yaoundé, des éléments de la Garde républicaine tentent de renverser Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Les combats durent plusieurs jours, la riposte loyaliste l’emporte, et s’ensuit une purge : arrestations massives, exécutions rapides, état d’urgence. Les estimations du bilan varient de 71 morts (version officielle) à près de 1 000 selon certaines sources ; 35 condamnés sont exécutés et plus d’un millier de personnes arrêtées dans les semaines suivantes. En réalité, ces chiffres sont à multiplier par cinq.
Au cœur de cette tempête, un nom : Issa Tchiroma Bakary, ingénieur civil à la Régifercam. Arrêté à Douala le 16 avril 1984, sans preuve, victime de sa seule origine nordiste, il est transféré à Yaoundé, puis à Yoko ; il devient l’un de ces « corps à punir » d’un régime qui terrorise pour survivre. La prison de Yoko — l’oubli, la faim, la peur — est un gouffre.
Des récits évoquent des humiliations et des tortures ; certains détails circulent sans preuves publiques vérifiables et doivent être tenus pour allégations, tant qu’aucune source solide ne les établit. Comme ce colonel A.E qui aurait ruiné plusieurs fois dans sa bouche. Mais Tchiroma ne cède pas. Il endure. Il survit.
Dans l’obscurité de sa cellule, il apprend l’anglais, préparant déjà sa future incarnation politique. Son corps peut être brisé, mais son esprit demeure vif et intact. Il s’astreint à un travail intérieur — apprendre, structurer sa pensée —, prêt à une seconde naissance qui ne s’affichera pas en martyre, mais en capacité à transformer.
Cette résilience silencieuse deviendra la marque de fabrique d’un homme qui refuse la victimisation permanente. L’essentiel demeure : plus de six ans de détention arbitraire, puis la sortie de l’ombre au tournant du multipartisme. En 1984, on a voulu l’enterrer ; en 2025, il propose d’enterrer la haine.
Le retour du supplicié : de la prison au pouvoir
Le vent tourne. 1990 : libéré (non gracié). Il entre en politique, stratège plus qu’idéologue. À l’UNDP de Bello Bouba Maïgari, il devient député, puis ministre des Transports (1992–1996) dans un gouvernement de cohabitation informelle où l’opposition entre à l’exécutif.
Le paradoxe choque : comment un torturé par le système peut-il le servir ? Trahison, compromission… ou tactique de survie dans un univers où la pureté idéologique est un luxe mortel ? Survivre n’est pas trahir : c’est rester debout le temps de réparer.
L’activisme des années 2000 : le cheminot qui devient chef de file
Après 1996, Tchiroma ne disparaît pas. Il multiplie les initiatives, puis fonde en 2007 le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), se présentant comme troisième voie entre le RDPC et une opposition qu’il juge trop clivante.
La décennie 2000–2009 est décisive : fronts communs avec l’opposition contre la révision constitutionnelle de 2008, arrestations de leaders, violences et bilans mortifères (40 morts selon l’État, environ 100 selon des ONG). La contestation mêle colère sociale et refus de la suppression de la limitation des mandats.
Cette période est cruciale dans la construction de son identité politique. Il côtoie et collabore avec les principales figures de l’opposition : Ni John Fru Ndi (SDF), Adamou Ndam Njoya, Anicet Ekane, Maurice Kamto. Tchiroma, orateur précis, devient ce paradoxe vivant : l’ancien supplicié parlant de paix, de stabilité, de dialogue.
Il sait « où sont les corps », mais refuse de gouverner à la pelle et au règlement de comptes. Entre le cri des vaincus et le confort des vainqueurs, il a choisi la voix utile.
Le ministre de la Parole – Édition illimitée : le mégaphone en chef du président
Après sa traversée du désert, il revient en 2009 et décroche le micro… pardon, le ministère de la Communication. Traduction claire : porte-voix en chef de Paul Biya et vitrine officielle du gouvernement. Pendant dix ans, Tchiroma occupe la scène, projecteurs pleins feux, service après-vente inclus.
Il se taille une réputation au chalumeau : défenseur intraitable du régime, météo-parole 24/7. Canicule politique, orages sociaux, coup de froid institutionnel ? Il annonce « éclaircies », parfois même un grand soleil, depuis l’œil du cyclone. On a vu naître un genre : le tchiromisme, l’art de transformer un incendie en courant d’air.
À qui conteste, il réplique, l’œil qui ne cille pas : « Quand je parle au nom du gouvernement, je dis les faits. » Sous-titre implicite : les faits version officielle — nuance discrète, mais vous savez… discrète.
Son passé de cheminot n’a jamais été loin. La parole publique, il l’a traitée comme une voie ferrée : pas de déraillement visible, même si les wagons grinçaient. Dossier brûlant, polémique à vif, rumeur en cavale : on remet la ligne, on resserre les boulons, on fait siffler la loco et on arrive à quai. Timing serré, voix posée, sourire de commande.
Résultat : dix ans de conférences, de contorsions rhétoriques et de « précisions utiles ». Le pays l’écoute, l’admire ou le siffle. Lui, imperturbable, déroule le script et improvise quand le script prend feu. « Le job de sa vie » ? Disons un CDI avec l’Histoire : une décennie à vendre la météo depuis la tour de contrôle. On peut ne pas aimer la musique. On doit reconnaître l’endurance de l’orchestre.
Le Cameroun en 2025 : une société à la recherche de son âme
Le « Dossier Tchiroma » est donc lourd : récits de tortures, silences tenaces. Pourquoi n’a-t-il jamais cherché vengeance ? Parce qu’il tient la survie pour condition de l’action juste. La question demeure : s’il « prenait tout », y aurait-il chasse aux sorcières ?
Pourtant, certains y voient plutôt un trait d’union : Nord/Sud, victimes/bourreaux, mémoire/avenir. Le refus de la revanche ouvre la réconciliation nationale. Les irréductibles hurlent à la connivence et sabotent sa campagne ; d’autres murmurent que sa candidature est le coup d’un prince machiavélique.
Mais les signes de fin de cycle s’accumulent : le système qui l’a instrumentalisé pourrait se dévorer lui-même. Et Tchiroma, plébéien qui connaît la maison des horreurs, devient pour beaucoup le compromis raisonnable — le cheminot capable d’éviter au train Cameroun la catastrophe finale.
Quarante et un ans après le putsch manqué, le pays est fracturé. Paul Biya (92 ans) vise un huitième mandat pour l’élection du 12 octobre 2025 ; la scène est saturée d’« opposants principaux » aux profils variés. Le Cameroun est une société à l’âme tourmentée.
L’économie stagne, le chômage des jeunes atteint des niveaux catastrophiques, la crise anglophone déchire le pays depuis 2016. Le pouvoir d’achat s’effondre, les services publics sont en ruine, et la corruption a gangrené les structures de l’État.
La jeunesse — qui n’a connu qu’un seul président — réclame un horizon. Les données 2024 montrent une aspiration massive au changement parmi les jeunes en Afrique, avec des niveaux d’inquiétude très élevés au Cameroun (jusqu’à 84 % préoccupés par les dérives de gouvernance, la corruption, etc.).
L’ambiance est au ras-le-bol, et des voix religieuses s’autorisent des appels au changement et à une transition responsable dans la perspective du scrutin.
Dans ce contexte de désillusion généralisée, Issa Tchiroma apparaît comme une figure paradoxale : ancien de l’appareil, victime du même appareil, cheminot de formation (culture du réseau, de l’aiguillage) — bref, l’homme qui peut changer de voie avant le déraillement définitif. Le Cameroun n’a pas besoin d’un héros : il a besoin d’un aiguillage.
Le Programme de transition : quand la mémoire devient projet
Sa campagne ne vend pas des miracles. Elle promet reconnaissance des douleurs, réintégration des mémoires, réconciliation des récits et réappropriation du pays par ses citoyens.
Après sa démission du gouvernement en juin 2025, il affiche une rupture claire avec « l’ancien système ». Il affirme vouloir démanteler « l’ancien système » pour que le Cameroun puisse dépasser « l’abus, le mépris et la confiscation du pouvoir ».
Plateforme : décentralisation poussée/fédéralisme soumis à référendum, écoute réelle des régions — aux anglophones : « Vous n’avez pas besoin qu’on parle pour vous ; vous avez besoin qu’on vous écoute. »
Il parle du régime sans hypocrisie. Entre les lignes, on devine l’homme brisé puis reconstruit, qui a vu le monstre froid qu’est l’État néocolonial et veut le domestiquer, non l’abattre au marteau, parce qu’un État détruit se reconstruit rarement sans sang.
Lorsque l’on parle de collusion, lui parle de survie dans un monde hostile. Il est en quelque sorte le miroir de la société camerounaise sous le régime Biya : l’équilibre instable entre compromis, survie, croyance en un idéal et déception.
Pourquoi Tchiroma est une chance unique : la rédemption par la mémoire partagée
Issa Tchiroma n’est ni ange, ni démon. Il est témoin de la complexité camerounaise. Torturé, puis porte-parole. Marginalisé, puis ministre. Victime, puis acteur. Parfois, la bravoure consiste à choisir le pont plutôt que le mur.
Cette trajectoire paradoxale fait de lui le candidat idéal pour une transition pacifique pour cinq raisons fondamentales : Il connaît les deux visages du pouvoir
Tchiroma a connu la cave du pouvoir — tortures, humiliations, injustices. Il a aussi connu ses sommets — ministères, privilèges, responsabilités. Cette double expérience lui donne une compréhension nuancée de la machine d’État. Il sait où sont les corps, mais choisit de ne pas les exhumer pour une vengeance stérile. Il incarne la réconciliation Nord–Sud
Dans un pays où la fracture régionale reste prégnante, Tchiroma peut parler aux Nordistes sans être accusé de séparatisme, et aux Sudistes sans être rejeté comme étranger. Il porte en lui la mémoire des injustices du Nord tout en ayant servi l’unité nationale. Il est le pont anthropologique dont le Cameroun a besoin.
Il offre une transition sans rupture violente . Contrairement à des révolutionnaires purs et durs, Tchiroma propose une évolution plutôt qu’une rupture. Ce n’est pas une faiblesse, c’est une force dans un pays où la peur du chaos post-Biya paralyse une partie de l’électorat. Il promet la stabilité par le changement, pas le changement par l’instabilité.
Il porte la mémoire pour éviter la répétition.En refusant d’oublier Yoko mais en choisissant de construire, Tchiroma incarne une mémoire active. Il n’est pas prisonnier de son passé : il en a fait une force de proposition. Il peut dire aux jeunes ce qu’a été 1984 pour qu’ils comprennent ce que 2025 ne doit pas devenir.
Il représente la fin du cycle Biya sans haine. Sa longue carrière aux côtés de Biya, loin d’être un handicap, devient une assurance : il ne détruira pas tout pour tout refaire. Il connaît la valeur des institutions, même imparfaites. Il peut garantir une transition respectueuse des acquis tout en corrigeant les excès.
Le dernier vote : quand la mémoire devient espérance pour une génération meurtrie
La campagne de Tchiroma ne promet pas l’impossible. Elle promet lucidité et pardon opérant. Le pays qu’il incarne est ambigu mais debout : compromis, fatigue, idéaux cabossés — et, malgré tout, volonté d’avenir.
Le dernier espoir d’un peuple désabusé est de tourner la page sans effusion de sang. Le moment est à la lucidité collective — et peut-être au pardon. Préférerons-nous la pureté abstraite à la possibilité concrète d’amélioration ?
Le combat contre Biya ne peut devenir un combat contre tout pragmatisme. Tchiroma n’est pas un saint ni un sauveur. Il est disponible, avec ses blessures et ses contradictions — et une volonté : servir.
Le 12 octobre 2025, il ne s’agira pas d’élire un miracle, mais de tenter la réconciliation par les urnes. Issa Tchiroma Bakary n’est pas « la » solution ; il est la chance de ne pas répéter les erreurs, d’inventer un futur où mémoire et espoir se tiennent la main.
Le moment de la lucidité collective et du possible pardon
Face à cette opportunité historique, chaque Camerounais partisan du changement doit se poser cette question : préfère-t-on la pureté idéologique à la possibilité réelle d’amélioration ?
Le combat contre Biya ne doit pas devenir un combat contre toute forme de pragmatisme. Tchiroma n’est pas parfait, mais il est là, disponible, avec son passé, ses blessures, ses contradictions, et surtout, sa volonté de servir.
Il ne s’agit pas d’adorer Tchiroma ; il s’agit de reconnaître qu’il représente une voie — peut-être la seule — pour tourner la page sans effusion de sang. Le pays a besoin de guérir, pas de se faire du mal. Il a besoin de se rassembler, pas de se diviser davantage.
Le 12 octobre 2025, les Camerounais tiendront entre leurs mains une opportunité historique. Non pas de choisir un sauveur, mais de décider s’ils veulent tenter l’expérience de la réconciliation par les urnes.
Issa Tchiroma Bakary n’est pas la solution-miracle ; il est simplement la chance de ne pas répéter les erreurs du passé en inventant un futur où mémoire et espoir se donnent la main.
Dans le silence de Yoko, il y a eu la mort. Dans le silence de Tchiroma sur ses tortures, il y a la sagesse. Dans sa candidature, il y a la possibilité que le Cameroun tourne enfin la page sur quarante-deux ans d’histoire pour écrire une nouvelle page, collectivement, pacifiquement, dignement.
Mais au-delà des raisonnements, il y a le cœur qui saigne. Il y a cette mère de Bafoussam qui pleure son fils mort dans les manifestations de 2008. Il y a ce père de Garoua dont le fils officier de gendarmerie a été exécuté en 1984 et qui a vu ses petits-fils partir à Boko Haram faute d’avenir.
Il y a cette jeune fille anglophone de Azi qui a dû fuir son village incendié. Tous ces Camerounais brisés qui cherchent un baume, une main tendue, une lueur.
Alors peut-être que Tchiroma, avec sa voix posée, ses mains tremblantes mais tendues vers l’avenir, peut devenir ce baume. Peut-être que ses larmes silencieuses — celles qu’il n’a pas versées devant les caméras mais qu’on lit dans ses yeux fatigués — peuvent verser nos propres larmes et enfin nous permettre de pleurer ensemble, de crier ensemble, de nous relever ensemble.
Le choix appartient à chaque Camerounais. Mais, au fond de nos cœurs meurtris, ne rêvons-nous pas tous de ce moment où, quelle que soit la couleur de notre carte d’électeur, nous pourrons nous regarder dans les yeux et dire : « Nous avons choisi la vie plutôt que la haine. Nous avons choisi l’espoir plutôt que le désespoir. Nous avons choisi de nous aimer enfin, malgré nos blessures, malgré nos peurs et méfiances, malgré nos passés. »
Tchiroma n’est pas une réponse. Tchiroma est une chance. Une chance unique. La dernière, peut-être. Saisissons-la avant qu’il ne soit trop tard. Parce que le Cameroun ne mérite pas de mourir de notre incapacité à nous pardonner. Le Cameroun mérite de vivre de notre capacité à nous aimer enfin.
Ekollo Neba Soh Njinou I Économiste-Politiste
Enseignant-Consultant
Citoyen en route vers la 3e République du Cameroun
Libreville
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.







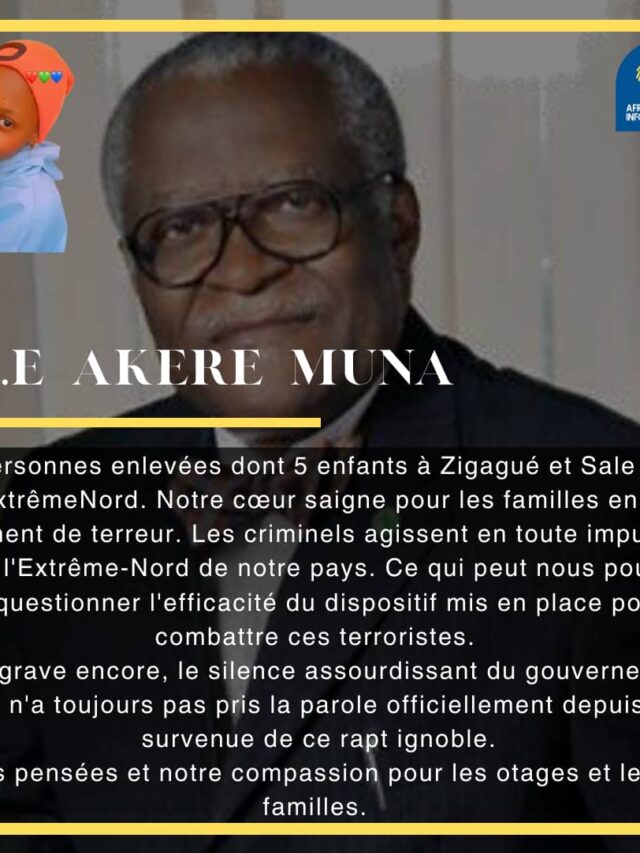
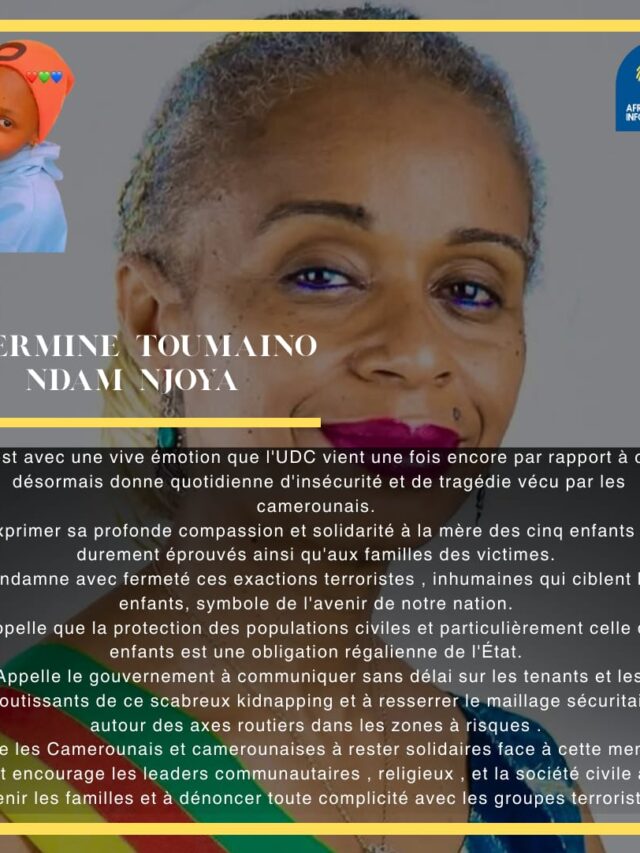
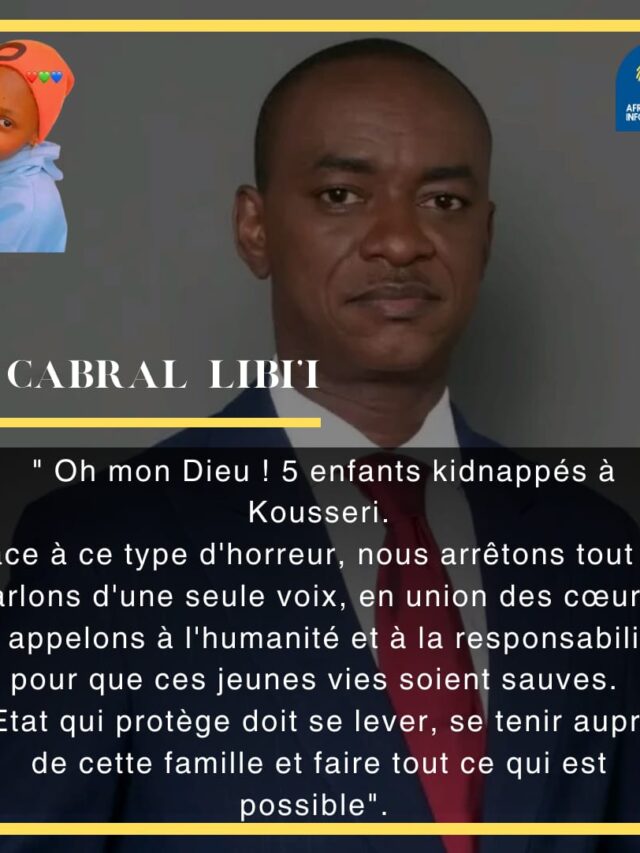
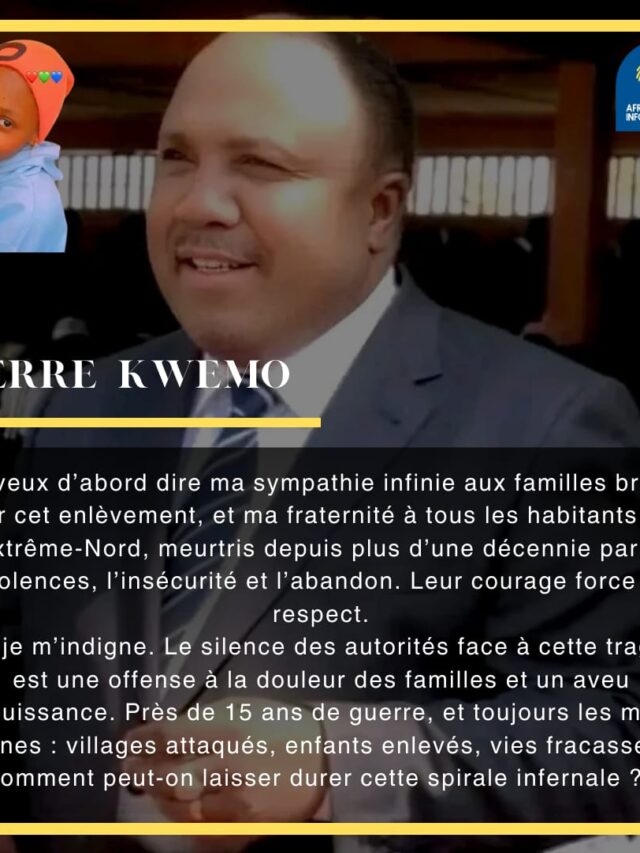
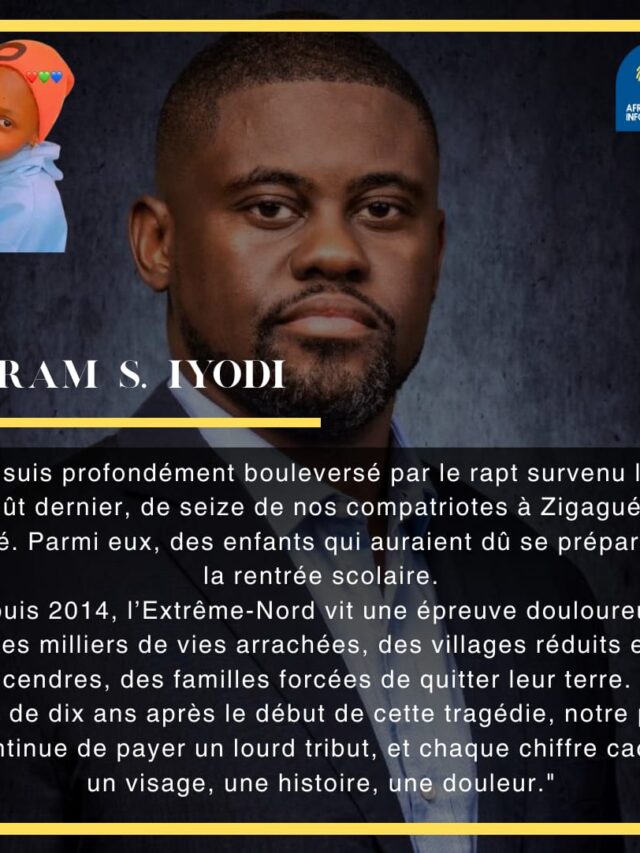
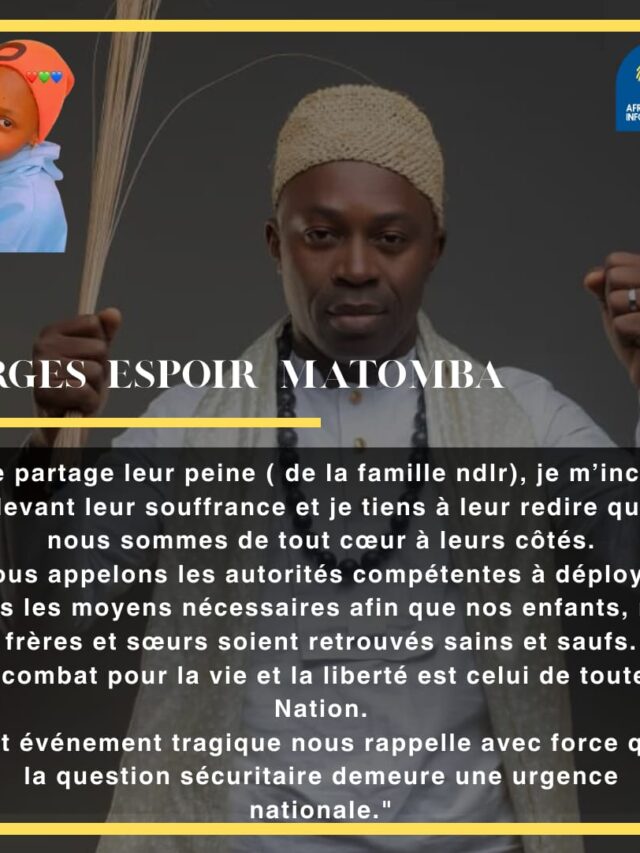
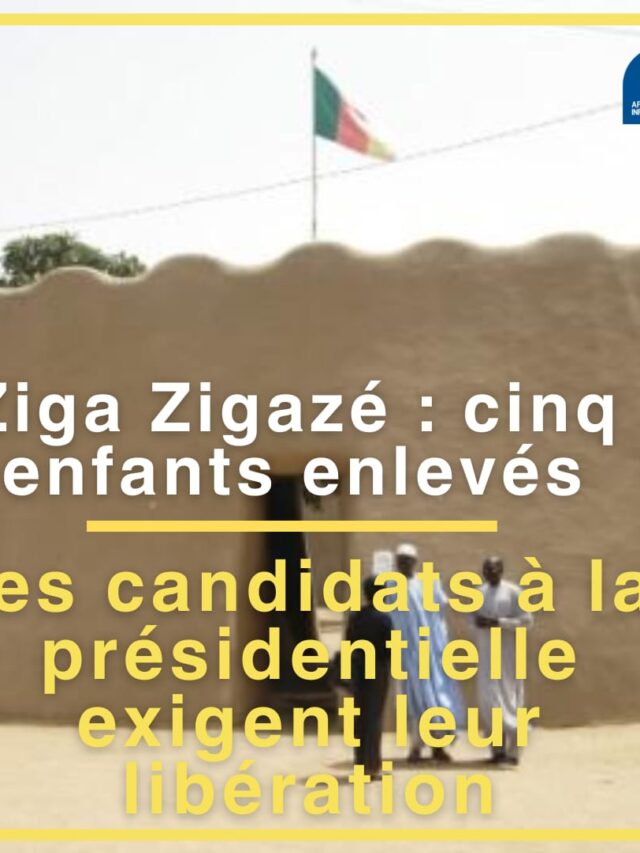
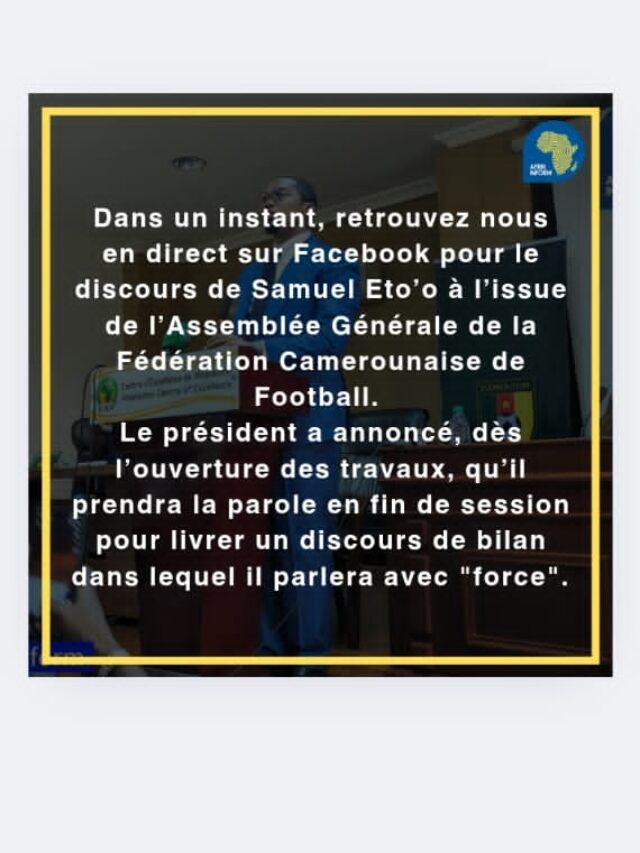
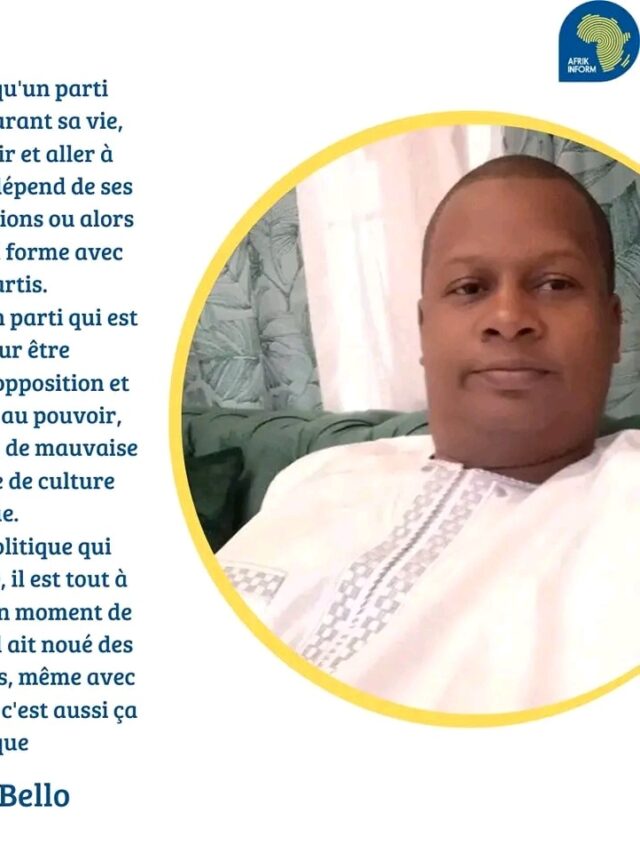





Laisser un avis