Dans une tribune lucide et sans complaisance, l’expert en communication stratégique, décrypte la présidentielle camerounaise de 2025 comme un affrontement inédit entre la République institutionnelle et la “rue numérique”. Derrière le calme orchestré du pouvoir, il révèle une transformation silencieuse du rapport à la vérité : celle d’un État qui s’accroche à la légalité procédurale face à une génération connectée qui exige des preuves vérifiables. Pour lui, le Cameroun entre dans une ère nouvelle où la paix ne tiendra plus par l’autorité, mais par la transparence.
Par Alexandre Siewe — Conseil en Communication stratégique ⤵️
Le duel des narratifs : entre la République institutionnelle et la rue numérique
L’élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun n’a pas été une élection comme les autres. Elle a marqué un tournant décisif dans la manière dont la vérité électorale se construit, se conteste et s’impose dans l’espace public africain.
Dans un pays où Paul Biya brigue un nouveau mandat à 92 ans, la séquence post-électorale a révélé une mutation profonde des stratégies de communication politique, où les récits traditionnels s’effacent devant l’empire des preuves vérifiables.
Le dispositif du calme : une chorégraphie bien huilée… mais à crédibilité décroissante, avec la République comme metteur en scène. Dès le lendemain du scrutin, le gouvernement a orchestré une communication d’une stabilité millimétrée. Le communiqué du ministre de la Communication René Sadi, daté du 15 octobre, a posé un principe simple mais puissant : seul le Conseil constitutionnel détient la légitimité de proclamer les résultats.
Cette stratégie, classique dans les régimes institutionnellement verrouillés, transforme la procédure en preuve et la légalité en vérité absolue.
À cette légalité de façade s’ajoute une stratégie du tempo. Le Conseil constitutionnel fixe l’audience du contentieux au 22 octobre, comme pour donner l’image d’un État confiant et en contrôle. L’effet recherché : épuiser la fièvre par la lenteur administrative. Le Cameroun n’est pas le premier à jouer cette carte : au Kenya en 2017, Uhuru Kenyatta avait lui aussi misé sur le calendrier judiciaire pour éteindre la colère des rues. Le pouvoir camerounais applique la même recette : “Respectons les formes, le fond s’épuisera.”
Mais la lenteur procédurale n’est qu’une moitié du plan. L’autre moitié, c’est la dissuasion douce : préfets et gouverneurs convoquent les “chefs de communautés” à des “séances de travail”, en apparence anodines, en réalité destinées à resserrer le contrôle social.
À Edéa, le préfet réunit les leaders Bamiléké, du Grand Nord et anglophones. Message subliminal : “On vous tient à l’œil, mais dans la paix.” Le pouvoir ne veut pas des manifestants, il veut des messagers communautaires du calme. Mis bout à bout, ces messages dessinent une architecture de stabilisation politique :
le gouvernement impose le cadre légal, les préfets neutralisent les tensions locales, le Conseil constitutionnel scelle le récit, l’opposition modérée fournit la caution démocratique, l’Église rappelle que la paix sans vérité n’est qu’un silence.
Le tout compose une chorégraphie du contrôle, presque parfaite dans sa coordination. Mais comme toute mise en scène, elle souffre d’un risque : l’écart entre la performance et la perception.
Car si la paix est perçue comme un couvercle plutôt qu’un accord, elle explose tôt ou tard. C’est ce qu’a vécu le Sénégal en 2021, quand la “paix imposée” autour du régime Macky Sall s’est fissurée sous la pression d’une jeunesse désabusée. Le Cameroun n’en est pas là, mais la tension générationnelle — silencieuse, connectée, numérique — s’épaissit.
L’attribution de 53,66% des voix à Paul Biya par la Commission nationale de recensement des votes, annoncée dans la presse proche du pouvoir, s’inscrit dans cette logique : l’institution crée la réalité politique. Le Conseil constitutionnel va parachever la mise en scène d’un État calme, procédural et sûr de lui.
En s’accrochant exclusivement au registre légal, le pouvoir abdique le monopole du récit moral et factuel aux nouveaux acteurs de la vérification citoyenne.
Le RDPC : théologie du pouvoir et gratitude politique
Le communiqué du RDPC dans le Mayo-Kani ajoute une couche spirituelle : “Le pouvoir vient de Dieu et il ne se trompe pas.” Cette phrase n’est pas anodine. Elle transforme un résultat électoral en décret providentiel, et remplace le débat démocratique par un devoir de reconnaissance.
On y voit la fusion du langage religieux et de la légitimité politique, ce que le sociologue Max Weber appelait la “domination charismatique traditionnelle.” Autrement dit : le Chef n’est pas élu, il est béni. On ne le conteste pas, on le prie. Dans une région où la religion structure le quotidien, ce message agit comme un vaccin contre la révolte.
Mais cette théologie du pouvoir a ses limites : à force de parler de “grâce” et “d’ingratitude”, elle infantilise les électeurs. Or, un peuple infantilisé n’obéit pas éternellement — il boude, il s’abstient, il se détourne. C’est une paix fragile, une paix de lassitude. Quand un régime invoque Dieu, c’est qu’il sent le doute monter parmi les hommes.
Les alliés objectifs : quand l’opposition devient garante du système
Dans un paysage politique où la frontière entre opposition et cooptation est poreuse, deux figures incarnent ce que l’on pourrait appeler l‘« opposition raisonnable ». Joshua Osih (SDF) et Cabral Libii (PCRN) ont retiré leurs recours devant le Conseil constitutionnel, invoquant l’« esprit républicain ».
Cette posture, loin d’être naïve, s’inscrit dans une stratégie de survie politique. En validant le processus qui produit les résultats sans valider les résultats eux-mêmes, ces opposants deviennent des “alliés objectifs” du régime.
Ce phénomène n’est pas spécifique au Cameroun : on le retrouve chez Morgan Tsvangirai au Zimbabwe en 2013 ou Raila Odinga au Kenya en 2017, où l’opposition ayant accepté les règles du jeu institutionnel a permis au pouvoir de respirer tout en conservant une légitimité formelle.
Le retrait stratégique de Joshua Osih, trois jours après avoir déposé son recours, illustre parfaitement cette dynamique d’autocensure anticipée, où la peur de l’exclusion future l’emporte sur la contestation présente.
La révolution tranquille : Tchiroma et l’arme des preuves vérifiables
Au milieu de cette chorégraphie maîtrisée, Issa Tchiroma Bakary introduit une dissonance fondamentale en transformant la data en levier politique. Son Comité de compilation a publié des résultats détaillés via Google Drive, accompagnés de scans de procès-verbaux originaux, méthodiquement organisés et accessibles à tous.
Cette approche quasi scientifique représente une rupture majeure dans la culture politique camerounaise. Là où le régime impose la loi comme vérité, Tchiroma propose la preuve comme contre-pouvoir.
Son invitation ouverte — « Vérifiez par vous-mêmes » — transforme chaque citoyen en potentiel vérificateur, déplaçant le centre de gravité du débat politique du registre autoritaire au registre empirique. Cette stratégie rappelle celle d’Alexeï Navalny en Russie, ou encore l’initiative #Data4Kenya, qui a permis aux citoyens de recompter les votes à partir des photos de PV publiés en ligne.
La rue numérique : quand les citoyens deviennent journalistes
Le plus bouleversant dans cette séquence électorale est l’émergence d’une “rue numérique” camerounaise. Des citoyens ordinaires ont organisé des opérations de surveillance dans les bureaux de vote, filmant le dépouillement et partageant les preuves en temps réel.
Cette mobilisation s’est traduite par des actes concrets : comptage à voix haute, refus de signer des PV frauduleux, extraction de confessions d’agents d’ELECAM. L’épisode du tribunal de Bafoussam, où une foule s’est rassemblée pour soutenir une scrutatrice du FSNC emprisonnée pour avoir refusé de valider un PV frauduleux, illustre cette nouvelle conscience politique.
Les réseaux sociaux — WhatsApp, Facebook, TikTok — sont devenus les canaux privilégiés de cette contre-information citoyenne. Dans un contexte où les médias traditionnels restent contrôlés, ces plateformes offrent un espace de liberté relative, malgré la prolifération des fake news.
La voix morale de l’Église : entre prudence et fermeté
La déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (CENC) du 19 octobre 2025 représente un équilibre entre diplomatie ecclésiastique et fermeté éthique.
Les évêques saluent “le calme et la civilité” du scrutin, mais ajoutent que des irrégularités sérieuses entravent la marche vers la démocratie :
taux d’abstention élevés, délocalisation de bureaux, présence de noms de personnes décédées sur les listes, bourrages d’urnes, incohérences dans la signature et la transmission des PV, et un incident impliquant le convoi du candidat Issa Tchiroma à Garoua.
Puis vient la phrase-clé : “Notre prière est qu’avec l’aide de Dieu et l’engagement de tous, notre pays connaisse la paix et la stabilité dans la vérité.”
Les évêques ne contestent pas le scrutin, ils le recontextualisent. Ils refusent le divorce entre paix et vérité. Dans le lexique du pouvoir, la paix est un objectif ; dans celui de l’Église, elle est une conséquence de la vérité.
Les nouvelles géométries du pouvoir
L’analyse de cette séquence électorale révèle une reconfiguration profonde des équilibres politiques camerounais. L’opposition traditionnelle marginalise sa propre capacité de nuisance en acceptant les règles d’un jeu qu’elle dénonce.
Par contraste, une nouvelle opposition émerge — hybride et rhizomatique, combinant leadership politique, mobilisation citoyenne et technologies numériques. Cette configuration rappelle le mouvement “Y’en a marre” au Sénégal. Mais ici, la mobilisation s’est faite sans structure préalable, surgissant spontanément de la société civile.
Le dilemme camerounais : entre stabilité autoritaire et émancipation citoyenne. La séquence d’octobre 2025 pose une question fondamentale : le pays peut-il continuer à privilégier la stabilité au détriment de la vérité ?
Le modèle de paix négociée, en place depuis les années 1990, montre ses limites face à une jeunesse exigeant la transparence. Les institutions démocratiques subsistent formellement, mais sont vidées de leur substance. L’innovation de 2025 réside dans l’émergence de contre-pouvoirs informels utilisant la transparence comme arme politique.
La vérité comme nouveau langage du pouvoir
L’élection de 2025 marque une mutation systémique : le passage du discours idéologique à la preuve documentée.
Trois vérités s’affrontent : la vérité juridique (l’État), la vérité morale (l’Église), la vérité factuelle (les citoyens). Et c’est là que se joue l’avenir : Si la loi continue d’exclure la preuve, elle cessera d’être crédible. Si la paix continue de servir de couvercle, elle deviendra méfiance. Si la preuve continue de circuler, elle finira par transformer la politique.
Ce moment est historique. La convergence entre une opposition radicale sur le fond (Tchiroma, Kamto…) et une société civile autonome (les citoyens vérifieurs de DISO, VAR…) pourrait dessiner un nouveau modèle de contestation démocratique en Afrique.
Le Cameroun n’en est plus simplement à choisir entre paix et vérité. Il entre dans une ère où la paix dépendra de la vérité que l’on acceptera de voir, de vérifier et de partager.
Dans ce nouveau paradigme, la transparence n’est plus une vertu démocratique parmi d’autres : c’est la condition sine qua non de toute légitimité politique durable. La question n’est plus : « Qui a gagné l’élection ? » Mais : « Quelle vérité accepterons-nous de construire ensemble ? »
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

















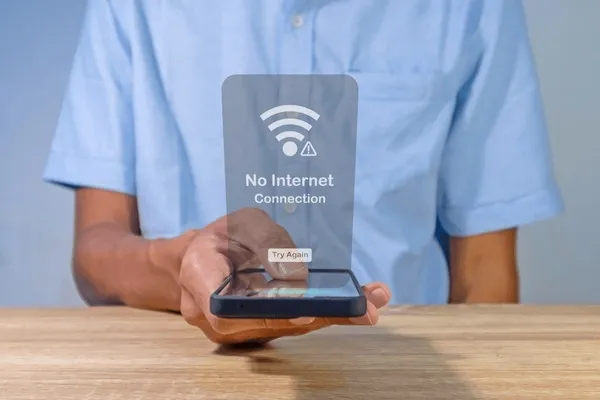


Laisser un avis