Le vent qui souffle sur l’Élysée depuis plusieurs mois porte un parfum de rupture. Une rupture assumée, parfois imposée, souvent subie. Emmanuel Macron repart en Afrique. Quatre pays, quatre rythmes, quatre messages : Maurice, l’Afrique du Sud, le Gabon et l’Angola. Une tournée dense, presque nerveuse, où chaque escale raconte un bout de la relation la plus secouée de la présidence française. Une relation qu’il faut recoudre, retisser, reconfigurer.
PORT-LOUIS — L’ÎLE QUI OUVRE LA MER
Tout commence à Maurice, les 20 et 21 novembre. Une décision qui a surpris le grand public, mais pas les diplomates. Car Maurice n’est pas qu’un décor de carte postale : c’est un nœud diplomatique, un carrefour stratégique où se croisent les ambitions de trois continents et les influences de trois puissances majeures.
Ce déplacement est la première pierre du nouveau récit que Paris veut bâtir dans l’océan Indien. Un récit où la France ne serait plus une puissance nostalgique, mais un acteur maritime assumé. Maurice occupe dans cette vision un rôle singulier : un État insulaire stable, membre du Commonwealth, farouchement indépendant, mais historiquement lié à la France par la culture, la langue et une géographie qui rend leurs destins presque imbriqués.
La France et Maurice entretiennent depuis des décennies une coopération solide mais sous-médiatisée : échanges économiques soutenus, coopération judiciaire, liens culturels.
Les deux États partagent également des intérêts convergents sur la délimitation des zones économiques exclusives, la sécurité des routes maritimes et la lutte contre la pêche illégale — un dossier explosif dans l’océan Indien. Mais ces dernières années, une ombre a plané sur la relation : l’affaire de l’archipel de Chagos.
Paris a toujours entretenu une prudente neutralité face à ce dossier explosif opposant Maurice au Royaume-Uni, mais l’Élysée sait que la résolution de cette question — désormais entérinée par une décision internationale favorable à Port-Louis — rebat les cartes. Maurice reprend sa souveraineté. Et la France veut être présente au moment où se redessine l’équilibre régional.
Surtout maintenant, Parce que l’océan Indien est devenu la mer des inquiétudes géopolitiques. On y trouve : les routes commerciales les un plus vitales du monde ; les franchises maritimes chinoises, qui progressent discrètement ; les alliances indiennes, qui cherchent à verrouiller leur voisinage ; les présences militaires du Golfe, qui s’installent durablement.
Maurice, située au centre de ces tensions, est aujourd’hui courtisée de toutes parts. L’Élysée le sait : si la France ne s’y ancre pas maintenant, elle ne le pourra plus dans dix ans. La visite de Macron traduit ce repositionnement.
Ce n’est plus un partenariat d’assistance. Ce n’est plus un tête-à-tête sentimental. C’est un accord stratégique. Le président français vient probablement proposer : un pacte bleu sur la protection de l’océan ; des programmes conjoints sur la transition énergétique, y compris l’hydrogène vert ; un renforcement de la surveillance maritime contre le trafic, le pillage des ressources halieutiques et les incursions étrangères ; des investissements dans les technologies portuaires et les infrastructures résistantes au changement climatique.
L’objectif est clair : faire de Maurice un partenaire-pilote, un hub régional capable de stabiliser la présence française dans l’océan Indien après les revers du Sahel. À Paris, on le dit autrement : « Maurice est l’endroit où l’on peut encore reconfigurer notre présence sans traumatisme historique ». Pas de blessure coloniale aussi profonde qu’en Afrique continentale. Pas de crise mémorielle aussi lourde. Pas de rejet populaire.
C’est un espace où la France peut encore parler sans être immédiatement soupçonnée de nostalgie impériale. Un espace où l’on peut tester ce que Paris appelle désormais une diplomatie du “partenariat de souveraineté” : coopérer sans s’imposer, proposer sans orienter, soutenir sans dominer.
Cette première étape permet à Macron d’ancrer son voyage dans une région où la France n’a jamais été rejetée, et où elle peut encore incarner une puissance fiable. L’Élysée sait que pour convaincre l’Afrique continentale, il faut commencer par un terrain apaisé. Maurice offre cette possibilité.
JOHANNESBURG — LE G20 QUI RÉÉCRIT LES HIÉRARCHIES
Le 22 novembre, l’avion présidentiel s’arrache de la piste de Villacoublay et met le cap sur Johannesburg. C’est un déplacement court en apparence, mais lourd d’histoire. Pour la première fois, l’Afrique accueille le G20. Non pas une simple réunion protocolaire, mais l’un de ces cénacles où se décide l’architecture de l’économie mondiale, où se négocient les règles invisibles qui façonnent le destin des dettes, des prêts, des infrastructures et, par ricochet, des nations qui tentent encore de prendre leur place dans le concert international.
L’enjeu dépasse les façades officielles. La France y voit une scène, presque une opportunité stratégique. L’Afrique du Sud, hôte du sommet, porte cette rencontre comme un symbole : celui d’un continent qui réclame enfin un droit d’ingérence sur son propre avenir. Quant au reste du monde, la tenue du G20 en Afrique est déjà un message : le centre de gravité se déplace, les équilibres politiques se recomposent, et les nouvelles alliances ne se nouent plus à Washington ou Bruxelles, mais à Nairobi, Pretoria ou Accra.
Cette année, un élément inattendu bouleverse le décor. Donald Trump, redevenu président des États-Unis, a décidé de ne pas faire le déplacement. L’absence du premier acteur de l’économie mondiale crée un vide inhabituel. Paradoxalement, ce retrait offre une respiration diplomatique à Emmanuel Macron. Dans une Afrique où Washington ralentit sa présence politique depuis plusieurs mois, Paris estime qu’une fenêtre s’ouvre, fragile mais réelle, pour réparer des liens distendus, tenter de réinstaller une crédibilité perdue et prouver que son rapport au continent n’est plus celui d’hier.
Reste que la tâche est immense. Le G20 africain agit comme un examen de passage pour la France. Emmanuel Macron doit convaincre que Paris a compris la nouvelle grammaire diplomatique du continent. L’époque des discours creux ne passe plus. Les capitales africaines veulent des propositions, des chiffres, des mécanismes. Elles veulent des engagements fermes sur la restructuration des dettes, sur les financements d’infrastructures vertes, sur la place réelle — et non symbolique — des États africains dans la gouvernance mondiale.
Macron veut présenter la France comme un partenaire technique, capable d’aider à mobiliser les fonds internationaux, notamment autour du Pacte financier pour les pays vulnérables qu’il défend depuis deux ans. Il veut se poser en intermédiaire entre les puissances du Nord et les économies émergentes du Sud, comme un médiateur capable de faire respirer un système mondial essoufflé.
LIBREVILLE — Une Escale Qui Dit Tout
Le 23 novembre, le président français atterrit au Gabon. L’air moite de Libreville, les drapeaux tendus sur le tarmac, les alignements protocolaires… une chorégraphie bien connue de la diplomatie française. Mais cette fois, l’escale n’a rien d’anodin. Elle concentre à elle seule un demi-siècle d’ambiguïtés, de pactes implicites, de rééquilibrages forcés. Le Gabon reste, depuis l’indépendance, l’un des miroirs les plus fidèles des contradictions de la politique africaine de Paris.
Pendant des décennies, Libreville fut un partenaire stratégique, presque un compagnon institutionnel. Sous Omar Bongo puis Ali Bongo, la France entretenait ici une présence militaire quasi structurelle. Les détachements de l’armée française étaient un pilier de stabilité pour Paris, un outil diplomatique, mais aussi un symbole encombrant : la preuve d’un système françafricain que la jeunesse gabonaise n’a jamais vraiment digéré. Aujourd’hui, cette présence se délite, se rediscute, se miniaturise. Les hommes, jadis très visibles, sont devenus des instructeurs. Les bases se sont transformées en pôles régionaux de formation. La France ne tient plus le territoire, elle y transmet des compétences.
Et pourtant, l’atterrissage de Macron se déroule dans un contexte nouveau, presque déroutant. Le Gabon n’est plus dirigé par la famille Bongo. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a renversé Ali Bongo en 2023 et s’est installé depuis comme président de la République, incarne une génération de dirigeants qui refusent les codes anciens. Il parle d’indépendance stratégique, d’assainissement de l’État, de souveraineté sans compromis. Son cabinet ne fonctionne plus selon les automatismes hérités du passé. Chaque geste, chaque partenariat est renégocié sur une base nouvelle.
Macron arrive au moment où le procès de l’ancien président Bongo et de son entourage secoue le pays. C’est un séisme politique qui effrite l’ancien système, rouvre les archives du pouvoir et redistribue les alliances. Paris observe, officiellement à distance. Pourtant, cette situation rend l’entretien avec Oligui Nguema particulièrement sensible : toute prise de position, même implicite, pourrait être lue comme un signal politique.
Dans les coulisses, plusieurs dossiers lourds attendent d’être abordés ( pourraient être abordés). Le premier concerne la coopération militaire. Le Gabon veut clarifier la nature et l’ampleur de la présence française. Pas question de redevenir un poste avancé. Libreville exige un partenariat strictement technique : formation des forces locales, appui logistique calibré, cybersécurité, expertise dans la lutte contre le trafic maritime dans le Golfe de Guinée. Paris y voit une opportunité : maintenir une présence résiduelle dans une région devenue stratégique depuis que la Russie, la Chine et la Turquie accentuent leur ancrage sur la façade atlantique africaine.
Deuxième dossier, plus discret : la forêt gabonaise et les crédits carbone. Le Gabon reste l’un des rares pays au monde à absorber plus de CO₂ qu’il n’en émet. C’est un paradoxe écologique qui intéresse énormément l’Élysée. Derrière les discours verts, il y a une bataille économique. Paris souhaite jouer un rôle dans la structuration du marché africain des crédits carbone, et Libreville veut en tirer un bénéfice financier réel, non plus symbolique. Les négociations pourraient porter sur la création de mécanismes de certification, de financements internationaux, et d’investissements européens dans la gestion durable des forêts.
Troisième sujet, plus brûlant encore : la gouvernance pétrolière. Le Gabon reste dépendant de l’or noir. Les majors françaises connaissent parfaitement le terrain, TotalÉnergies en tête. Avec la chute de l’ancien régime, certains contrats sont réexaminés. Libreville veut renégocier, assainir, revoir les marges. Paris doit s’avancer avec prudence, sans donner l’impression de défendre les intérêts privés de ses entreprises, tout en assurant qu’elles resteront des partenaires fiables dans un paysage politique plus volatil.
Il y a aussi, dans un coin des discussions, la question des avoirs et des enquêtes internationales. Le procès en cours autour des affaires de la famille Bongo ouvre un espace juridique inédit. Les équipes d’Oligui Nguema cherchent à coopérer avec plusieurs États pour récupérer certains biens ou documents. La France, où des procédures existent déjà, sera sollicitée. Là encore, la diplomatie devra marcher sur une ligne fine : coopération judiciaire totale, mais sans interférer dans la politique intérieure gabonaise.
Enfin, un enjeu plus large traverse les conversations : la place du Gabon dans la recomposition géopolitique africaine. Depuis le coup d’État de 2023, Libreville tente de se présenter comme un modèle de transition ordonnée, un laboratoire de lutte contre la corruption, un État qui veut réécrire son contrat social. Macron cherche à comprendre cette dynamique, à capter la nouvelle orientation diplomatique d’un partenaire qui, malgré les ruptures récentes, demeure une porte d’entrée importante dans la région des deux Guinées.
Dans ce face-à-face, chacun vient tester l’autre. Le Gabon, avec sa mémoire longue, veut savoir si la France a réellement changé de logiciel. Paris, de son côté, mesure jusqu’où Libreville accepte encore sa présence, même minimale. Dans l’éclairage cru du procès Bongo, au milieu d’un pays qui tente d’apurer son passé, l’entretien entre Macron et Oligui Nguema ressemble à un moment de vérité.
LUANDA — L’ANGOLA, STRATÉGIE ÉCONOMIQUE
Le 24 novembre, l’avion présidentiel se pose à Luanda, ville océane, verticalisée, où les gratte-ciel rivalisent avec les souvenirs de guerre civile. Ici, l’enjeu n’a rien de mémoriel. L’Angola n’est pas un terrain de repentance, ni une arène d’histoires coloniales. C’est un marché, un carrefour énergétique, une puissance moyenne qui veut réécrire son destin économique. Le pays de João Lourenço n’attend pas qu’on lui apporte un avenir : il veut le négocier.
L’Angola fut longtemps un royaume pétrolier, dépendant jusqu’à l’étouffement d’un baril capricieux. Aujourd’hui, il essaie de se transformer. Lourenço cherche des partenaires capables d’accompagner une diversification urgente : agriculture, agro-industrie, infrastructures hydrauliques, transformation du gaz, industrie minière. Il veut sortir du cycle pétrole → dette → vulnérabilité. Et il veut le faire sans se détacher brutalement de ses piliers traditionnels.
C’est dans cette transition que Paris tente d’inscrire sa visite. Macron n’arrive pas avec des symboles : il arrive avec une délégation. Des chefs d’entreprise tricolores, des experts en énergie verte, des spécialistes de l’agriculture irriguée, des industriels du traitement des déchets, des banques de développement. Une mission politico-économique calibrée, presque assumée comme telle. L’objectif est double. Consolider les marchés existants — notamment dans l’eau, les infrastructures et l’énergie — mais surtout réintroduire la France dans un espace où elle avait perdu du terrain.
Car face à lui, la concurrence n’est pas timide. La Chine reste le premier partenaire commercial de l’Angola : construction, routes, ports, hôpitaux, financement de projets pharaoniques via des prêts adossés au pétrole. Pékin a bâti ici l’un de ses plus grands laboratoires diplomatiques africains. Mais Luanda commence à s’essouffler face aux conditions de remboursement, à la dépendance financière, à la centralité du yuan dans ses équilibres commerciaux. Lourenço veut diversifier ses leviers pour ne pas devenir otage de sa propre modernisation. La France arrive donc dans un moment particulier : une brèche.
Paris propose une autre forme de partenariat : moins volumineux, mais plus technique ; moins visible, mais plus stable ; moins fondé sur l’endettement, davantage sur les filières. Macron veut pousser les entreprises françaises là où elles peuvent réellement concurrencer les géants chinois : ingénierie de précision, infrastructures hydrauliques, matériaux, agro-industrie, formation des cadres, expertise dans les énergies nouvelles.
Un dossier retient particulièrement l’attention : l’agriculture. L’Angola possède des terres parmi les plus fertiles de la région, mais manque encore d’infrastructures, de logistique, de technologies d’irrigation. Paris voit une opportunité à long terme : des partenariats agro-industriels capables de créer des chaînes de valeur locales, avec des entreprises françaises positionnées comme fournisseurs d’ingénierie, de machines et de formation.
Un second dossier, plus discret mais structurant, porte sur la sécurité maritime. Le Golfe de Guinée est devenu le premier foyer mondial de piraterie. La France, qui dispose déjà d’une expertise reconnue dans la zone, veut renforcer sa coopération avec Luanda pour sécuriser les routes commerciales et protéger les cargos qui remontent vers l’Europe. L’Angola, qui ambitionne de devenir un hub énergétique régional, voit là une chance d’asseoir sa stature diplomatique.
Enfin, un troisième axe, très politique : les réseaux. Angola et France cherchent à se repositionner dans la géopolitique lusophone, entre Lisbonne, Brasilia, Maputo et Bissau. Paris tente discrètement d’entrer dans le jeu, d’influer sur un espace où elle n’est pas native, mais où elle peut s’arrimer grâce à la force économique de l’Angola et à la présence francophone d’Afrique centrale.
LA FAILLE — HUIT ANNÉES QUI ONT TOUT REFAÇONNÉ
Si la nouvelle tournée de Macron est si stratégique, c’est parce qu’elle s’inscrit dans l’après-tempête. Depuis huit ans, la relation entre la France et l’Afrique a traversé une zone de sismicité rare, une rupture que ni Paris ni les capitales africaines ne peuvent encore totalement nommer.
Macron a vu ses militaires sommés de quitter le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Il a vu les drapeaux russes recouvrir les places où, pendant des décennies, la France se pensait incontournable. Les bases ont fermé l’une après l’autre, les accords de défense ont été dénoncés, la coopération militaire démantelée, parfois sous les huées des foules, parfois dans le silence froid des chancelleries.
La France a reculé à Dakar, à N’Djamena, à Gao, à Ouagadougou, à Niamey. Elle a perdu le Sahel, son principal bastion stratégique depuis trente ans. Dans la rue, un nouveau récit s’est imposé, brutal, viral : la France n’est plus la solution. Parfois même, elle est perçue comme le problème.
Dans les diplomaties africaines, on a compris que l’ère post-coloniale, longtemps prolongée par inertie, venait de s’éteindre définitivement. Ce qui ressemblait encore, hier, à une continuité historique n’est plus qu’un souvenir institutionnel. Et pendant que la géopolitique brûlait, Macron a tenté d’éteindre un autre incendie : celui de la mémoire.
Il a reconnu Thiaroye, cette fusillade longtemps dissimulée dans le marbre militaire. Il a reconnu les violences de la guerre au Cameroun, notamment la répression des maquis nationalistes, longtemps étouffée dans les archives.
Il a ouvert des dossiers que l’État français avait toujours maintenus à distance, reconnaissant ce que ses prédécesseurs préféraient laisser en ombre. Ces gestes n’ont pas effacé les blessures, ni apaisé les révoltes souterraines. Mais ils ont créé quelque chose de plus rare : une brèche. Une zone où un autre discours diplomatique peut apparaître, dégagé des vieux réflexes, d’un ton nouveau, presque expérimental.
Le voyage qui l’emmène à Maurice, Johannesburg, Libreville et Luanda n’a pas pour vocation de « réparer » la relation franco-africaine. Elle ne peut plus l’être. Les fractures sont trop profondes, les récits trop divergents, les attentes trop neuves.
Ce que Macron cherche désormais, c’est une refonte. Une méthode. Une architecture diplomatique qui ne repose plus sur la présence militaire mais sur la compétence partagée. Paris veut remplacer les garnisons par des académies de formation, co-dirigées, co-gérées. Elle veut faire émerger une Afrique actrice des décisions mondiales, notamment via le G20, où Macron pousse l’idée d’une gouvernance élargie aux puissances émergentes du continent.
Ce voyage n’est donc pas un déplacement. C’est un test. Celui d’une France qui tente, pour la première fois depuis soixante ans, de parler à l’Afrique sans se placer au centre de la phrase.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






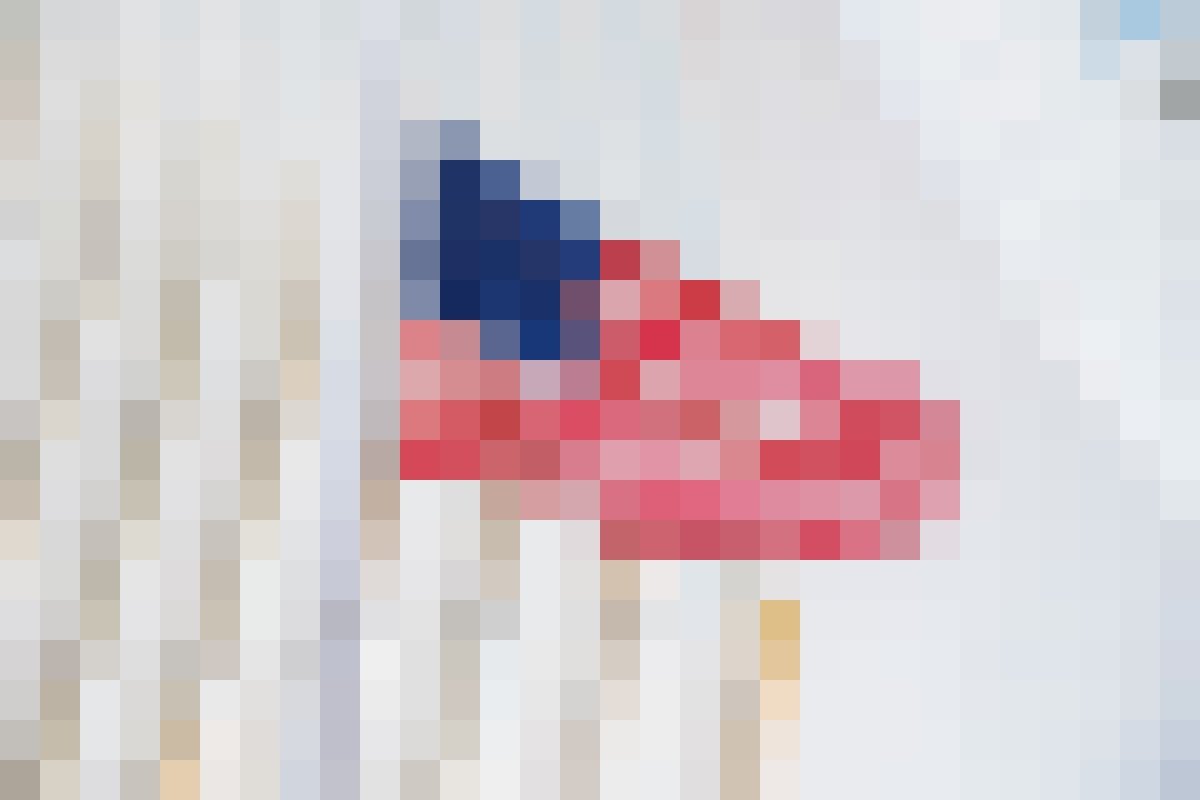








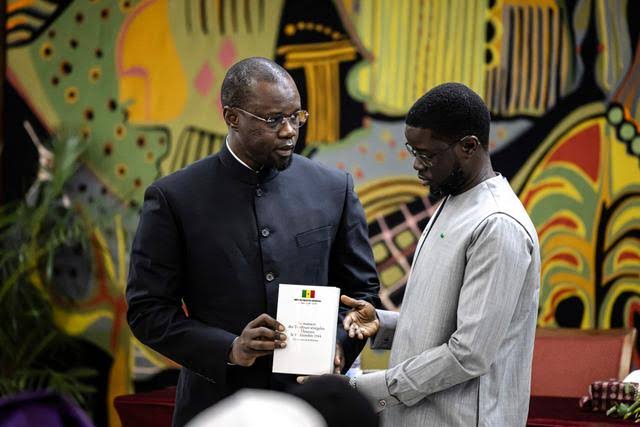

 X (Twitter)
X (Twitter) Site Web
Site Web
Laisser un avis