En parlant pour la première fois de « guerre » au sujet de la répression française au Cameroun entre 1945 et 1971, Emmanuel Macron inscrit Yaoundé dans le sillage des gestes mémoriels adressés au Rwanda et à l’Algérie. Une reconnaissance historique qui s’affiche comme un outil diplomatique, entre devoir de vérité et refus assumé de « réparer » .
Une continuité assumée dans le langage de reconnaissance
Depuis son arrivée à l’Élysée, Emmanuel Macron a multiplié les initiatives visant à éclairer des pans sombres de l’histoire coloniale française.

En Algérie, il a reconnu en 2018 la responsabilité de l’État dans la disparition de Maurice Audin, militant indépendantiste torturé par l’armée en 1957. Deux ans plus tard, il qualifiait de « crime inexplicable » la mort d’Ali Boumendjel, avocat nationaliste assassiné par des militaires français.

En 2021, au Rwanda, il prononce un discours à Kigali reconnaissant « les responsabilités » de la France dans le génocide des Tutsis de 1994, tout en écartant la notion de complicité directe. Chaque fois, Macron adopte une formule calibrée : reconnaissance historique, vocabulaire fort, mais sans engagement à dédommager financièrement ou juridiquement les victimes ou leurs familles.
Le Cameroun, troisième étape d’une diplomatie de la mémoire
La lettre adressée à Paul Biya le 30 juillet 2025 s’inscrit dans ce schéma. Pour la première fois, un président français parle de « guerre » pour décrire la répression coloniale et post-indépendance au Cameroun. Comme pour le Rwanda ou l’Algérie, le geste est précédé d’un travail d’historiens — ici, la commission mixte franco-camerounaise dirigée par Karine Ramondy — qui fournit une base scientifique et archivistique aux propos présidentiels.

Ce processus, qui combine recherche académique et communication politique, permet à Macron de légitimer ses déclarations sur la scène internationale tout en se prémunissant contre les accusations d’improvisation ou d’approximation historique.
Des convergences… et des limites
Dans les trois cas, Macron s’appuie sur la recherche historique pour affirmer une vérité politique. Mais il en fixe aussi les bornes : Pas de reconnaissance juridique qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites ou réparations. Un vocabulaire fort (« guerre », « crime », « responsabilité ») mais soigneusement choisi pour éviter toute reconnaissance explicite de culpabilité d’État. Une mise en avant du futur (« bâtir ensemble l’avenir ») qui sert de passerelle diplomatique après la reconnaissance.
La différence tient parfois au contexte diplomatique. Au Rwanda, l’initiative visait à réchauffer des relations gelées depuis des années. En Algérie, elle intervenait sur un dossier sensible en pleine campagne présidentielle. Au Cameroun, elle s’inscrit dans un moment charnière, à moins de deux mois de la présidentielle camerounaise et sur fond d’enjeux sécuritaires régionaux.
Une stratégie africaine de “réconciliation sans réparation”
Les historiens et analystes de la politique africaine de la France y voient une ligne claire : faire de la reconnaissance historique un outil de soft power, capable de désamorcer des tensions mémorielles tout en consolidant les relations bilatérales. Le Cameroun devient ainsi le troisième pilier d’un triptyque mémoriel africain qui pourrait encore s’élargir à d’autres ex-colonies, comme Madagascar ou le Tchad.
Mais cette approche n’est pas exempte de critiques. Pour certains militants, l’absence de réparations concrètes traduit une volonté d’en rester au symbole, sans véritable engagement envers les victimes. D’autres y voient au contraire une manière habile de solder le passé sans s’enfermer dans des contentieux interminables.
Constantin GONNANG, Afrik inform ☑️
Les trois grands gestes mémoriels de Macron
- 1. Algérie (2018-2021) : reconnaissance de crimes commis pendant la guerre d’indépendance, excuses aux familles de Maurice Audin et Ali Boumendjel.
- 2. Rwanda (2021) : reconnaissance de « responsabilités » dans le génocide des Tutsis, sans complicité directe.
- 3. Cameroun (2025) : reconnaissance de la « guerre » menée de 1945 à 1971, promesse de poursuivre les recherches historiques.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





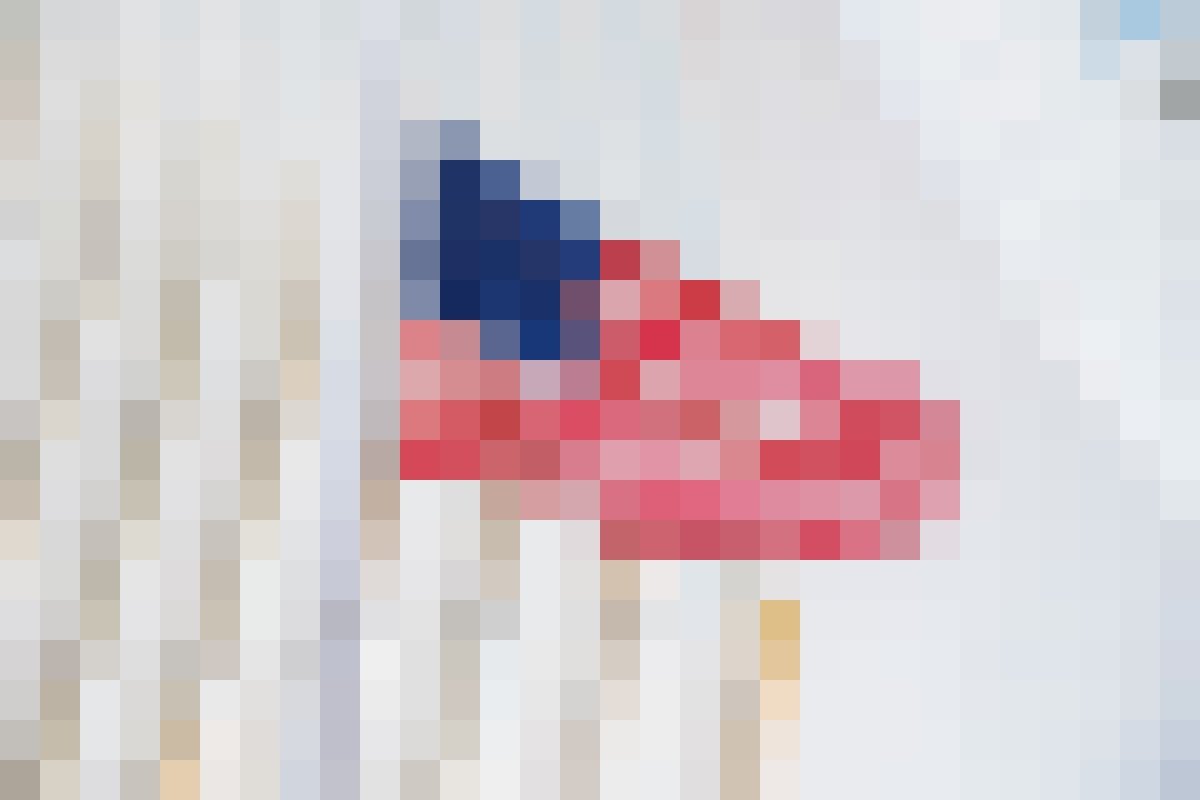







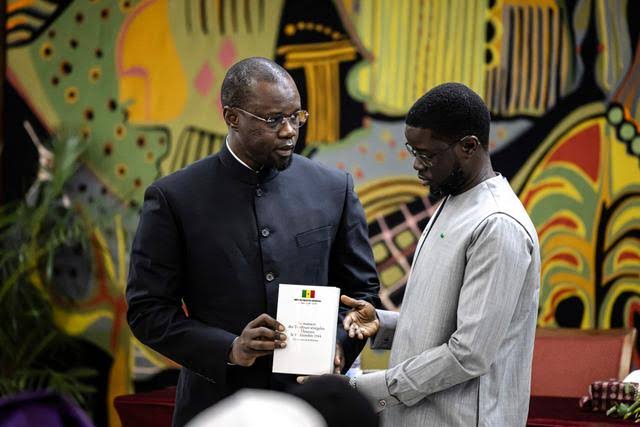


 X (Twitter)
X (Twitter) Site Web
Site Web
Laisser un avis