Ils étaient venus en sauveurs, ils s’en vont en souverains. Entre la ferveur des débuts et le silence des foules désabusées, l’Afrique semble rejouer inlassablement la même mélodie : celle du pouvoir qui enivre, corrompt et consume. À chaque nouveau visage, un même refrain d’espérance : “Enfin, le changement !” Mais sous le vernis des discours d’unité et de renaissance, s’écrivent souvent les mêmes dérives — celles des constitutions amendées, des opposants muselés et des peuples fatigués.
De Dar es-Salaam à Abidjan, de Conakry à Djibouti, le rêve d’une gouvernance moderne et apaisée s’éloigne. Les promesses d’alternance cèdent la place aux stratégies de conservation. Et l’Afrique, encore une fois, se découvre prisonnière de ses illusions : l’ivresse du pouvoir y a plus d’adeptes que la sobriété de la République.
Tanzanie : Samia Suluhu Hassan, le doux visage devenu poing de fer
Lorsqu’elle succède à John Magufuli en mars 2021, Samia Suluhu Hassan incarne une parenthèse d’espérance. Première femme présidente de la Tanzanie, elle prêche le dialogue, apaise les tensions, rouvre les médias censurés par son prédécesseur et promet une démocratie réconciliée avec elle-même. Le monde salue alors « la douceur » et « le pragmatisme » de cette dirigeante à la voix calme et au ton rassurant.
Mais quatre ans plus tard, l’image s’est fissurée. Lors de l’élection présidentielle du 29 octobre 2025, la commission électorale a annoncé que Samia Suluhu Hassan a remporté sa réélection avec 97,66 % des voix sur plus de 31,9 millions de votants. Deux de ses principaux rivaux — notamment le chef de l’opposition Tundu Lissu (du parti Chadema) et le leader du parti ACT‑Wazalendo, Luhaga Mpina — ont été empêchés de se présenter, le premier incarcéré pour « trahison », le second disqualifié pour « violations procédurales ».

Les manifestations qui ont suivi ont viré à la violence : l’opposition parle de 700 morts en quelques jours, à Dar es Salaam et Mwanza notamment, tandis que les institutions internationales ont confirmé au minimum dix décès liés à la répression. Sa prestation de serment, moins flamboyante qu’on aurait pu l’imaginer, a eu lieu alors que le pays était déjà frappé par un couvre-feu, une coupure d’internet et une forte présence militaire et policière.
Le « style Samia » d’ouverture apparait désormais éclipsé par un verrouillage inédit du champ politique. Journalistes poursuivis, opposants arrêtés ou disparus, médias resserrés, l’ancien espoir de la Tanzanie semble désormais prendre les traits d’une continuité autoritaire subtile mais efficace. La présidente qui se voulait « différente » a fini par ressembler à ceux qu’elle dénonçait. En Tanzanie, la rupture n’aura été qu’un mirage : une transition douce vers la continuité du pouvoir.
Guinée : Le rêve écourté du colonel Doumbouya
En septembre 2021, lorsque le colonel Mamadi Doumbouya renverse Alpha Condé, la Guinée jubile. Les foules descendent dans les rues de Conakry, chantant “liberté” et “justice”. L’homme en treillis promet alors une transition exemplaire, un retour à l’ordre constitutionnel et jure qu’il ne sera “jamais candidat à une élection”.
Quatre ans plus tard, l’histoire s’est retournée comme un gant. Le calendrier de la transition a été reporté à plusieurs reprises, malgré un engagement initial d’un retour aux urnes d’ici fin 2024. Un référendum constitutionnel a été organisé en septembre 2025, aboutissant à l’approbation d’un texte par environ 89 % des votants (avec un taux de participation déclaré à 86 %) qui ouvre la voie à ce que Doumbouya lui-même puisse briguer la présidence.

La nouvelle Constitution prévoit notamment l’allongement du mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable une seule fois. Pendant ce temps, la scène politique s’est resserrée : des partis d’opposition ont été suspendus ou interdits, des voix critiques réduites au silence et des protestations muselées. Le président de la transition a même déposer sa candidature auprès de la Cour suprême le 3 novembre 2025 sous haute escorte militaire, un renversement de sa promesse passée. La Guinée, qui rêvait d’une ère nouvelle, se retrouve face au miroir brisé d’une révolution confisquée. Le putsch qui devait libérer a fini par enfermer.
Djibouti : Ismaïl Omar Guelleh, l’éternel président
Depuis 1999, Ismaïl Omar Guelleh règne sur Djibouti d’une main ferme. En 2010, il fait modifier la Constitution pour supprimer la limite de mandats présidentiels, mais c’est en 2021, avec l’adoption d’une nouvelle loi fondamentale, que la dernière barrière symbolique tombe : l’âge maximum pour briguer la présidence, fixé auparavant à 75 ans, est désormais aboli. À 78 ans, Guelleh peut donc se présenter à nouveau sans aucun obstacle légal, et s’avance vers une élection où le suspense est absent, et les adversaires, marginalisés.
Sous son règne, Djibouti s’est transformé. Le pays est devenu un carrefour stratégique au cœur de la Corne de l’Afrique, accueillant des bases militaires américaines, françaises, chinoises et japonaises. Des infrastructures portuaires et aéroportuaires modernes ont vu le jour, le réseau routier s’est étoffé, et la capitale s’est dotée de projets urbains ambitieux qui facilitent le commerce et l’investissement. Cette stabilité économique et géopolitique lui vaut le surnom officieux de “porte d’entrée de l’Afrique de l’Est”.

Pourtant, derrière cette modernité et prospérité, la démocratie reste un mirage. Les opposants politiques sont systématiquement écartés, les élections sont verrouillées, et la presse indépendante peine à exister. La nouvelle Constitution, en retirant la limite d’âge, conforte Guelleh dans sa logique : celle d’un dirigeant convaincu que longévité et légitimité se confondent.
Tant que la communauté internationale fermera les yeux au nom de la “stabilité régionale”, Djibouti restera une monarchie républicaine qui ne dit pas son nom, où le pouvoir s’est pérennisé au sommet, porté par l’expérience, le pragmatisme et le contrôle absolu des institutions.
Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara, le cycle sans fin
Il avait promis de passer la main. En 2020, Alassane Ouattara annonçait qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat, avant de se raviser à la suite du décès de son dauphin désigné, Amadou Gon Coulibaly. “Les circonstances exceptionnelles m’y obligent”, expliquait-il alors. Depuis, la Côte d’Ivoire vit dans un éternel recommencement : une opposition divisée, des figures comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou Tidjane Thiam marginalisées, et une démocratie en apnée.

L’élection présidentielle de 2025 n’aura été qu’une formalité. Ouattara l’a remportée haut la main, sans véritable adversité. Derrière les grands chantiers économiques, l’homme fort d’Abidjan a bâti un système où la loyauté prime sur la contestation, et où le pluralisme s’efface au profit d’un consensus imposé.
L’ancien technocrate devenu président semble désormais prisonnier de son propre succès. Le pouvoir, en Côte d’Ivoire, n’est plus un cycle d’alternance, mais une boucle sans fin.
Ouganda : Museveni, quarante ans de règne et aucune fatigue
Yoweri Museveni n’a plus besoin de surprise. Arrivé au pouvoir en 1986, il est aujourd’hui l’un des plus anciens dirigeants du monde. Les révisions constitutionnelles lui ont permis d’abolir d’abord la limite des mandats, puis celle d’âge. Son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, est désormais positionné comme dauphin, préparant une succession dynastique sous couvert de continuité révolutionnaire.
L’Ouganda vit au rythme des arrestations d’opposants et des mascarades électorales. En 2021, Bobi Wine, icône de la jeunesse, avait soulevé un immense espoir avant d’être muselé. Les urnes ont parlé, mais c’est le pouvoir qui a compté. Museveni, lui, continue de gouverner sans partage, persuadé que son départ serait synonyme de chaos.

Dans les rues de Kampala, les plus jeunes n’ont jamais connu d’autre président. L’histoire s’est figée — et le pouvoir, devenu patrimoine familial, semble hors du temps.
Tchad : Mahamat Idriss Déby, la transition qui tourne au règne
Quand le maréchal Idriss Déby tombe en 2021, le pays entier retient son souffle. Son fils, Mahamat Idriss Déby Itno, est nommé à la tête d’un Conseil militaire de transition avec la promesse, répétée aux yeux du monde, d’organiser des élections et de rendre le pouvoir aux civils. Cette formule — succession d’un pouvoir militaire par la main d’un proche — devait être un palliatif temporaire, un temps de stabilisation après des décennies de crises.
Pourtant, les mois ont effrité les promesses. La transition, d’abord présentée comme limitée dans le temps, s’est prolongée ; les institutions se sont adaptées au tempo du chef, plus hospitalières à la sécurité qu’à la concurrence politique. Les lois et les calendriers se réécrivent au fil des nécessités du pouvoir, tandis que la scène politique se fragmente : partis muselés, leaders intimidés, société civile sous pression. Le Tchad, riche en ressources et stratégique au Sahel, offre à ceux qui tiennent la barre des leviers économiques et militaires que l’on ne lâche pas aisément.

Derrière le vernis du rétablissement et des promesses de stabilité, se devine un dessein plus profond : consolider une présence familiale et militaire au sommet de l’État. La tentation dynastique n’est plus un tabou ; elle s’insinue dans les appointments, dans la distribution des places de pouvoir et dans le contrôle des forces armées. À la faveur d’un paysage régional troublé, la transition tchadienne illustre cette triste répétition africaine : sauver la nation devient parfois le prétexte pour confisquer l’avenir.
L’ivresse comme maladie d’État
Le pouvoir en Afrique ne se transmet plus, il se conserve. Il ne se partage plus, il se recycle. Dans les palais présidentiels, chaque sourire devient instrument, chaque décret un vertige. L’ivresse du pouvoir s’installe insidieusement : elle anesthésie les promesses, étouffe les discours et transforme la vigilance en routine. Les regards sur les citoyens se font calculs, les alliances se forment et se défont au gré des caprices, et le temps perd son rythme naturel. Gouverner devient alors un sport solitaire où la tentation de tout contrôler se mêle au syndrome du palais présidentiel, ce besoin presque pathologique de prolonger indéfiniment son règne, jusqu’à ce que la liberté des peuples devienne une simple abstraction.
Un jour, ils partiront. Tous. Et il ne restera d’eux que la trace de leurs pas dans la poussière du palais, là où le pouvoir avait un goût d’éternité. Le silence remplacera les applaudissements, les couloirs se videront des confidences, et les murs se souviendront des décisions prises dans l’ombre. La grandeur promise s’évanouira, les slogans oubliés, et le vertige de la longévité ne sera plus qu’un écho amer. L’Afrique, patiente, observera alors ce moment de solitude, témoin de ces hommes qui ont cru que le pouvoir pouvait être éternel, et qui découvriront, enfin, la limite de leur ivresse.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





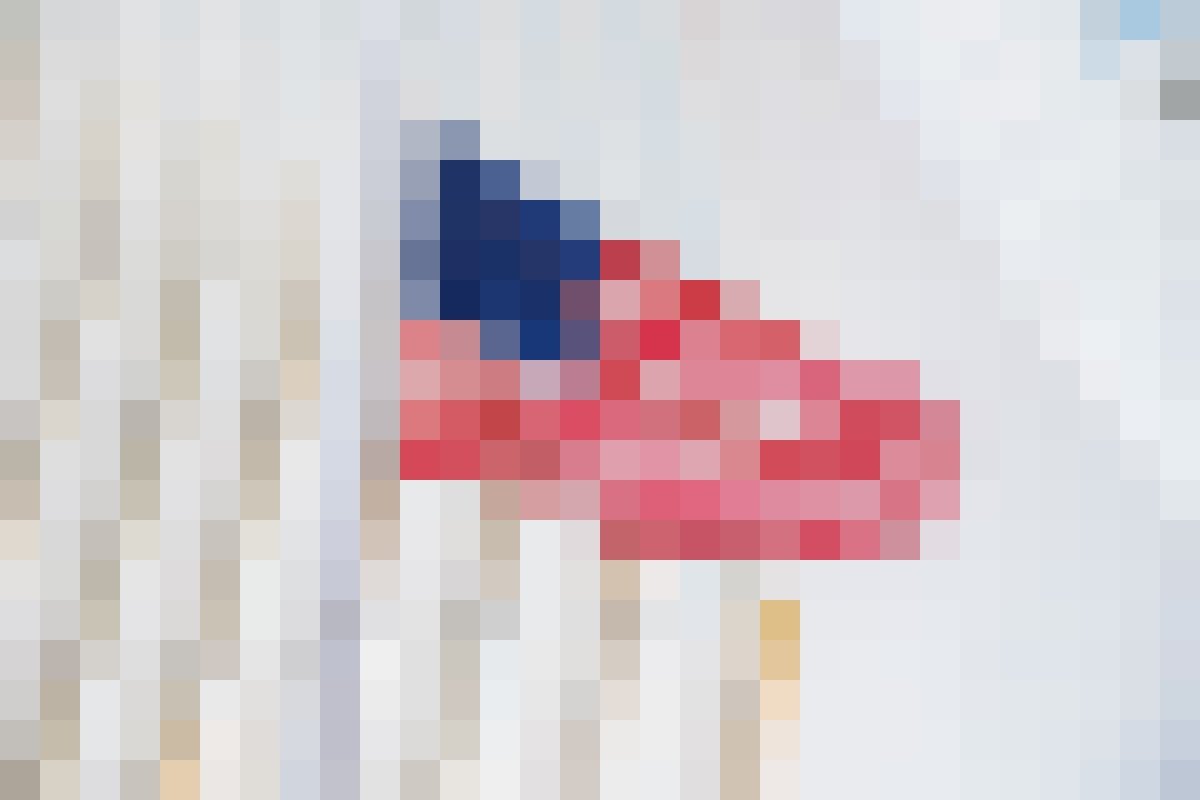

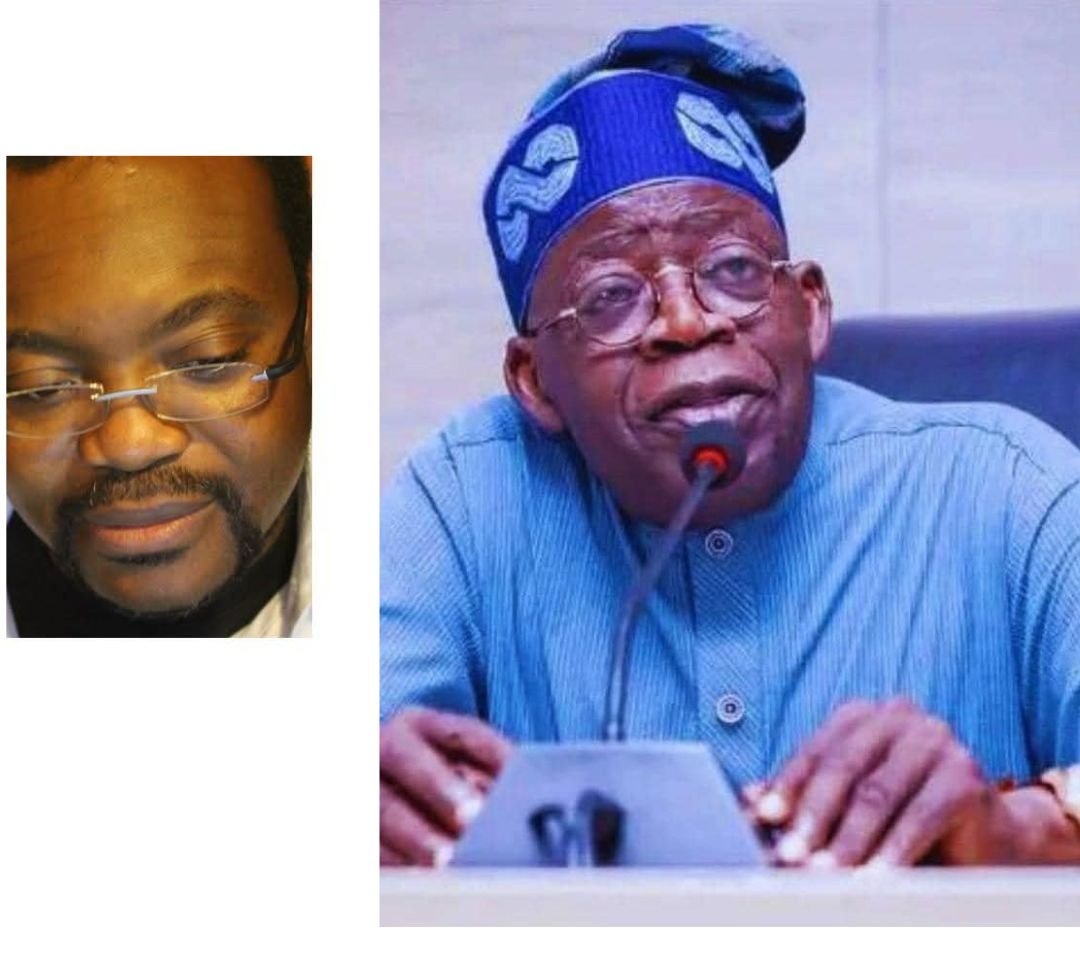


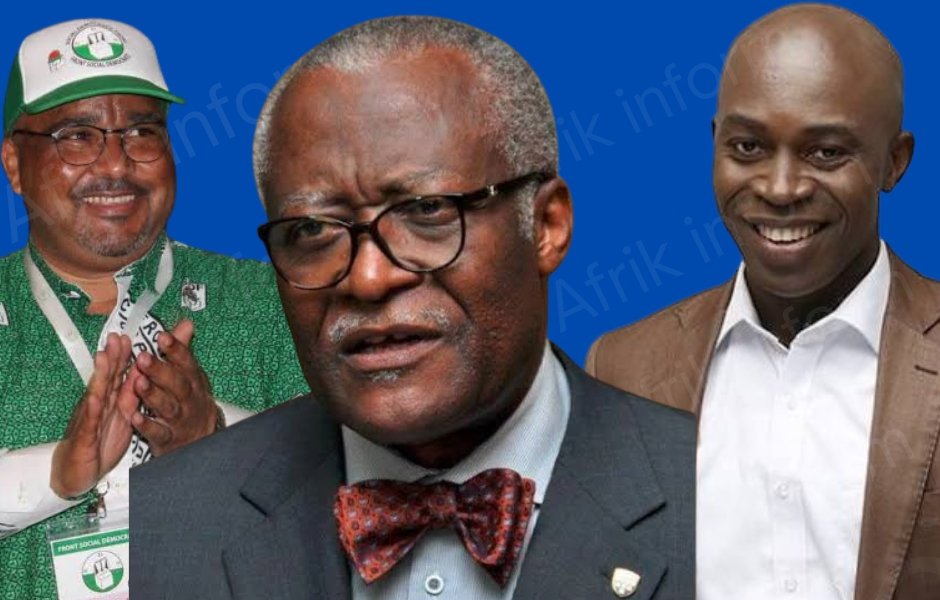





 X (Twitter)
X (Twitter) Site Web
Site Web
Laisser un avis