À l’approche d’une nouvelle élection présidentielle, la résurgence de la « question bamiléké » — ou ce que certains appellent la bamiphobie — exige une analyse bien plus profonde qu’un simple regard ethnique. Réduire ce phénomène à une tension tribale revient à simplifier à l’excès une réalité complexe, enracinée dans l’histoire, et à perpétuer des stéréotypes qui masquent ses véritables origines.
Cette tension n’est pas propre au Cameroun. Elle résonne dans toute l’Afrique postcoloniale, où des États artificielles et des structures de gouvernance coloniales ont laissé derrière elles des États fragiles, en quête d’identité, de légitimité et de cohésion.
La question Igbo au Nigeria, la marginalisation des Tutsis au Rwanda avant l’ère Kagame, le clivage arabo-africain au Soudan, le conflit Mamprusi-Kusasi au Ghana, ou encore la rivalité Kikuyu-Luo au Kenya illustrent comment le tribalisme est devenu un outil de politique partisane plutôt qu’une richesse culturelle.
Invention Coloniale et Amnésie Historique
Pour comprendre la question bamiléké, il faut d’abord reconnaître que le terme « Bamiléké » est une construction coloniale. Avant la colonisation allemande, aucune communauté unifiée ne portait ce nom.
Ce label fut imposé, puis instrumentalisé, notamment par des administrateurs français comme Lamberton, qui décrivait les Bamilékés comme « un caillou dans la chaussure ». Mais de quelle chaussure parlait-il ? Celle du colonisateur ? Ou celle des colonisés ?
Ces questions révèlent une vérité plus profonde : la stigmatisation des Bamilékés ne vient pas d’eux-mêmes, mais de systèmes conçus pour diviser et dominer. Tragiquement, les communautés bamiléké et non-bamiléké ont intégré et perpétué ce récit, transformant une fiction coloniale en réalité vécue.
Cycles Électoraux et Retour du Tribalisme
Il n’est pas étonnant que les tensions ethniques s’intensifient à l’approche des élections. Les structures héritées de la colonisation — institutions extractives, réseaux de clientélisme, politiques d’exclusion — demeurent largement intactes. L’État, au lieu de servir la nation, est souvent perçu comme un moyen d’enrichissement personnel, de népotisme et de consolidation ethnique.
Dans ce contexte, le tribalisme est devenu une monnaie politique. Les élites se servent de l’identité pour obtenir le pouvoir, tandis que les citoyens ordinaires doivent en supporter les conséquences.
Il est crucial de souligner que, par rapport à d’autres pays africains, le véritable souci au Cameroun ne réside pas dans le « vivre ensemble », mais plutôt dans le « manger ensemble ».
Mais pourquoi est-ce que le « manger ensemble » est-il réellement un problème ? C’est parce que nous n’avons pas réussi à construire des institutions qui servent le peuple, mais plutôt à servir ceux qui prennent le pouvoir. Le véritable problème réside dans notre incapacité à bâtir des institutions au service du peuple, plutôt qu’au service de ceux qui les dirigent.
Vers un Changement de Mentalité
Le défi du Cameroun n’est pas la diversité ethnique, mais l’incapacité à la transformer en force. Tant que nous ne changerons pas de mentalité pour nous voir comme des co-bâtisseurs d’un État juste et inclusif, nous resterons prisonniers du cycle de division conçu par les puissances coloniales et entretenu par les élites postcoloniales.
Pour conclure, la question bamiléké, tout comme la question anglophone, est avant tout un problème camerounais. Et comme toute blessure nationale, elle nécessite la vérité et réconciliation, réforme institutionnelle et un engagement collectif envers un leadership fondé sur l’héritage et la vision.
Wanah Immanuel Bumakor: Expert en Relations internationales africains et management de conflit. Foundateur et Managing Partner d’Amani Transformational Services
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





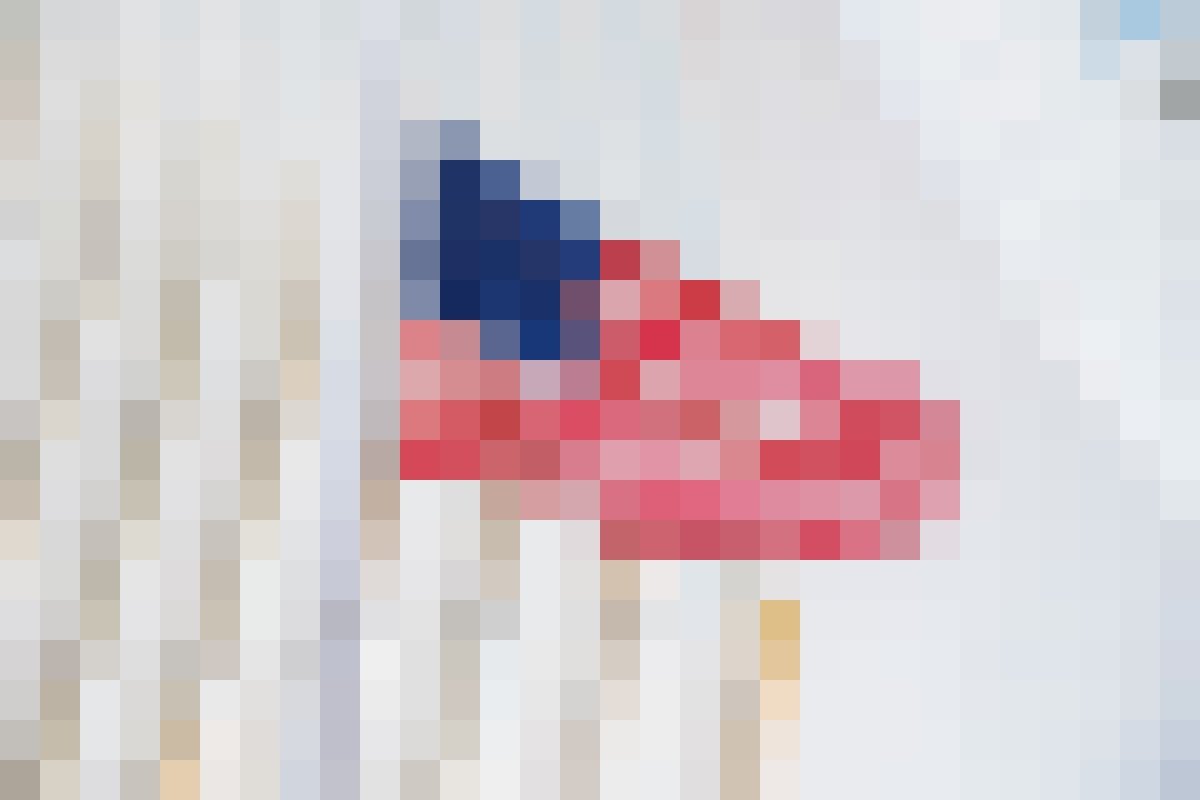

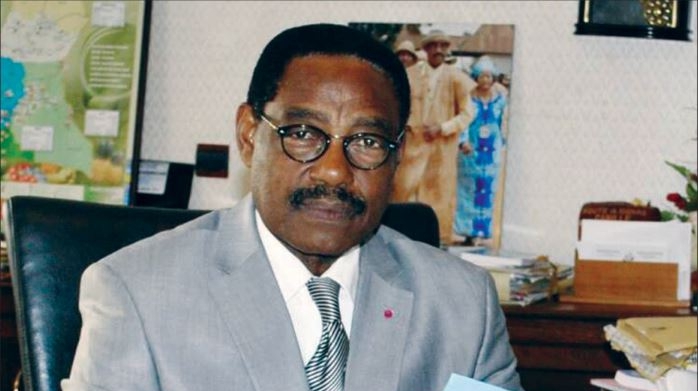


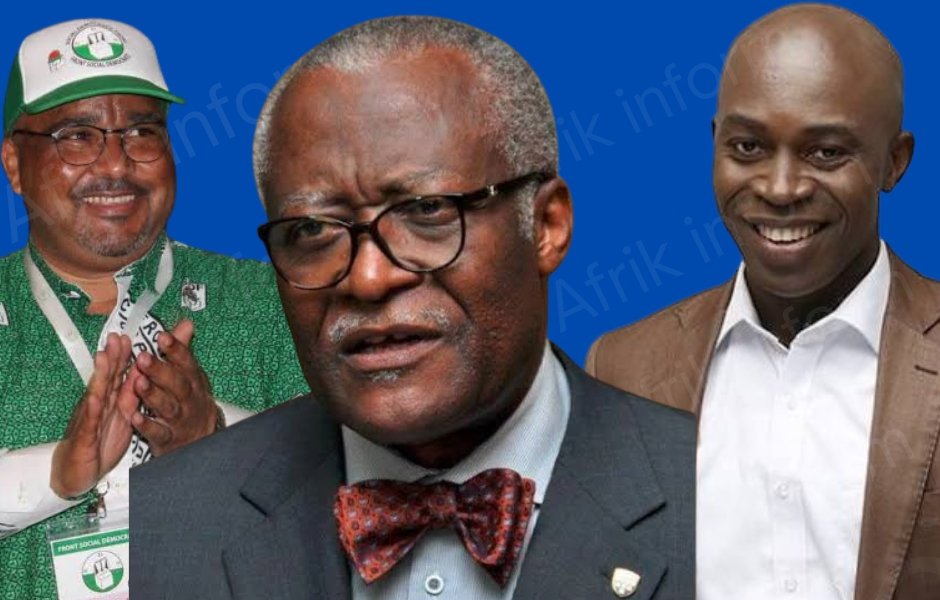





 X (Twitter)
X (Twitter) Site Web
Site Web
Laisser un avis