Au sortir des indépendances, l’Afrique de l’Ouest francophone et anglophone peine à parler d’une seule voix. Si les discours panafricains sont nombreux, les projets d’intégration restent éclatés.
Le 28 mai 1975, la rivalité entre Lagos et Lomé, entre ambition fédératrice et défense des zones d’influence, accouche d’un compromis historique : la création de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Récit d’une gestation tendue.
Deux modèles, deux visions de l’Afrique de l’Ouest
Au début des années 1970, l’Afrique de l’Ouest est une mosaïque d’États aux trajectoires divergentes. L’ère postcoloniale a renforcé les dépendances, en particulier dans l’espace francophone arrimé au franc CFA et à la tutelle économique française.
À l’inverse, le Nigéria, fraîchement sorti de la guerre du Biafra, s’affirme comme un géant économique et démographique, bien décidé à peser sur le devenir régional.
Lagos veut structurer son voisinage immédiat, mais autour d’une architecture à dominante anglophone, ouverte mais pilotée par ses soins. C’est dans ce contexte qu’émerge l’idée d’une vaste communauté économique ouest-africaine, capable de rompre avec les modèles hérités de la colonisation, tout en s’inspirant des blocs régionaux européens et asiatiques.
Mais cette ambition se heurte vite aux réticences des États francophones, notamment la Côte d’Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, qui craint une perte de contrôle face à la puissance nigériane.
Un clivage se dessine, moins linguistique que géostratégique : d’un côté, un Nigéria tourné vers l’intégration par le leadership ; de l’autre, un bloc francophone plus prudent, attaché à ses partenariats classiques avec la France.
Lomé contre Lagos : la bataille des structures régionales
En 1972, dans une tentative d’harmonisation, le Nigéria propose un projet de communauté économique ouest-africaine regroupant l’ensemble des États de la région, sans distinction linguistique ni historique.
L’homme derrière ce projet s’appelle Adebayo Adedeji. Technocrate brillant, il imagine une organisation à la fois politique et économique, reposant sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.
Mais à Lomé, la réponse est immédiate. Avec l’appui d’Abidjan, le Togo de Gnassingbé Eyadéma lance l’Organisation des États de l’Afrique de l’Ouest (OEAO), sorte de contre-proposition francophone à l’initiative nigériane. Si l’objectif officiel est aussi l’intégration, l’enjeu est ailleurs : il s’agit de ne pas laisser Lagos imposer son tempo et son architecture.
Le face-à-face devient tendu. Les deux blocs s’activent sur la scène diplomatique africaine, chacun tentant de rallier des pays indécis. La Guinée, socialiste et panafricaine, reste à l’écart.
La Mauritanie, alors encore tournée vers le monde arabe, participe sans enthousiasme. Seuls les petits États, comme la Gambie ou le Cap-Vert, observent prudemment les deux géants s’affronter.
Le rôle déterminant de l’OUA et des diplomates africains
Face à cette impasse, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) intervient. L’objectif : éviter un éclatement de l’Afrique de l’Ouest en blocs concurrents, comme c’est déjà le cas en Afrique centrale et orientale.
À Addis-Abeba, des médiations sont menées, notamment par le secrétariat général des affaires économiques, où Adedeji joue à la fois le rôle de diplomate et de stratège.
Il faut convaincre Houphouët-Boigny que l’intégration ne signifie pas absorption. Et persuader le Nigéria de faire des concessions sur sa vision initiale.
Après plusieurs mois de négociations discrètes, un compromis se dessine : fusionner les ambitions, créer une seule organisation régionale, mais en respectant une forme d’équilibre géopolitique et économique.
L’accord de Lagos : une victoire partagée, une méfiance persistanteLe 28 mai 1975, à Lagos, les dirigeants de quinze pays ouest-africains signent le traité fondateur de la CEDEAO. Les signataires sont : le Bénin, le Burkina Faso (encore Haute-Volta), le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
L’acte fondateur repose sur des principes ambitieux : libre circulation des citoyens, suppression des barrières douanières, harmonisation des politiques économiques, mise en place d’un tarif extérieur commun. Mais derrière l’élan politique, les équilibres restent fragiles. Chaque pays signe avec ses propres intérêts.
Le Nigéria garde un rôle moteur, mais s’engage à ne pas imposer sa domination. Les pays francophones obtiennent des clauses de sécurité économique, notamment sur la compatibilité avec la zone franc. La CEDEAO naît donc d’un compromis : ni tout à fait le projet nigérian, ni entièrement la version francophone.
Une structure mixte, hybride, qui devra apprendre à se réinventer face aux réalités régionales.
Une organisation née dans le tumulte, toujours en quête de cohérence
Le chemin de l’intégration régionale sera long. Les premières années sont marquées par les lenteurs bureaucratiques, les tensions internes et les coups d’État à répétition dans la région. La Mauritanie finira par se retirer en 2000.
Le Ghana et la Côte d’Ivoire, longtemps distants, joueront un rôle plus affirmé à partir des années 1990. Le Nigéria, malgré sa puissance, subira des crises internes qui freineront son leadership.
Pourtant, la CEDEAO deviendra l’un des rares ensembles régionaux africains à s’impliquer dans la gestion des conflits (Ecomog), la médiation politique (Gambie, Mali, Guinée-Bissau) et l’harmonisation commerciale (Zone de libre-échange, tarif extérieur commun).
Une lente construction, toujours inachevée, mais née d’un choc initial entre visions opposées.
Constantin GONNANG, Afrik inform ☑️
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





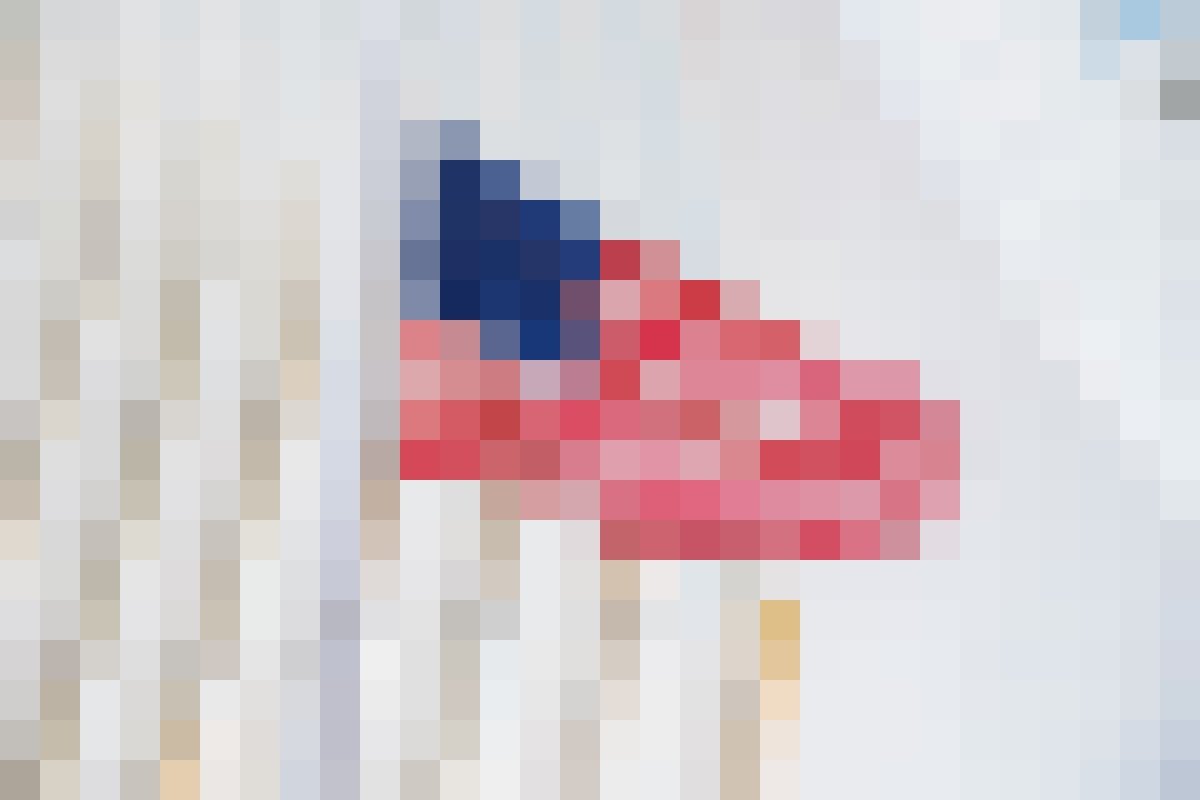






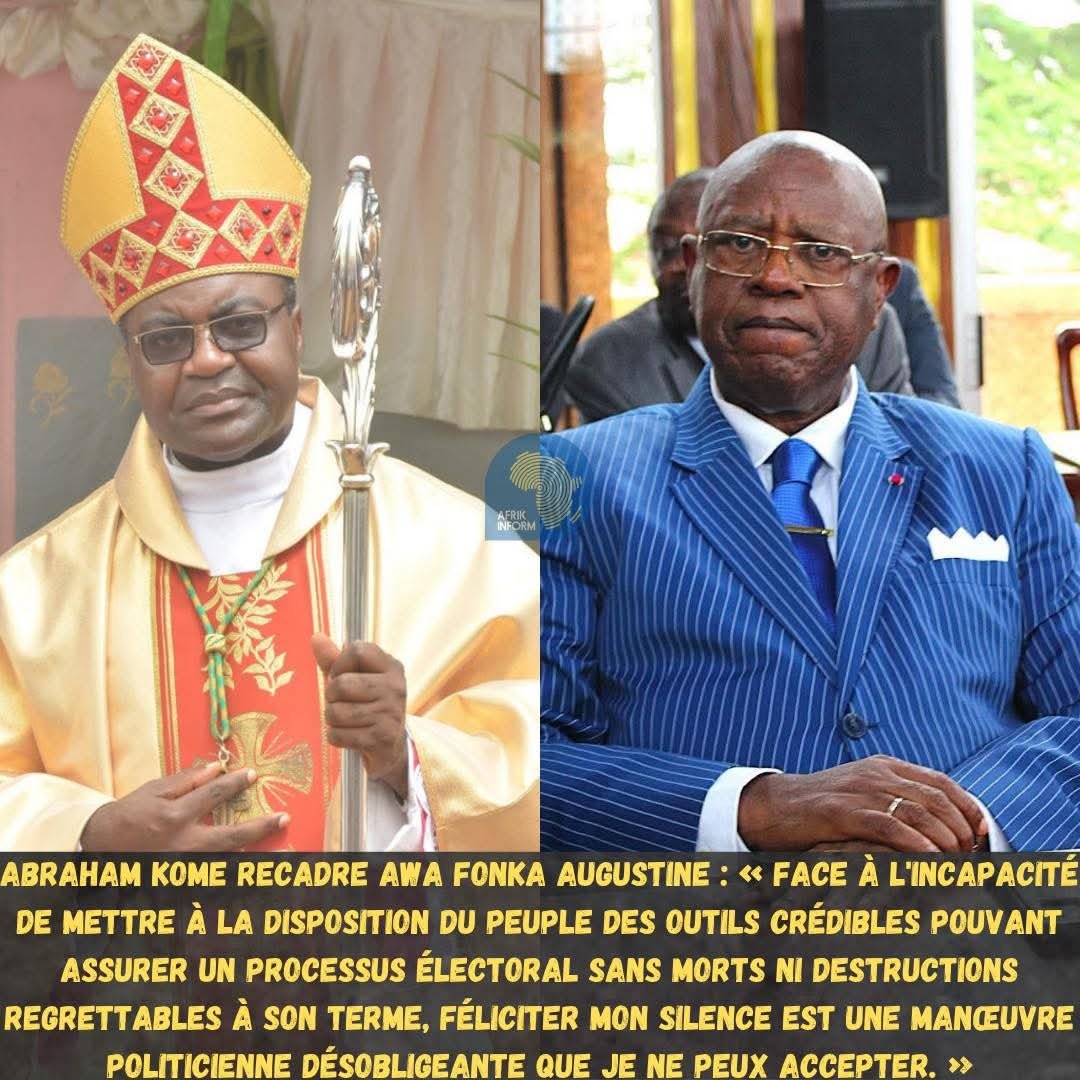

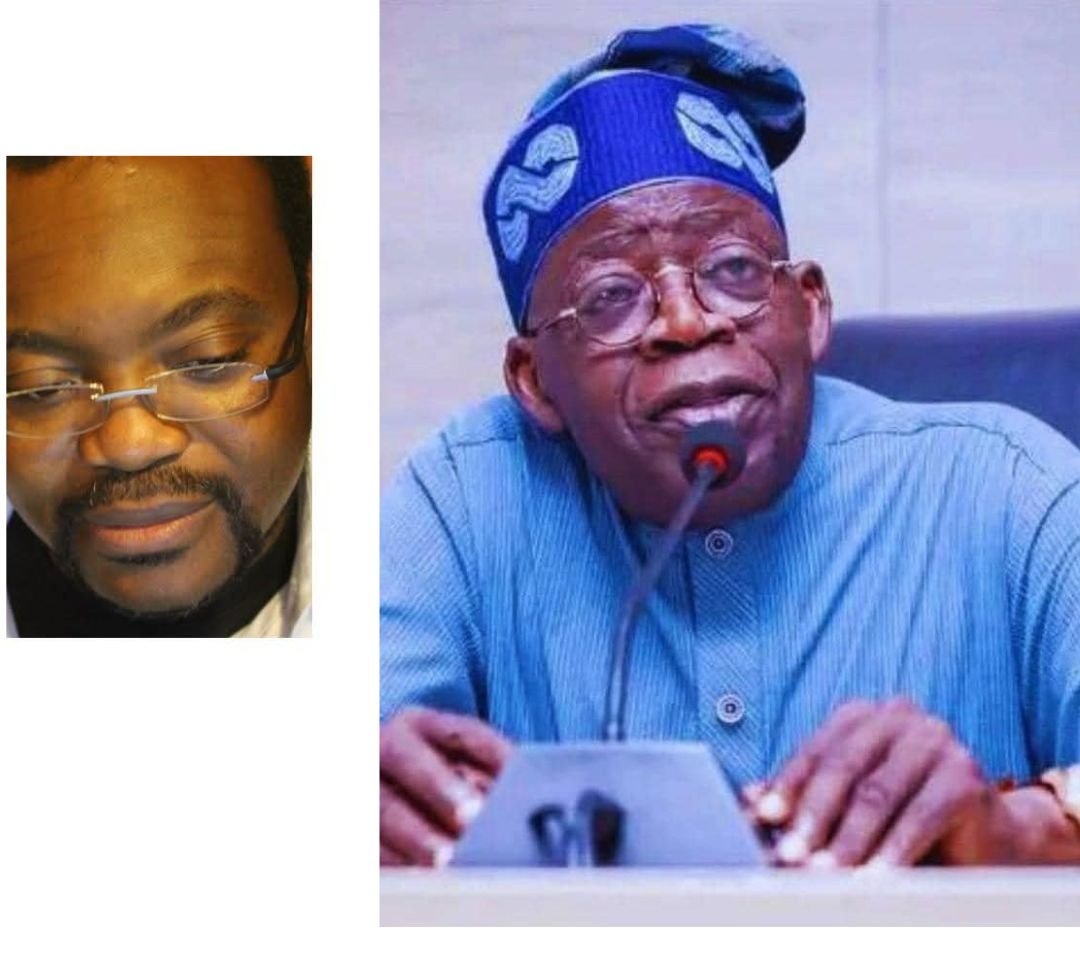

 X (Twitter)
X (Twitter) Site Web
Site Web
Laisser un avis