La 47ème session des Comités Consultatifs Interafricains du CAMES, tenue à Ndjamena en juillet 2025, a livré des résultats désastreux pour le Cameroun. Sur 95 candidats, tous grades confondus, seuls 21 ont été inscrits sur les listes d’aptitude, soit un taux de réussite de 23,15%.
Ce revers, historique par sa gravité, soulève une question centrale : comment comprendre cet échec profond, et surtout, quelles mesures urgentes doivent être prises pour éviter le déclin durable de nos universités ? L’analyse que livre le Professeur Bekolo-Ebé Bruno, Recteur honoraire et figure de l’enseignement supérieur camerounais, est un cri d’alarme autant qu’un appel à la mobilisation collective.
1. Comprendre un échec qui concerne toutes les universités et toutes les disciplines
Les résultats de la 47ème session des CTS révèlent un mal profond et généralisé. Toutes les disciplines et toutes les universités sont affectées, la seule exception étant Sciences Politiques à l’Université de Yaoundé II, avec un taux de réussite de 57,1% pour la LAFMA, encore très loin de la moyenne continentale.
Le constat est sans appel : le Cameroun, autrefois perçu comme une référence en matière de recherche et de formation, se retrouve bon dernier dans le classement des pays membres du CAMES, devancé même par ceux que l’on considérait comme moins avancés.
Cette situation s’inscrit dans la continuité de l’échec de l’année précédente, notamment pour le concours d’agrégation de médecine, où les turpitudes institutionnelles ont largement contribué aux ajournements.
L’impact est lourd : moins de candidats qualifiés pour les futurs concours, moins de voix au sein des CTS, moins de professeurs et maîtres de conférences capables d’encadrer les étudiants avec l’exigence nécessaire, et par conséquent, une réputation universitaire ternie sur le plan continental et international.
2. Les causes : forme, fond et responsabilité partagée
Selon le Professeur Bekolo Bruno, l’échec des candidats relève à la fois de motifs formels et de raisons de fond. Les premiers incluent des erreurs dans la constitution des dossiers : pièces manquantes, non-respect de la recevabilité, absence de conditions d’ancienneté. Les secondes concernent la qualité et la quantité des travaux scientifiques : insuffisance d’articles publiés, rapports d’évaluation négatifs ou réservés.
Si ces causes mettent en lumière la responsabilité individuelle des candidats, elles révèlent surtout la responsabilité institutionnelle : l’université doit encadrer, conseiller et vérifier les dossiers pour maximiser les chances de réussite. Le malaise est structurel et reflète un système qui, dans plusieurs universités, laisse passer des insuffisances graves avant l’évaluation du CAMES.
3. Le rôle indispensable des candidats et l’accompagnement des maîtres
L’auteur insiste sur l’importance de la mobilisation individuelle. Les candidats doivent prendre conscience de l’exigence du processus, préparer leurs dossiers avec minutie et solliciter l’accompagnement des maîtres. Ces derniers, garants de la transmission du savoir et de la rigueur académique, ont une responsabilité morale et pédagogique : ils doivent guider les jeunes enseignants, les pousser à atteindre un niveau de qualité comparable au leur, et imposer l’exigence de rigueur dans les publications et les recherches.
Le Professeur Bekolo rend hommage à ses propres maîtres, dont la discipline et l’exigence l’ont façonné, et souligne que la faiblesse actuelle d’engagement des enseignants pourrait expliquer en partie les résultats désastreux.
4. La responsabilité des universités : vigilance institutionnelle et structures de contrôle
Les universités elles-mêmes doivent s’investir pleinement. Chaque établissement doit s’assurer que les dossiers remplissent toutes les conditions de forme et de fond avant soumission. Le Recteur honoraire propose la mise en place de commissions internes, impliquant le chef de département et le conseil d’établissement, pour évaluer chaque candidature, avec éventuellement la participation de collègues étrangers pour un regard extérieur.
Ces commissions doivent fonctionner en continu, loin des pressions des candidats et des urgences de dernière minute, afin de garantir la qualité et la conformité des dossiers présentés au CAMES. Une telle vigilance protégerait à la fois l’université et le candidat, consolidant la réputation institutionnelle.
5. La tutelle et la Conférence des Recteurs : supervision et stratégies d’avenir
Au-delà des candidats et des universités, le Professeur Bekolo interpelle la Tutelle et la Conférence des Recteurs. La responsabilité de l’État est d’assurer que les universités remplissent pleinement leurs missions : former des hommes et des femmes de qualité, produire de la connaissance et des technologies, et permettre aux Camerounais de se réaliser pleinement. Ces institutions doivent coordonner les efforts, vérifier que les recommandations sont appliquées, et, en concertation avec le CAMES, identifier les causes des échecs.
À court terme, cela pourrait se traduire par un manuel de procédures pour guider les universités dans la constitution des dossiers. À long terme, un suivi régulier des mesures de redressement garantirait la place du Cameroun dans la compétition académique internationale.
6. Un appel urgent à la mobilisation collective
Le message central est un appel à l’action : l’échec observé est profond et structurel, mais il n’est pas irréversible. Chaque acteur, du candidat au ministre, doit prendre sa part de responsabilité. Les maîtres doivent encadrer avec exigence, les universités vérifier et accompagner avec rigueur, la tutelle superviser et orienter avec détermination.
Le silence et l’indifférence seraient, selon le Professeur Bekolo, des complicités dangereuses, susceptibles de précipiter le déclin durable de l’enseignement supérieur camerounais.
Le Cameroun, autrefois modèle de référence dans l’espace francophone, se trouve aujourd’hui face à un miroir troublant : celui d’un enseignement supérieur fragilisé, où le déclin des performances aux CTS du CAMES n’est que le symptôme d’un mal plus profond. Mais à cette gravité, répond aussi un appel vibrant à la conscience collective.
Chaque université, chaque maître, chaque candidat, chaque acteur de la tutelle est interpellé : mobilisez-vous, redressez le navire, ou risquez de voir l’excellence académique s’éloigner définitivement de nos rivages.
Constantin GONNANG, Afrik inform ☑️
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





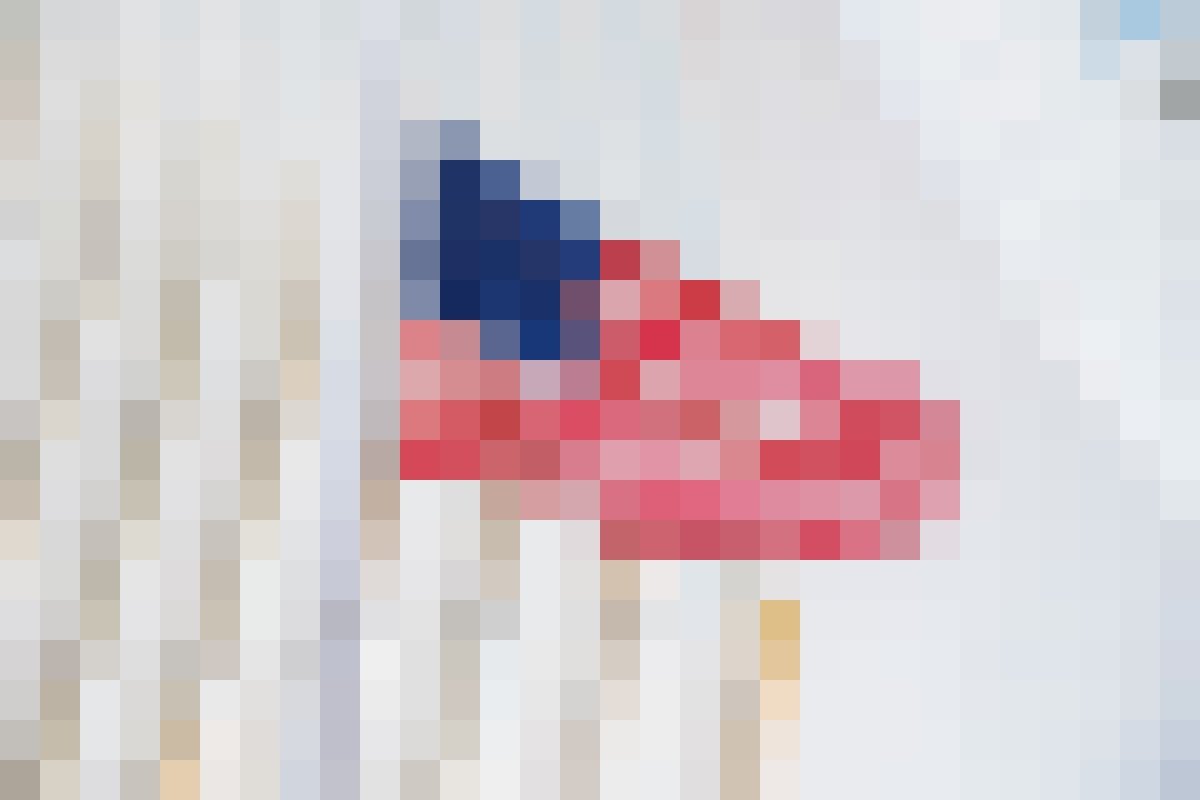

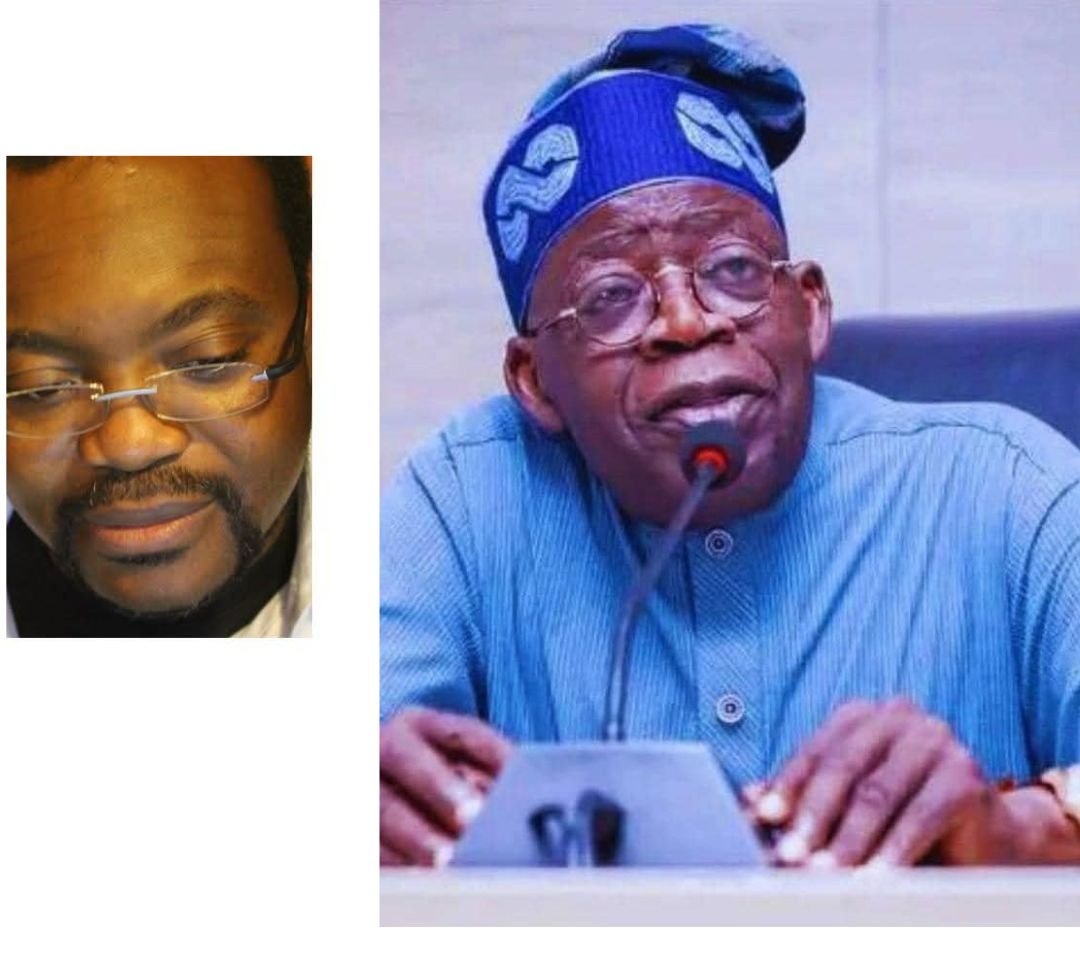








 X (Twitter)
X (Twitter) Site Web
Site Web
Laisser un avis