Depuis début septembre 2025, le Mali traverse une crise de carburant qui prend des proportions inédites. Un blocus imposé par le groupe djihadiste Jama’at Nusrat al‑Islam wal‑Muslimin (JNIM), affilié à Al‑Qaïda, paralyse les importations et menace de désorganiser l’ensemble de l’économie nationale. Des camions‑citraines sont régulièrement attaqués ou incendiés sur les routes reliant le Mali à ses voisins côtiers, notamment le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Dans un pays qui importe plus de 95 % de ses carburants, l’impact se fait sentir partout : files d’attente interminables, stations à sec, coupures d’électricité et perturbation du transport urbain et interurbain. L’État a pris des mesures d’urgence, mais la crise révèle des failles profondes dans la logistique, la sécurité et la diplomatie maliennes.
Quand l’acheminement du carburant devient une mission à haut risque
Le Mali, en tant que pays enclavé, dépend entièrement de camions‑citraines pour faire parvenir les produits pétroliers depuis les ports africains. Les routes Dakar‑Bamako, Kayes‑Nioro et celles passant par la Mauritanie représentent les principaux axes de ravitaillement. Depuis le début du blocus, ces corridors sont devenus des terrains d’affrontement entre convoyeurs et militants armés.
Selon des rapports locaux, plus de 40 camions-citernes ont été détruits lors d’attaques ciblées sur un convoi d’une centaine de véhicules. Chaque camion manquant représente non seulement des tonnes de carburant perdues, mais aussi des coûts logistiques supplémentaires pour sécuriser les prochains convois. L’effet domino sur l’économie est immédiat : les centrales thermiques manquent de carburant, l’électricité devient irrégulière et les transports publics sont en panne.
Le blocus expose de façon crue la vulnérabilité structurelle du pays. Le manque d’alternatives crédibles pour l’acheminement des produits pétroliers transforme chaque transport en pari risqué. La sécurité des convois coûte cher et le prix final du carburant pour les consommateurs grimpe en flèche.
Une dépendance énergétique totale qui transforme le carburant en arme politique
La dépendance du Mali aux importations étrangères de carburants raffinés est quasi totale. Selon l’International Energy Agency (IEA), le pays ne dispose d’aucune capacité locale de raffinage significative, ce qui le rend extrêmement sensible aux perturbations de l’approvisionnement. Le carburant devient alors un levier stratégique.
Le blocus de JNIM n’est pas seulement une action militaire : c’est une pression économique et politique. En paralysant le transport des carburants, le groupe cherche à miner l’autorité de la junte dirigée par Assimi Goïta, à montrer les limites du contrôle territorial de l’État et à faire sentir aux populations que la capitale, Bamako, peut être laissée sans oxygène.
Les conséquences dépassent le cadre économique : écoles et universités ont été fermées pour deux semaines, et certains secteurs industriels et miniers, comme la Sadiola Gold Mine, ont vu leurs activités fortement ralentir. Le carburant n’est plus seulement un produit de consommation : il devient un instrument de pouvoir dans un contexte d’instabilité politique et sécuritaire.
Diplomatie et alliances internationales en pleine réorganisation
La crise qui secoue aujourd’hui le Mali ne se limite plus à une simple pénurie de carburant ; elle traduit un véritable repositionnement diplomatique du pays, contraint de redéfinir ses alliances au rythme de ses vulnérabilités internes. Incapable de sécuriser ses routes face à la pression des groupes armés affiliés au JNIM, le gouvernement de Bamako a choisi de se tourner vers Moscou. Dans un geste révélateur, un accord a été signé avec la Russie pour la livraison de près de 200 000 tonnes de produits pétroliers, une bouffée d’air attendue pour un pays où chaque litre d’essence est devenu un enjeu de survie.
Mais cette ouverture vers l’Est s’accompagne d’un isolement grandissant sur la scène internationale. Les ambassades occidentales observent avec prudence cette nouvelle orientation : les États-Unis, en particulier, ont exhorté leurs ressortissants à quitter le territoire sans délai, un signal clair du durcissement de la perception diplomatique à l’égard du régime malien. Dans les chancelleries, l’heure est aux calculs : la dépendance croissante à la Russie pourrait rebattre durablement les cartes du jeu géopolitique régional.
Sur le terrain, les conséquences se font sentir à tous les niveaux. Les routes sont désertées, les taxis immobilisés par manque de carburant, les bus réduits au silence dans les gares routières. Les centrales thermiques tournent au ralenti, plongeant certains quartiers dans des coupures d’électricité de plusieurs heures. Dans les écoles et universités de Bamako, les salles de classe sont vides : les autorités ont suspendu les cours jusqu’au 10 novembre, laissant des milliers d’étudiants dans l’incertitude.
Au marché, la pénurie se transforme en spirale inflationniste. Les files d’attente s’allongent, les prix s’envolent ; sur le marché informel, un litre d’essence se vend jusqu’à 175 % plus cher qu’à la pompe. Entre désorganisation et résilience, le Mali tente de tenir bon, oscillant entre la nécessité de survivre et celle de redéfinir sa place dans un monde où la diplomatie et la dépendance se confondent désormais.
Du blocus à la résilience : quand le carburant dicte le rythme du Mali
Depuis le début du blocus en septembre 2025, le Mali s’est retrouvé plongé dans une crise de carburant qui a rapidement pris des proportions inédites. Les premiers signes sont apparus lorsque le groupe djihadiste JNIM a imposé ses attaques sur les convois de camions‑citraines venant des ports africains. Des véhicules ont été détruits, certains incendiés, et le prix du carburant a commencé à flamber dans les marchés locaux, transformant les files d’attente à Bamako en scènes quotidiennes de frustration et de désarroi.
Au fil des semaines, la situation s’est aggravée. Début octobre, de nombreuses stations ont dû fermer leurs portes, incapables de répondre à la demande. Le gouvernement malien a alors mis en place un comité de gestion d’urgence pour sécuriser les routes et protéger les convois, mais chaque tentative de ravitaillement restait soumise à la menace constante d’attaques. La vie quotidienne s’en est trouvée profondément perturbée : transports paralysés, entreprises ralenties, électricité intermittente, et bientôt les écoles et universités ont été contraintes de fermer pour deux semaines, amplifiant le sentiment d’isolement et d’urgence.
Le 27 octobre, un tournant diplomatique s’est dessiné : le Mali annonçait un accord avec la Russie pour l’importation de 160 000 à 200 000 tonnes de carburant, tentant de compenser les pertes et de rassurer une population en quête de solutions. Mais la même semaine, l’alerte américaine demandant à ses ressortissants de quitter le pays soulignait l’ampleur du désarroi sécuritaire et la fragilité de l’État face à ces pressions.
À mesure que le blocus persistait, il est apparu que la crise n’était pas qu’une question logistique : elle devenait un test pour la junte malienne. La réouverture complète des routes et la circulation sécurisée des convois apparaissaient comme les clés pour restaurer un semblant de normalité économique. Les prix à la pompe et le coût de la vie, déjà affectés, étaient les premiers baromètres de la reprise, tandis que la capacité de l’État à protéger ses infrastructures stratégiques constituait un indicateur de légitimité.
Mais cette crise pourrait aussi redessiner la diplomatie malienne. Dépendant désormais de partenaires alternatifs pour sécuriser son approvisionnement, le pays amorce une réorientation stratégique qui pourrait modifier durablement les alliances régionales et internationales. À plus long terme, la nécessité de réduire la dépendance aux importations s’impose : diversification des routes, constitution de stocks stratégiques et développement potentiel d’une production locale de carburant deviennent autant de pistes pour sortir de ce cycle de vulnérabilité.
En savoir plus sur Afrik-Inform
Subscribe to get the latest posts sent to your email.





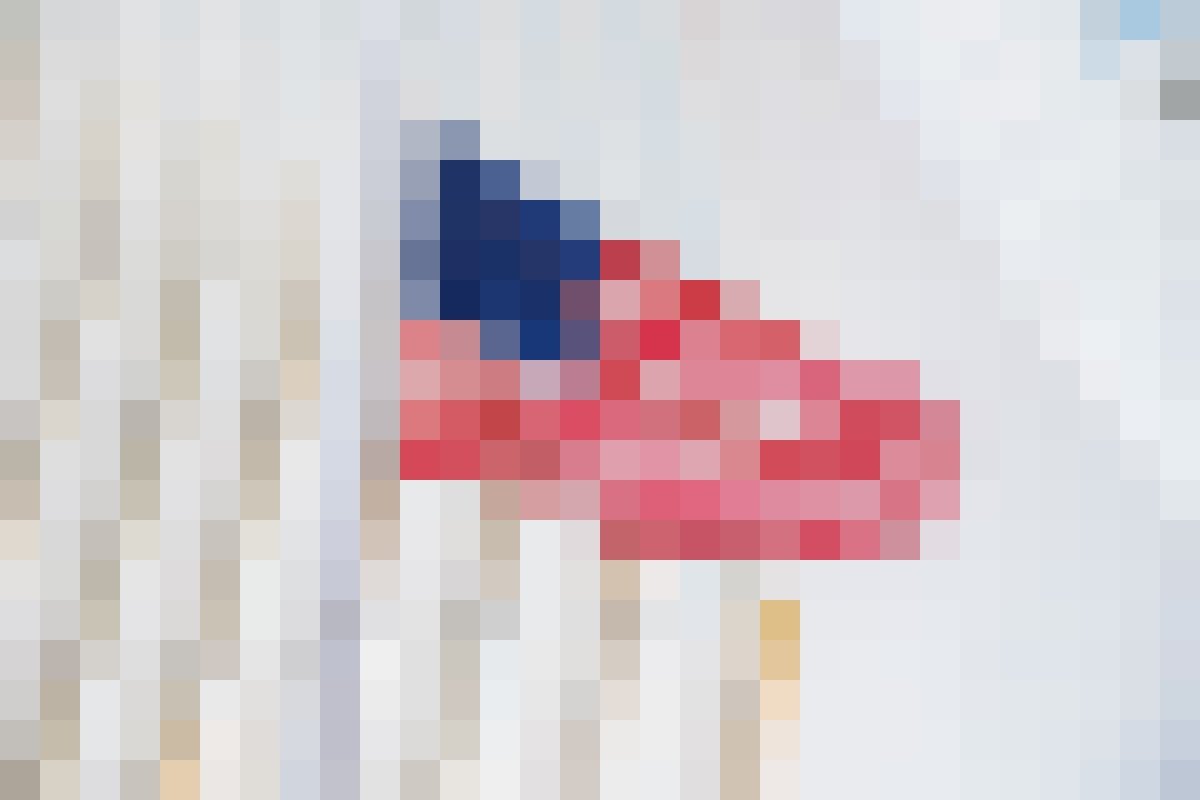




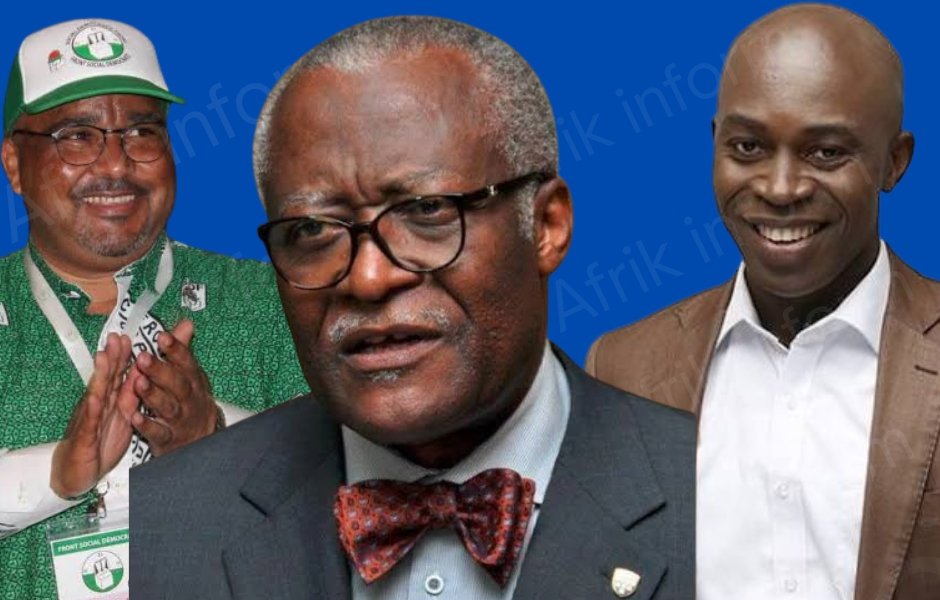

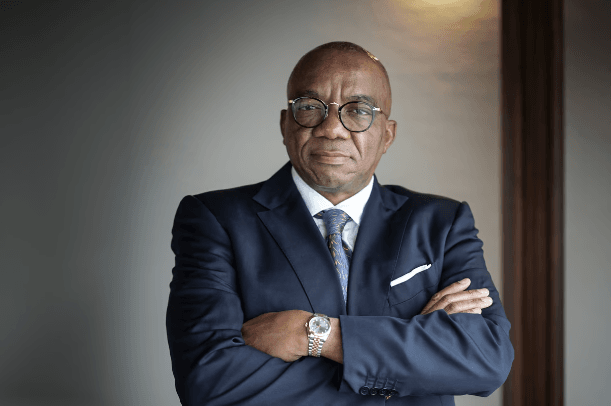



 X (Twitter)
X (Twitter) Site Web
Site Web
Laisser un avis